Un nouveau souffle pour l’intégrité scientifique de la recherche
Encore une fois une université française, l’Université Sorbonne Paris Nord, vient d’être secouée par un cas de manquement à l’intégrité scientifique auquel les médias n’ont pas fini de faire écho[1].
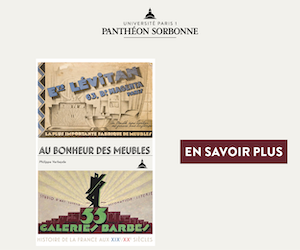
Après l’enquête effectuée pour le compte du CNRS (l’établissement dont dépend la personne mise en cause), la sanction décidée par le président du CNRS a été vue par beaucoup d’une clémence exagérée compte tenu des écarts constatés. Elle a même suscité des commentaires de la part de personnalités françaises et étrangères investies dans les questions d’intégrité, qui ont posté sur le blog de l’un d’entre eux « we use this case to illustrate what we see as an institutional malaise that is widespread in scientific organisations » (entendez : en France)[2].
Sans épiloguer sur l’opportunité de ce « manifeste » international, ni même sur ce cas particulier récent de fraude en Chimie à Villetaneuse, dont nous ne connaissons d’ailleurs pas tout le dossier, cette affaire nous donne l’occasion, en tant que membres du CoFIS (Conseil d’orientation de l’Office français de l’intégrité scientifique), de poursuivre une réflexion amorcée en France il y a bientôt dix ans : nous tracerons ici quelques pistes qui, selon nous, pourraient donner un second souffle à la défense de l’intégrité scientifique, et peut-être plus généralement de l’éthique de la recherche en France[3]. Il nous semble qu’un effort supplémentaire dans ce sens pourrait être demandé aux directions des établissements de recherche.
Comprenons-nous bien ce qu’intégrité scientifique veut dire ?
La loi de programmation de la recherche votée en 2021 a inscrit l’intégrité scientifique dans le Code de la recherche et dans celui de l’éducation, en indiquant qu’elle vise « à garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux [des travaux de recherche] et à consolider le lien de confiance avec la société[4] ». On sait qu’une personne intègre est celle qui ne se laisse pas corrompre. Mais est-ce qu’on sait ce que l
