Le beau savoir est-il de droite ?
Vingt après la disparition de Pierre Bourdieu, alors que l’on vient de commémorer cet anniversaire, plusieurs des notions que celui-ci a forgées sont à nouveau débattues, notamment sa réflexion sur la distinction et le capital symbolique, et, d’une manière plus générale, celle sur les goûts sociaux.
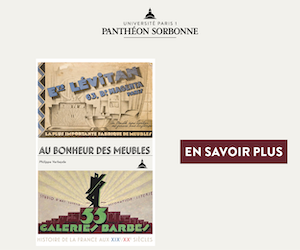
La question est ancienne, la réponse l’est tout autant : les goûts classent, et, à ce titre, le goût du beau serait socialement déterminé (on choisit une voiture, un téléphone ou un hôtel suivant son milieu). À tous les sens du terme, chacun sa classe, tout particulièrement en matière de culture (faire valoir sa lecture des classiques ou sa fréquentation de l’avant-garde en impose).
Mais qu’en est-il d’autres formes de culture ? Peut-on étendre au monde universitaire et à sa production ce regard scrutateur ? Choisir une télévision, un cours de yoga ou une lampe, c’est comme choisir un livre de philosophie analytique, d’ethnométhodologie ou d’études post-coloniales ? Y aurait-il des disciplines dont la forme correspond davantage au goût des dominants, ou, à l’inverse, à ceux des dominés ? C’est ce que Bourdieu semble dire dans son Esquisse pour une auto-analyse, lorsqu’il évoque son pas de côté et sa prise de distance avec la philosophie, cette discipline dans laquelle il avait été formé : « Le refus de la vision du monde associée à la philosophie universitaire de la philosophie avait sans doute beaucoup contribué à m’amener aux sciences sociales et surtout à une certaine manière de les pratiquer. »
L’académisme et le beau savoir
L’académisme est-il, à tout prix, l’imposition d’un goût légitime, le diktat effectif du beau ? Tout comme, selon Bourdieu, Paul Ricoeur serait un « philosophe du dimanche », l’académisme philosophique ou le « beau savoir » qui s’en réclame serait-il « de droite » ?
En opposition à l’académisme, la marque stylistique de Bourdieu est particulière, et ses mots valent autant pour leur contenu que pour leur forme. Ils sont rugueux, les néologismes de Bourdieu sont légion, ses codes linguistiques sont une langue à part entière. Pour celui qui avait été son hôte à Berkeley et qui fut son invité au Collège de France, le philosophe du langage John Searle, la prose de Bourdieu relevait de l’obscurantisme. Searle s’en lamentait, mais il avait été aux anges lorsque Bourdieu lui aurait fait cet aveu : pour être pris au sérieux en France, il faut au moins vingt pour cent « d’incompréhensible ». Un tel goût de l’obscur en dit long sur l’esthétique du savoir.
Le style est une catégorie qui vaut aussi bien pour la fiction que pour les travaux universitaires dans les sciences exactes comme dans les sciences humaines. Le style est la marque d’une voix, d’une plume et d’une identité qui, pour laisser une trace, veut se faire entendre. À l’écrit comme à l’oral, chez Bourdieu, le style accompagne une gestuelle, une esthétique de la révolte : « la sociologie est un sport de combat ». Tout comme la boxe, elle a son esthétique, sa logique de mouvement, ses crochets et ses uppercuts, sa danse. Alors que le sociologue Steven Shapin montre combien les règles de civilité aristocratique (la parole, la promesse) sont à l’origine des règles de la science et notamment de la règle de vérité, Bourdieu est le héros d’une « civilité incivile ». Il cogne tous ceux qui ne seraient pas assez à son goût, à droite bien sûr, et, avec tout autant de verve et d’agressivité si ce n’est davantage, à gauche, les « cathos » de la revue Esprit, ou bien les post-modernes et les « minority studies », affublés du sobriquet de « glamour chic ».
Pourquoi rappeler ces faits d’armes qui, déjà, ont fait tant couler d’encre ? Parce qu’on a essentiellement vu là des querelles essentiellement politiques et scientifiques (les unes ou les autres, ou les unes et les autres), alors qu’est en jeu une autre dimension : l’esthétique de la connaissance. À partir de ces rappels, on peut tirer deux conclusions. Premièrement, une esthétique de la connaissance caractérise le style du sociologue bourdivin comme c’est le cas, sous une autre forme, chez Paul Lazarsfeld (ce sociologue que Bourdieu affuble du titre de dirigeant de multinationale, dont Raymond Boudon, son correspondant français, aurait été le « chef de comptoir »). Ce goût de la forme est manifeste dans les écrits et également dans les modes de vie de ces universitaires, dans leur esthétique personnelle.
Deuxièmement, le goût bourdivin s’oppose au conformisme de l’université giscardienne et il tranche avec la fabrique convenue de l’énarchie : il y aurait une esthétique « de gauche » comme une esthétique « de droite ». On ne saurait pour autant tort de s’en tenir là et il faut poser une question. Peut-on déduire de ces deux constats que le beau savoir (ou celui qui est censé l’être), cette esthétique qui a réussi dans la perfection, est relatif ? Le beau savoir serait l’apanage des dominants, tous tenants du classicisme ou de l’académisme (les puissants le construisent, le beau est relatif à leur condition sociale et aux avantages que celle-ci leur procure). Pour ma part, je ne le pense pas.
Dégradation ou élévation du goût
Voyons maintenant ce que nous apprennent les jeunes générations, regardons ce qui se passe du côté du monde étudiant et les querelles du goût qui s’y jouent.
Au début de cette année, LVMH a renoncé à s’installer sur le campus de l’école polytechnique, alors que « l’X » est l’alma mater de son président, Bernard Arnault, et que ce projet lui tenait manifestement à cœur (deux des fils de ce cacique du luxe sont passés par l’école). Pourquoi une telle volte-face ? Alors que la direction de polytechnique avait accueilli à bras ouverts la proposition de ce conglomérat, un nombre significatif d’élèves avait manifesté leur opposition à ce projet : 43 % des étudiants y étaient défavorables. Leur slogan laissait peu de doutes sur leur motivation, et il n’était pas de bon augure pour LVMH : « L’X n’est pas à vendre ». On aurait tort de considérer cette expression des préférences comme un simple épiphénomène. On aurait tort de considérer que l’extrême gauche s’est installée à l’école polytechnique. On aurait également tort de considérer qu’il s’agit là simplement d’une forme de snobisme de la part de la noblesse d’État qui méprise de vulgaires boutiquiers.
En effet, parmi les différents savoirs, les mathématiques sont la discipline qui a le plus pris au sérieux l’esthétique. Selon le philosophe des sciences Bernard Russell, les mathématiques incarnent la « beauté suprême ». Ce propos mérite d’être entendu et il n’est pas isolé. Pour Poincaré, les mathématiques ont un « but esthétique ». C’est parfaitement normal, esthétiquement, une belle équation vaut davantage qu’un sac de toile plastifiée monogrammée, quand bien même celui-ci est fétichisé. Le laid est aussi une souillure et, de manière tout à fait logique, LVMH a dû s’installer à l’extérieur du territoire sacré de l’X.
Il est à noter que dans un nombre important d’écoles d’art, auparavant les grandes pourvoyeuses de main d’œuvre pour les « maisons de luxe », les diplômés aujourd’hui boudent des groupes comme LVMH. Leur jugement coïncide avec celui de nos fringants étudiants en uniforme républicain. Le luxe commercial ne serait pas à leur « goût » : il manquerait aux règles élémentaires du beau. Le manque de goût des produits de luxe aux griffes tapageuses coïncide avec la laideur des valeurs que ces enseignes incarnent.
La querelle du beau concerne aussi bien la forme que leur contenu. En effet, forme et contenu sont indissociables dans une équation, c’est bien ce qui fait la force esthétique de cet énoncé et de sa démonstration. Le beau est une idée que la commercialisation à outrance peut compromettre, celle-ci déçoit des étudiants formés à l’art et qui se veulent artisans. Enfin, le beau concerne aussi les idées et les formes de vie. Tout comme les élèves des écoles d’art, un nombre croissant d’étudiants dans des grandes écoles comme l’Agro ou même HEC s’inquiètent des conséquences pour l’environnement de leurs futurs métiers. Certains d’entre eux déclarent qu’ils ne veulent pas travailler pour Total ; pire encore, leurs métiers seraient « destructeurs ». Face à des idéaux en passe d’être trahis, ces jeunes vantent la beauté de la nature. La morale qu’ils veulent donner à leur existence est niée dans ses principes et il en est de même de leur esthétique de vie.
Ces étudiants veulent éviter l’état de dissonance dans lequel ils se trouveraient une fois en poste dans des entreprises qui, au sens fort du terme, leur déplaisent. J’ai le souvenir d’un étudiant qui avait suivi un cours que j’avais donné aux États-Unis il y a une dizaine d’années. Ce cours portait sur l’éthique des relations internationales. Ce jeune homme s’était distingué par la finesse de ses analyses et ses interventions. Cultivé, sensible et astucieux, il était un étudiant dont les travaux étaient exemplaires. Au terme du semestre, il était venu me voir et m’avait dit qu’il devait maintenant rembourser ses dettes : pour cela, il allait travailler tout au bout de la ligne du métro, à Wall Street. J’avais vu la gêne et la tristesse dans son regard. Il n’en avait pas le goût.
Favoriser la culture du beau
Le beau savoir est un bien qu’il faut préserver : il n’est ni de droite, ni de gauche, il correspond à des aspirations esthétiques, il est ce qui nous fait lire, apprendre et écrire.
Selon Hayden White, les goûts moraux et les goûts esthétiques sont les principaux moteurs de la connaissance, les raisons pour lesquelles, à tout âge, nous nous approchons d’une discipline ou d’une théorie. On aurait ainsi tort de surestimer le rôle des clivages politiques et sociaux, derrière eux se jouent d’autres façons de lire le monde et de l’apprécier, bref de faire des choix. Les individus sont assez grands pour décider par eux-mêmes de leurs préférences. Si l’on accepte cette proposition, il faut prêter une importance majeure à l’éthique du savoir comme à l’esthétique du savoir. Toutes deux méritent d’être cultivées.
C’est une excellente chose, il y a un débat important sur l’éthique des sciences et des sciences humaines, les résultats de ces travaux et de ces discussions ne sont pas toujours révolutionnaires, mais ils ont le mérite d’exister. En revanche, l’esthétique du savoir qui est « l’éléphant dans la pièce », un énorme non-dit de l’université, est une question rarement abordée. Elle est pourtant essentielle. Comment répondre aux aspirations des jeunes générations qui, en s’inscrivant à l’université, placent leur confiance dans cette institution et les personnes qui y travaillent ? Comment éviter de décevoir leurs attentes ?
Il faut prêter attention à la culture du goût dans les différentes disciplines qui peuplent nos campus ; celle-ci s’apprend et s’entretient. Une rengaine usée de la droite ? On se souvient des provocations d’Allan Bloom, cet amoureux des classiques et ce professeur de l’université de Chicago qui avait inspiré le truculent roman de Saul Bellow, Ravelstein. Aujourd’hui, un pas est franchi, et il ne provient pas vraiment des mêmes cercles. Peut-on apprendre à écrire de la théorie comme on apprendrait à écrire de la fiction ? Par exemple, à quand une poétique de la théorie littéraire ? Un tel débat devrait avoir lieu dans d’autres disciplines. La poétique de la philosophie ou de l’ethnologie est un fait, elle saute aux yeux dans certains textes et dans certaines conférences. Certains personnages de l’université sont poétiques, et l’humour, un autre trait esthétique, habite parfois les œuvres de nos savants et nourrit leurs performances (il n’y a qu’à lire les « romans de campus » de David Lodge). Pourquoi ne pas en prendre acte et y réfléchir ? Au quotidien, cela changerait la façon dont nous exerçons notre métier, la manière dont nous apprécions notre travail et le diffusons.
Forme et contenu sont liés, et le « contenu de la forme » compte beaucoup. Le choix d’un sujet se doit d’être original. Cela vaut aussi bien pour la fiction que pour la non-fiction, l’intrigue est le cœur d’un récit. La belle intrigue, celle qui surprend, est le reflet d’une richesse intérieure. Elle est le fruit d’une réflexion singulière et personnelle, là où les personnages qui sont les protagonistes d’un récit savant sont aussi intéressants qu’inattendus, là, où dans ce récit, se croisent plusieurs langues, en l’occurrence plusieurs théories. Nous gagnerions tous à discuter ces critères possibles d’un beau savoir.
NDLR : Ariel Colonomos vient de publier Le beau savoir aux éditions Albin Michel
