Faire de l’activité cognitive un objet d’analyse sociologique – relire Aaron Cicourel
L’essentiel de la carrière d’Aaron Cicourel s’est déroulé à l’Université de Californie, d’abord à Santa Barbara au sein du département de sociologie qu’Herbert Blumer, le père de l’« interactionnisme symbolique », y a créé en 1952 ; puis à San Diego, où il s’est installé pour fonder un département de science cognitive réunissant sociologie, philosophie, linguistique et psychologie expérimentale ; et enfin à Berkeley, au sein de l’Institut pour l’étude des questions sociales en tant que professeur émérite. À son arrivée à Santa Barbara au début des années 1950, Cicourel se lie à Harold Garfinkel, qui y était professeur assistant, avec lequel il travaille à un livre qu’ils ne finiront jamais. Erving Goffman, qui a été nommé à Berkeley en 1958, s’associe à eux pour s’opposer à la domination que le structuro-fonctionnalisme, et sa démarche quantitative, avait acquise sur la discipline à cette époque sous l’impulsion de Talcott Parsons[1].
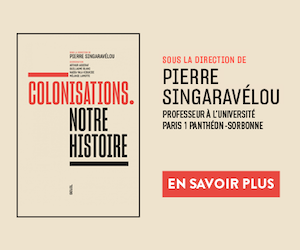
Petit à petit, l’Université de Californie devient la Mecque d’une génération de jeunes sociologues adeptes de la méthode ethnographique disséminés à travers les Etats Unis et étudiant la délinquance juvénile, la pauvreté, la drogue, la criminalité ou la marginalité[2]. Leurs travaux vont alimenter les pages de la revue Social Problems, fondée à Chicago en 1953, véritable creuset dans lequel un courant de recherche va asseoir sa légitimité : la « sociologie interactionniste de la déviance » dont la figure centrale est Howard Becker[3].
Une sorte d’unité d’apparence va peu à peu s’imposer entre les membres de cette soi-disant « seconde école de Chicago », favorisée par le dédain de l’establishment de la profession qui ne tolère pas sa critique du pouvoir explicatif des statistiques, sa contestation des institutions de soins ou de répression et son refus de mettre ses recherches au service des autorités qui les financent[4]. Cette sociologie de la « côte ouest » sera ensuite accusée d’être à l’origine de la remise en cause des pouvoirs établis, de l’opposition à la guerre au Vietnam, de la révolte étudiante et de l’émergence de la contre-culture[5].
Tel est, brossé à larges traits, le mouvement à la fois théorique er institutionnel qui a conduit à ranger les travaux de Cicourel et de ses trois comparses sous un label unique : l’interactionnisme symbolique. Cet enrôlement reste énigmatique pour qui se souvient que chacun de ces chercheurs a, pour des raisons différentes[6], publiquement désavoué cette qualification. Pour rendre hommage à l’itinéraire intellectuel d’Aaron Cicourel, je voudrais revenir sur une de ses étapes : celle qui l’a conduit à proposer de faire de l’activité cognitive un objet d’analyse sociologique. Je vais donc essayer de rappeler comment Cicourel a justifié ce projet, en précisant ce qui différencie sa conception de l’interaction et de celles de Becker, Garfinkel et Goffman et la manière dont il envisage l’exercice des capacités épistémiques dont les personnes sont naturellement dotées.
Figures de l’interactionnisme
Les recherches menées dans la perspective interactionniste partagent un certain air de famille. Elles obéissent en effet à deux grands principes. Le premier est de faire de la sociologie à partir de l’observation de ce que font les gens lorsqu’ils agissent ensemble et de l’analyse empirique de ce qu’ils en pensent à partir de ce qu’ils en disent[7]. Le second principe consiste à refuser d’expliquer les conduites individuelles en les subordonnant aux propriétés déterminantes de la structure sociale ou des rapports de pouvoir[8]. Ces deux principes conduisent les chercheurs à adopter une position de méthode : admettre que la continuité de l’action en commun tient bien plus à la reconduction séquentielle d’un accord tacite sur « ce qui se passe » dans les échanges entre partenaires d’une activité pratique qu’au respect mécanique d’un ordre normatif intériorisé (perspective déterministe) ou à une délibération entre individus rationnels débouchant sur une décision collective (perspective de la communication intersubjective). Cette position s’accompagne d’un corollaire : toute personne qui s’engage dans une activité pratique dispose de « capacités épistémiques » qui s’expriment directement dans la participation à une action en commun.
Les enquêtes ethnographiques menées sur cette base visent donc à répondre à une question : dans quelle mesure ces capacités épistémiques ordonnent-elles le flux des échanges sociaux ?[9] La réponse que Becker, Garfinkel, Goffman et Cicourel lui ont donné n’est pas la même. Elle dépend en partie de la conception que chacun d’eux se fait de l’interaction.
Pour Becker, celle-ci est l’unité élémentaire dans laquelle l’action en commun se déploie. Pour lui, le sociologue devrait se donner pour seule tâche de démontrer, à partir de l’observation directe de ce qui se passe dans les échanges, la validité de trois hypothèses : 1) c’est dans le cours même des interactions que les personnes qui y participent évaluent et actualisent la manière dont les contraintes propres à un type d’activité pratique doivent être respectées ; 2) cette évaluation et cette actualisation se réalisent nécessairement dans des situations qui fixent un cadre normatif particulier auquel ceux et celles qui y sont pris doivent ajuster leurs conduites ; 3) c’est dans le temps même de cette réalisation que les partenaires d’interaction accomplissent la coordination de leur activité conjointe. En empiriste convaincu, Becker a toujours refusé de s’aventurer sur le terrain, trop théorique à son goût, du rapport entre connaissance et action. Pour lui, cette tentation conduit à produire des interprétations sur la nature de l’activité mentale dont rien n’assure qu’elles puissent être empiriquement étayées. Ce n’est pas le choix qu’ont fait ses trois collègues.
L’analyse des capacités épistémiques des membres de la société que propose Garfinkel repose un postulat : il est impossible de séparer connaissance et action. Il pose en effet que l’instauration d’une telle séparation est une construction théorique qui n’a pas cours dans le flux de la vie ordinaire. Il adopte donc un point de vue « holiste », selon lequel l’agencement du monde, la vie sociale, le langage et le raisonnement pratique sont trop intimement mêlés pour pouvoir les dissocier. Tout cela vient ensemble : on apprend le monde et ses usages dans le temps même où on apprend les mots pour les nommer, les formules courantes pour en parler et les façons acceptables d’ajuster son action dans le fil des activités quotidiennes. Et cette familiarité avec le monde social se reflète dans la maîtrise du langage naturel. Pour Garfinkel, c’est ce qui justifie d’envisager l’interaction comme un laboratoire qui permet de documenter empiriquement l’existence de « structures formelles des activités pratiques »[10] qui guident l’accomplissement de l’action en commun et garantissent sa continuité.
De son côté, Goffman a mis l’accent sur le cadre à l’intérieur duquel une interaction se déroule : la situation[11]. Pour lui, toute personne qui s’engage dans un cours d’action le fait au titre du rôle qui lui y échoit et indique les règles qu’il lui faut respecter pour que sa façon de le jouer soit acceptable aux yeux d’autrui. Ce qui revient à dire que chacun des partenaires doit être attentif à ce qu’il est en train de faire afin de montrer qu’il respecte une série partiellement codifiée de normes, de conduite et de langage ; et parvient à dissiper les ambigüités qui naissent dans le déroulement incertain des échanges. Goffman conçoit donc l’interaction comme un ordre sui generis[12] qui oriente et contrôle la production mutuelle de cette intelligibilité des faits, gestes et paroles qui assure l’accomplissement séquentiel de la coordination de l’action en commun.
Il a essayé de rendre compte, dans Frame Analysis, de la structure de cet ordre et de la manière dont il organise l’expérience que les personnes font de la vie sociale. Sa recherche consiste à examiner les contraintes qui opèrent en deçà de la communication gestuelle et verbale et les découvrent dans le jeu permanent entre « cadres primaires » et « cadres secondaires » qui fournissent aux partenaires d’interaction des critères de jugement impersonnels et contraignants qui leur permettent d’ajuster leurs conduites aux circonstances changeantes des séquences d’action qui s’enchaînent sans fin. Pour Goffman, « les observateurs projettent activement leurs cadres de référence sur le monde qui se trouve autour d’eux et on ne le remarque pas parce que d’ordinaire les événements confirment ces projections, de sorte que les suppositions disparaissent dans le flot calme de l’activité.»[13] Ce qui revient à dire que connaissance et action se fondent totalement dans le flux des interactions.
Cicourel ne partage aucune de ces trois conceptions de l’interaction, auxquelles il adresse le même reproche : le fait d’exclure de l’analyse tout élément extérieur à son déroulement. Pour lui, toute interaction prend nécessairement place dans un monde où des institutions sociales (celles qui règlent la vie collective) et logiques (celles qui ordonnent les usages de la langue et le raisonnement ordinaire) préexistent aux individus et leur survivent – même s’il reconnaît que ces institutions ne sont pas immuables et qu’elles donnent lieu à des usages différents en fonction des circonstances. Telle est la position qu’il adopte dans le livre qui a fait sa renommée : The Social Organization of Juvenile Justice[14].
Cette enquête est née d’une interrogation directement héritée de ses premiers travaux au sujet de la méthode statistique. Examinant les données chiffrées de la délinquance juvénile dans deux villes californiennes présentant des caractéristiques socio-démographiques identiques, Cicourel est frappé par la variation des taux de criminalité qui y sont constatés. Pour résoudre ce mystère, il examine la manière dont ces statistiques officielles sont produites[15]. Il étudie les jeux de pouvoir entre la mairie, les services de police et ceux de la justice ; les directives imposées aux policiers en matière d’effectifs et de missions prioritaires ; les politiques suivies par les agents de la protection judiciaire de la jeunesse.
De cette enquête, il résulte que la disparité des taux de délinquance juvénile dépend uniquement de la différence entre modalités de l’activité répressive au plan local. Ce phénomène est aujourd’hui une évidence dans l’analyse des données de criminalité. Il en va de même pour la reconnaissance du fait que les modes d’intervention et les procédures mises en œuvre par la police et la justice ne sont pas nécessairement compatibles puisqu’elles obéissent à des impératifs pratiques dissemblables, et parfois contradictoires ; que la véracité des documents composant un dossier peut toujours être mise en doute puisque ce sont, en grande partie, des rapports et des notes traduisant par écrit des éléments de conversation ou des observations faites sur le vif ; et que ces documents font l’objet de multiples transformations au fil des rapports et des arrangements qui lient les professionnels aux inculpés et à leurs proches (jeu sur la qualification légale de l’infraction, chantage à la coopération, négociation sur l’incrimination, marchandage sur la peine, etc.).
Au delà de ces résultats, ce qui distingue le travail ethnographique de Cicourel est l’importance qu’il accorde aux formes de raisonnement pratique déployées par toutes les parties prenantes au traitement d’un cas de délinquance juvénile (policiers, juges, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, jeunes délinquants, avocats, parents, etc.). Il met en évidence les « théories ordinaires » d’après lesquelles une forme d’explication préconstruite au sujet de la délinquance, de sa nature, de ses origines, de la personnalité de l’inculpé, des principes moraux qui justifient sa sanction et de ses conséquences probables est formulée. Et démontre que l’existence d’un registre de description de la délinquance juvénile dont chacun peut supposer qu’il est partagé par ses interlocuteurs organise un univers d’action, structuré autour de faits, de concepts et de procédures que ceux et celles qui y interviennent utilisent pour régler leurs conduites.
Le raisonnement comme phénomène social
Cicourel a tenté de formaliser la place que tient le raisonnement ordinaire dans l’accomplissement de l’action en commun dans un livre qui, à ses dires, n’a pas connu un grand succès : Sociologie cognitive[16]. Il y rappelle les trois principes qui gouvernent ce raisonnement et dont les travaux sur le « savoir pratique » ont établi la validité : 1) la « réciprocité des perspectives », en vertu duquel chacun admet que ses partenaires agissent comme lui-même le ferait si leurs rôles étaient intervertis ; 2) les « formes normales », selon lequel chacun des partenaires corrige sur-le-champ les ambiguïtés qui naissent dans le cours de l’interaction ; 3) « l’et cetera », en raison duquel tout individu « cherche “prospectivement” dans des propos ou des descriptions immédiates le sens possible des allusions et des ambiguïtés en partant du principe qu’il peut insérer des significations maintenant en imaginant ce qu’il peut entendre plus tard. De la même façon, des propos immédiats peuvent venir éclairer des remarques passées »[17].
Cicourel ajoute à ces trois principes un quatrième de son cru, d’après lequel « les vocabulaires descriptifs sont des répertoires d’expériences passées (ou présentes) et reflètent donc les éléments du contexte original permettant ainsi d’aller au-delà de l’information obtenue si on se contentait de traiter chaque mot comme un terme du dictionnaire »[18]. Ce dernier principe traduit le souci d’inscrire l’interaction dans l’environnement social dans lequel elle émerge, en prenant en considération l’ensemble des facteurs qui lui sont extérieurs et en définissent les contours (les politiques publiques, les contingences matérielles, les réglementations professionnelles, le ressorts psychologiques, l’état des mœurs, etc.). C’est cette volonté d’intégrer dans l’analyse de l’action sociale tous les phénomènes qui se combinent dans sa réalisation qui a conduit Cicourel à œuvrer à la création du département de science cognitive à San Diego. On retrouve la marque de cet engagement dans ses derniers travaux sur la pertinence de chacun des niveaux d’explication des conduites humaines que proposent les sciences sociales et comportementales[19].
À l’heure où les sciences cognitives revendiquent le monopole de l’explication dans ce domaine[20], il serait peut-être opportun de relire les analyses de Cicourel sur l’organisation sociale du raisonnement pratique. Celles-ci ne sont pas, comme cela a été avancé, « mentalistes »[21]. Elles ne réduisent pas le cognitif au neuronal ou au for intérieur, mais défendent, au contraire, l’idée que raisonner est une activité qui, parce qu’elle est ancrée dans une forme particulière d’action en commun, est sociale de part en part, puisque ses éléments premiers (concepts et catégories de pensée) et les opérations épistémiques qui le constituent (identification, mise en relation, inférence, révision) contiennent et reflètent les manières ordinaires d’être au monde et d’y agir d’une façon ajustée aux circonstances. La sociologie gagnerait sans doute à redécouvrir le modèle ouvert, intégré et dynamique du rapport entre connaissance et action que les recherches empiriques et théoriques de Cicourel lui ont légué.
