Contre l’absolutisme du narratif – storytelling (2/2)
En juin 2007, le romancier indien Amit Chaudhuri a créé un scandale en interrompant une conférence qu’il donnait à un groupe d’écrivains et d’universitaires internationaux réunis à Delhi. Il exprima son exaspération à l’égard du storytelling devenu dominant à l’échelle mondiale en s’écriant au début de son intervention « Fuck storytelling ! »
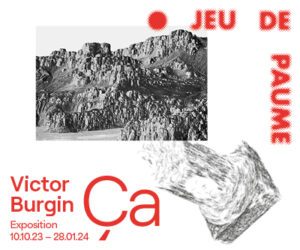
Une journaliste qui était présente a raconté qu’elle avait été « choquée », non par le juron prononcé par le romancier mais par cette attaque contre la narration qui avait joué un rôle libérateur (« empowering ») pour les peuples et les cultures. Le storytelling affirmait Amit Chaudhuri était désormais devenu « une vache sacrée que l’on insultait à ses risques et périls.»
J’ai pu constater au cours de la promotion de mon livre Storytelling, la machine à fabriquer des histoires, à la fin des années 2000, la difficulté d’avoir dans les médias comme dans le monde académique un débat sur les enjeux (politiques, médiatiques, mais aussi cognitifs et épistémologiques) de cette véritable tyrannie du narratif qui congédiait ou remisait dans les marges toute autre forme de symbolisation et de pensée. L’appétit pour les histoires était tel dans l’opinion que toute discussion sur le storytelling n’aboutissait qu’à faire l’éloge de ses pouvoirs et à contribuer à diffuser son magistère. Mon livre s’efforçait de faire l’inventaire de ces usages du récit et d’en montrer les enjeux cachés et il a contribué à les porter au jour et à les répandre.
La critique du storytelling a produit paradoxalement sa vulgate. En 2019, le mot storytelling est même entré dans le dictionnaire (le Petit Robert), une sorte de consécration pour cet anglicisme, assez plastique pour s’adapter à des contextes très différents et doté d’une sorte d’« aura » magique qui lui conférait attractivité et pouvoir. La série célèbre Game of Thrones n’affirme-t-elle pas ? : « Il n’y a rien au monde de plus puissant qu’une bonne histoire. Rien ne peut l’arrêter. Aucun enne
