Élection par temps de haine
Pour celles et ceux qui continuent à le pratiquer, le rituel du vote est une épreuve émotionnelle qui vient rappeler la sacralité du statut de citoyen et la charge de responsabilité qu’il fait peser sur ses épaules. L’excitation du votant quand il exprime sa préférence dans l’isoloir, attend le dévoilement du résultat le soir et s’époumone ensuite en criant « on a gagné » n’abolit pourtant pas un sentiment qui resurgit dès le jour d’après : ce jeu est pipé. Car voilà bien le mystère de l’élection : même quand les votants admettent que les « promesses n’engagent que celles et ceux qui les croient », il en reste encore qui y croient sincèrement à chaque nouveau scrutin.
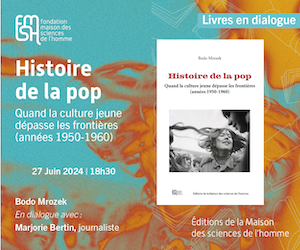
C’est ce mystère qui fait que l’expérience du vote reste, quels que soient le taux de participation et l’attention que les citoyens lui portent, celle d’une tension permanente entre croyance, désillusion et projection. Et cette tension est constamment ravivée par le fait que l’élection rythme la vie des régimes de gouvernement représentatif en conférant à une majorité sortie des urnes le pouvoir de faire la loi et de fixer les politiques publiques durant un mandat. Parfois, une consultation doit trancher une alternative tragique[1]. C’est sans doute le cas à la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale annoncée le 9 juin dernier.
Cette décision a plongé le pays dans une situation extraordinaire. Pas seulement parce qu’elle porte en elle la crainte de voir l’extrême-droite devenir majoritaire au Parlement, mais surtout parce qu’elle force les partis à se mettre en ordre de bataille dans une urgence inédite. Cette précipitation et la durée rétrécie de la campagne ont peu de chances de dissiper ce qui corrompt l’atmosphère politique du pays et risque de commander le vote : le ressentiment.
C’est qu’une somme inouïe de haines circulent dans l’espace public depuis une décennie : celles de Macron et de ses obligés, de Mélenchon et de ses affidés, des écologistes et de leurs appels alarmants,
