Faire moins avec moins ou comment saper le service public
Même en l’absence d’un gouvernement légitime et de plein exercice, les manœuvres pour libéraliser l’enseignement supérieur et la recherche continuent. C’est ainsi que la direction du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), obtempérant à l’injonction de transformer l’institution en agence de moyens, a décidé, le 12 décembre dernier, d’attribuer un label « keylab » à 25 % des unités de recherche qu’elle « opère » – reléguant ainsi le gros des chercheurs aux incertitudes d’une situation d’infériorité et d’abandon.
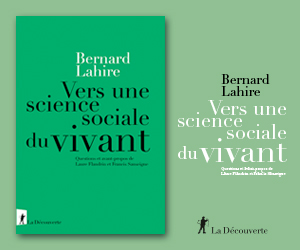
Dans le même temps, l’ancienne ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (et ex-présidente de l’université Paris-Saclay) a réuni un parterre d’administrateurs triés sur le volet pour les inviter à redoubler de zèle afin de mettre en application les dispositions de la loi de programmation de la recherche (LPR), promulguée en 2020, qui permettent de liquider le statut de fonctionnaire des enseignants-chercheurs, d’étendre leur temps de travail, de libérer les frais d’inscription et d’accélérer la sélection en éliminant les formations non rentables. Toutes mesures qui justifient l’amputation de cinq cent cinquante millions d’euros de l’enveloppe consacrée à l’enseignement supérieur (le « programme 150 » du budget) dans le projet qui a été suspendu avec la censure du gouvernement Barnier.
En dépit de la valse des ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à laquelle on assiste depuis que les gouvernements français ne durent que quelques mois, le programme de dépérissement des universités et de démantèlement de la recherche se poursuit au nom d’un impératif : restructurer un système que sa « démocratisation » aurait rendu empâté, obsolète et inutilement coûteux. Et la découverte fortuite de la dette faramineuse qui s’est accumulée, comme « à l’insu » des gouvernants, offre aujourd’hui l’occasion de relancer une proposition : réserver les rares deniers de l’État aux seuls secteurs considérés comme capables de soute
