Le destin malheureux et paradoxal de l’école française
Il y a plus de cinquante ans, la Finlande pris la décision de réformer son système éducatif. Elle transforma un système élitiste en une école démocratique, c’est-à-dire accessible à tous et garantissant aux publics scolarisés dans leur ensemble une réussite scolaire, culturelle, intellectuelle et morale suffisante, assurée à tous sans exception. Elle mit en place réellement ce que l’on appelle une école unique, ce qui avait échoué en France en 1947 avec la non-application du plan Langevin-Wallon.
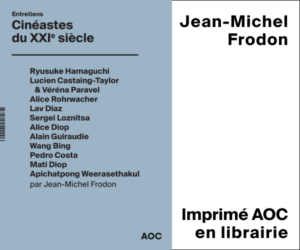
Une telle forme scolaire assure à tous les élèves, quelles que soient leur condition sociale et culturelle initiale déterminée par l’appartenance familiale, et le type d’insertion sociale ultérieure, une même formation intellectuelle, culturelle et morale, de l’âge de 5 ans à celui de 16 ans. Celle-ci se voit dispensée de façon à ce que tous en bénéficient sans discrimination et en éliminant par un encadrement éducatif puissant tous les facteurs dits d’échec ou de décrochage scolaires.
Cette formation scolaire universelle, réalisant ce que l’on peut désigner comme un socle commun de connaissances et de compétences, se voit sanctionnée par un diplôme de fin d’études primaires et secondaires que tous obtiennent. Après quoi, durant deux années, les élèves organisent leur insertion sociale et leur formation professionnelle ou supérieure en préparant selon leur choix les examens d’entrée en école professionnelle, en institut technologique ou à l’université. Ce faisant, la Finlande se sera hissée, par comparaison de ses résultats dans les tests internationaux PISA, au premier rang des systèmes éducatifs des pays industriels développés[1]. On pourra discuter longuement des valeur et validité de tels tests, ils n’en sont pas moins des indicateurs significatifs de l’efficacité globale des systèmes éducatifs nationaux.
Une telle orientation suppose une transformation importante du fonctionnement des établissements scolaires et l’abandon de la croyance exclusive que la forma
