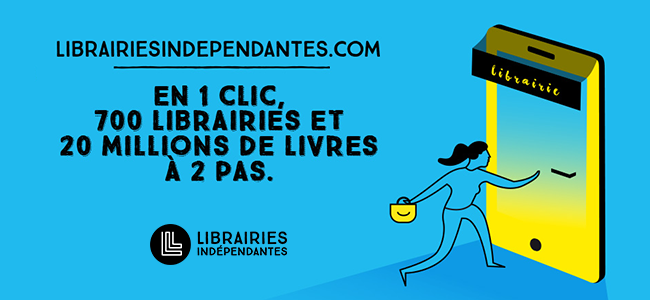Makers : quand la société se bricole elle-même
Si l’irruption d’Internet dans la vie quotidienne de millions de gens a pu susciter des prophéties enthousiastes ou inquiètes sur l’avènement d’un monde de plus en plus virtuel, la réalité se révèle bien plus contrastée. À rebours de la dématérialisation annoncée, on observe depuis plusieurs années une multiplication effervescente d’espaces physiques – des makerspaces – équipés d’outils, de machines, d’ordinateurs… dans lesquels des personnes se rassemblent pour mener à bien des projets de fabrication tout à fait concrets. En France, comme ailleurs dans le monde, il ne se passe pas une semaine ou un mois sans que de jeunes femmes ou de jeunes hommes n’entreprennent d’unir leurs forces pour créer ce type de lieu et donner vie à des communautés animées d’une même volonté de bricoler à plusieurs, d’inventer, d’échanger des savoirs et des astuces, parfois avec l’espoir de transformer leur environnement voire la société en son entier. Par-delà la diversité de leurs projets et de leurs aspirations, ils contribuent ainsi à la vitalité de que l’on appelle le mouvement maker.
La face technologique de ce mouvement est maintenant bien connue du grand public. Très médiatisées, les imprimantes 3D ont fait la preuve de leur capacité à fabriquer toutes sortes de choses, à commencer par des gadgets en plastique, mais aussi des objets bien plus utiles comme des prothèses médicales, des pièces industrielles, des plats alimentaires voire des maisons.
Si ces techniques de fabrication, parmi lesquelles on peut citer aussi les fraiseuses numériques ou les découpeuses laser, ouvrent indéniablement de nouvelles perspectives, ce n’est peut-être pas l’aspect le plus intéressant du phénomène maker. Celui-ci se saisit, certes, des potentialités du digital mais il constitue aussi un nouvel épisode dans une saga bien plus ancienne, celle des résistances à la société industrielle et du désir de reprendre la main sur les technologies qui ont des impacts sur nos vies.
Cette tradition, celle du DIY (Do It Yourself), a pris des formes diverses au fil de l’histoire : communautés puritaines désireuses d’autonomie au XVIIIe siècle, mouvement Arts and Crafts au siècle suivant, rébellion punk et invention d’une éthique hacker dans les années 1970, etc. Si l’esprit du DIY est porteur d’une critique radicale de la société industrielle, les pratiques qu’il suscite ont aussi la capacité de rassembler large, voire d’interpeller les dirigeants de ce monde, comme en témoignent quelques moments phare dans l’histoire plus récente du monde maker : création de la revue Make (2005), organisation de la première Maker Faire à San Mateo dans la baie de San Francisco (2006), naissance d’Arduino (2008), publication du Makers de C. Anderson et du numéro de The Economist consacré à la troisième Révolution industrielle (2012), annonce par le président Barack Obama d’une politique en faveur du développement de l’impression 3D (2013) qui célèbre à cette occasion la « Nation of Makers » que seraient les États-Unis.
Les makers restent porteurs d’innovations majeures dans des registres d’action techniques, économiques, juridiques, culturels, éducatifs très variés.
Dans un contexte où s’affrontent utopies technophiles et dystopies technophobes, où le débat fait rage sur les mots à employer pour caractériser le monde qui vient (capitalisme de plateforme, hypercapitalisme, gig economy, économie collaborative ou du partage, etc.), en France les espaces maker expérimentent, parfois discrètement, des manières de faire, de produire, de consommer et d’apprendre. En observant la réalité brésilienne des années 2000, le philosophe André Gorz a été l’un des premiers à entrevoir les possibles ouverts par la floraison d’ateliers coopératifs ou communaux, lieux d’expérimentation, d’apprentissage et de production, à la fois ancrés dans leurs territoires et interconnectés à l’échelle du globe, et où il serait possible de fabriquer « pratiquement tout le nécessaire et le désirable ». Si la sortie du capitalisme rêvée par A. Gorz paraît aujourd’hui plutôt lointaine, les makers n’en restent pas moins porteurs d’innovations majeures dans des registres d’action techniques, économiques, juridiques, culturels, éducatifs très variés.
Régulièrement présentés comme une des figures marquantes de la nouvelle révolution industrielle qui se déroule sous nos yeux, les makers innovent non seulement sur le plan technologique mais aussi économique et institutionnel. Leurs pratiques mettent à mal les principes et les catégories qui ont servi de soubassement au régime de croissance fordiste caractéristique des Trente Glorieuses. Travail et loisir, travail et formation, production et consommation… La pertinence de ces oppositions se dissout à mesure que, loin de l’univers productif habituel, les makers inventent de nouvelles manières de travailler et de coopérer, plus fluides, moins contraignantes, déconnectées des exigences de rentabilité immédiate…
Dans la philosophie maker, le travail peut et doit même être fun. Dans les makerspaces, apprentissage et activité productive s’entremêlent par ailleurs à tel point qu’il devient artificiel de les distinguer. À l’extérieur de ces espaces, les institutions de formation et d’enseignement commencent à enregistrer les effets du séisme. Issue du monde maker, une offre de formation originale se fait jour, qui émane des fablabs ouverts au cœur des universités et des centres de formation professionnelle ou encore d’écoles créées ex nihilo. Porteuses d’une pédagogie par l’expérimentation et par le faire, ces formations renouvellent en profondeur les formes de transmission des savoirs ainsi que leur reconnaissance par le biais des certifications habituelles.
Telle que l’expérimentent les makers, la fabrication numérique bouleverse également toute la chaîne de valeur. De nombreux coûts difficilement compressibles dans les usines traditionnelles et les industries de grande série fondent avec les innovations techniques (production à l’unité) et sociales (partage des connaissances, open source) dont ils sont porteurs.
La sortie du fordisme à laquelle participent de la sorte les makers s’appuie enfin sur un socle de convictions qui bousculent les façons de consommer. Le mouvement maker milite activement contre l’obsolescence programmée des objets en développant les activités de réparation et de recyclage mais aussi en concevant des objets faciles à monter et à démonter, et aptes de surcroît à vivre plusieurs vies.
Si l’émancipation citoyenne à l’égard des grandes organisations qui structurent largement nos façons de consommer relève encore de la promesse, de multiples forces poussent d’ores et déjà dans une telle direction.
S’il était déjà vivant dans les années 1970 grâce des créateurs comme Victor Papanek ou Enzo Mari, l’esprit du « design libre » qui se développe conformément à de tels principes fait aujourd’hui de chacun d’entre nous un concepteur potentiel apte à satisfaire ses besoins singuliers. Les frontières entre la production et la consommation sont devenus plus poreuses que jamais.
Si l’émancipation citoyenne à l’égard des grandes organisations qui structurent largement nos façons de consommer relève encore de la promesse, de multiples forces poussent d’ores et déjà dans une telle direction. Le droit est un levier particulièrement puissant pour cela. Avant même de produire quelques effets dans la sphère de la fabrication, la philosophie hacker avait servi de marchepied pour la sape des règles relatives à la propriété intellectuelle.
Des développeurs de logiciels puis des artistes ont ainsi défendu le principe du copyleft, néologisme forgé par opposition au copyright pour désigner la possibilité offerte à autrui par un créateur d’étudier, de modifier et de diffuser son produit (ou son œuvre). La seule condition est que ceux qui bénéficient d’une telle permission l’accordent à leur tour aux autres. Inspirées par cette philosophie du partage, de nombreuses licences ont vu le jour depuis le début du XXIe siècle. Elles couvrent une large palette d’activités matérielles et immatérielles. Si généreuse soit-elle, une telle option a fait polémique et elle continue de le faire. Comment éviter, en particulier, des usages « indésirables » de biens et de savoirs produits collectivement et mis à disposition de tous ?
Autant dire que le mouvement maker n’est plus, depuis plusieurs années déjà, une simple affaire de geeks.
À défaut de pouvoir répondre avec assurance à une telle question, il est possible d’affirmer en revanche que, dans la pratique qui est la leur, les makers remettent en cause l’opposition entre l’objet technique (défini par son utilité) et l’objet d’art (apprécié pour sa beauté). L’artisanat, et au premier chef l’artisanat d’art, sont de ce fait directement concernés par l’esprit maker. Grâce aux nouvelles technologies qui informent nos manières de produire et de communiquer, nous assistons à la naissance d’artisans numériques, femmes et hommes de métier capables d’allier le travail de la main et l’usage créatif des outils digitaux. Autant dire que le mouvement maker n’est plus, depuis plusieurs années déjà, une simple affaire de geeks.
Si les premiers fablabs, hackerspaces ou autres ateliers ouverts étaient de petite dimension, de nouveaux espaces beaucoup plus vastes s’ouvrent aujourd’hui avec pour ambition l’expérimentation à plus grande échelle des principes maker. Que ce soit dans des bâtiments industriels en voie de réhabilitation, au sein de friches artistiques ou même à l’intérieur d’espaces pour partie colonisés par des intérêts privés, ces foyers d’innovation accueillent et regroupent des artisans, des artistes, des travailleurs du numérique, des militants associatifs… qui s’insinuent dans les plis du tissu urbain pour mieux le transformer. Aux yeux des plus visionnaires, ces collectifs incarnent déjà la « fabrique de demain ». Mais il n’est pas en réalité de modèle prédéterminé. Les pratiques sont chatoyantes et les contradictions légion.
Le mouvement maker doit moins son pouvoir de transformation sociale à un militantisme actif dans l’espace public qu’à sa capacité virale à faire évoluer, de proche en proche, un certain nombre de codes profondément ancrés dans notre société. Les effets vont bien au-delà du terrain de la production et de la formation. Ce sont les fondements sociaux de nos institutions que les makers mettent à l’épreuve, non pas tant d’ailleurs en les minant activement et frontalement que, aux marges des grandes organisations, en inventant d’autres possibles pour vivre ensemble. Ce bricolage institutionnel fait la part belle dans les makerspaces au refus des hiérarchies et à des modes de gouvernance démocratiques. Les makers puisent pour cela à plusieurs sources d’inspiration comme la culture du consensus ou celle de la do-ocratie (le pouvoir à ceux qui font).
En tentant de donner vie à des principes politiques bien éloignés de l’autoritarisme jacobin à la française, les makers ont aussi appris, au quotidien, à composer avec de multiples tensions : volonté d’ouverture versus souci de cohésion interne, promotion de l’horizontalité organisationnelle versus besoin de coordination efficace, participation démocratique versus culture de la méritocratie technique, etc.
Le bricolage institutionnel dont les makerspaces sont les foyers actifs a aussi des effets sur l’environnement immédiat de ces lieux où, par le bas, se fabrique du changement social. La puissance publique nationale a bien du mal encore aujourd’hui à situer précisément ces espaces sur la carte des catégories qui lui sert à orienter son de l’action. D’autres acteurs servent heureusement de relais. Cela est vrai au niveau local où, à condition de ne pas simplement sacrifier à un effet de mode, de nombreuses collectivités territoriales ont déjà compris tout l’intérêt de ces communautés productives pour imaginer de nouveaux modes de développement. Mais cela est vrai aussi à un niveau international. Les makers sont aujourd’hui organisés en réseaux internationaux au sein desquels circulent des idées, des techniques, des financements… autant d’appuis précieux pour espérer entretenir durablement l’élan sur l’ensemble de la planète.
Soyons lucides : les makers constituent un monde social comme un autre. À ce titre, il ne faut pas leur prêter plus de potentialités de transformation que leurs ressources ne le permettent. À ce titre également, ses frontières sont incertaines et les tensions qui l’animent multiples. Les makers n’en ont pas fini par exemple de gérer l’opposition chronique entre technophiles d’un côté et militants politiques de l’autre. Ceux qui, de même, défendent avant tout la liberté de circulation de l’information ont encore du mal à fondre leurs espérances avec les partisans de l’écologie politique. Le spectre de la récupération de la culture maker par un capitalisme aux ruses éprouvées est toujours omniprésent dans les débats et les esprits.
Ainsi en est-il lorsque la Chine déclare Shenzen, ville-capitale de la production électronique, la capitale du développement des makerspaces chinois en 2015. En dépit de ces limites et de ces menaces, et à la condition de ne pas succomber aux illusions technologiques dont certains sont les vecteurs, prendre au sérieux ce que disent et ce que font les makers reste sans doute la meilleure option pour appréhender leur capacité à faire bouger nos pratiques et nos institutions et rendre ainsi justice à la façon dont, en permanence, la société se bricole elle-même.