Urbex, qu’est-ce que c’est ?
Faut-il définir une pratique qui se veut une conquête de libertés, porteuse de transgressions ? C’est en effet un des paradoxes de l’exploration urbaine (« urban exploration »), souvent abrégée urbex que de se situer en dehors de considérations légales et pourtant de susciter de nombreux débats sur les cadres formels qui doivent la régir. Hors la loi, mais non sans normes.
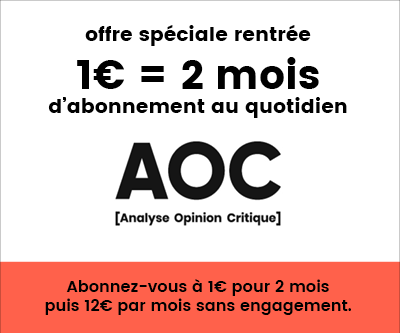
A vrai dire beaucoup ont fait de l’urbex sans le savoir, sans utiliser le terme ou sans même qu’il soit encore formalisé et diffusé, à la fin des années 1990 et dans les années 2000. L’exploration urbaine désigne en effet une errance, une visite sur des sites interdits, abandonnés ou marginalisés, de manière illégale ou du moins non-autorisée. Sous ce large manteau s’abritent en vérité des intentions et des méthodes fort variées. Toute définition trop stricte risquerait d’être peu opératoire. Il y a les aventuriers qui aiment le frisson de l’interdit ou du danger, qui réside autant dans la vétusté des installations que dans le risque de se faire attraper par les propriétaires, les gardes ou les forces de l’ordre. Il y a surtout les passionnés de l’esthétique photographique des ruines. La photo urbex est devenue un genre canonique qui suscite partout dans le monde des expositions et des albums, avec des sous-genre même, comme les photos de nus dans les ruines dont chacun pourra juger du bon goût, ou pas.
Une autre forme de pratique de l’urbex veut en faire une sorte de laboratoire politique pour lutter contre le contrôle urbain, pour desserrer les contraintes spatiales du monde capitaliste occidental. De véritables équipes pénètrent alors, dans cet esprit, différentes installations sans intentions autres que de s’y promener, même lorsqu’elles ne sont pas abandonnées, comme des lignes de métro ou des immeubles en construction. Les motifs pour urbexer sont ainsi nombreux et s’entremêlent souvent.
Pour que les lieux gardent leur aspect sauvage « urbexable », il faut qu’il n’y ait pas trop de visites et il convient de ne pas les livrer publiquement à d’éventuels pilleurs ou personnages mal intentionnés.
Les lieux abandonnés suscitent aussi des pratiques d’appropriation en particulier par les acteurs les plus jeunes, qui en font des murs pour graffer ou déployer d’autres formes de Street art sans contrainte aucune. Certains s’y aménagent même de véritables lieux de sociabilité ou campements temporaires comme j’ai pu le constater dans une école abandonnée du combinat pétrochimique de Schwedt dans l’ex-RDA, qui est mon terrain propre d’urbex (2017), où un groupe de jeunes de la ville se réunissait et avait construit un dispositif pour barrer l’accès aux zones qu’ils utilisaient, et que j’ai forcé sans le savoir. Ils m’ont ouvert, et même gentiment guidé avant que chacun retourne à ses occupations.
Chez les urbexers l’articulation du secret et du public mérite d’être analysée. Le Web est en effet un miroir de leurs exploits, pour ceux qui le pensent ainsi, ou bien un centre de ressources, pour ceux qui s’inscrivent dans une démarche d’accumulation et de savoir. Il faut donc rendre public, pour soi, pour la construction de soi, pour se situer dans l’espace virtuel de l’urbex, ou pour faire connaître ses découvertes. Mais en même temps une des règles de la pratique veut que l’on ne divulgue pas les adresses de lieux visités, ce qui implique aussi de masquer sur les photos les détails qui permettraient d’arriver à une identification. Les urbexers justifient cette règle par la nécessité de préserver les sites, tant à cause du risque qualitatif que quantitatif. Pour que les lieux gardent leur aspect sauvage « urbexable », il faut qu’il n’y ait pas trop de visites et par ailleurs il convient de ne pas les livrer publiquement à d’éventuels pilleurs ou personnages mal intentionnés. Sans cesse, sur les sites internet et les réseaux sociaux les demandes d’adresses se font rabrouer, parfois avec virulence, marquant ainsi le soupçon qui sépare le véritable urbexer de louches intérêts. Rares sont ceux qui considèrent l’urbex comme un partage ouvert d’expériences et de connaissances à l’échelle du web comme le site Abandoned Berlin qui non seulement donne les adresses, mais explique comment rentrer, avec quel degré de difficulté. Son auteur est même extrêmement serviable et m’a aidé à identifier une ruine berlinoise que j’avais visité il y a longtemps sans noter le lieu.
Trois autres règles sont généralement énoncées par les urbexers qui cherchent à définir leur pratique. L’une d’elle dit qu’il convient de ne rien forcer, casser ou briser pour entrer dans le site. C’est une règle à la vérité très morale, plus qu’un code pratique. En effet, beaucoup de sites abandonnés ont été fermés, voire murés, à un moment ou un autre. Il faut donc bien que quelqu’un, un jour, les ait forcés pour qu’on puisse les urbexer. Autrement dit, l’urbexer « légaliste » doit attendre que l’objet de ses désirs soit ouvert par quelqu’un d’autre. Tout praticien sait aussi qu’il s’agit souvent d’un jeu du chat et de la souris : les propriétaires et les autorités ferment, scellent, murent, certains trouvent une faille ou forcent, puis l’on referme, et ainsi de suite. J’ai eu de nombreuses expériences de cet aller-retour, ne pouvant retourner sur un site accessible rendu hermétique ou au contraire ayant le bonheur d’en voir un inaccessible « forcé » par d’autres après ma première visite. Pour ma part, j’ai respecté la règle pour l’essentiel. Je ne suis jamais allé plus loin que de forcer une porte par un coup d’épaule ou de pieds et extrêmement rarement, pour un site à intérêt historique particulier.
Une sentence se répète d’un site à l’autre, en différentes langues et avec des légères modifications de formulations : Ne rien laisser que des traces de pas, ne rien prendre que des photos.
Il y a une double justification ici. D’abord le respect des lieux que l’on visite : ne pas entrer avec bris c’est instaurer d’emblée un rapport différent d’une effraction pour des motifs cupides ou intéressés. C’est ensuite se prémunir plus facilement contre l’accusation, qui peut ne pas rester virtuelle, de violation de propriété privée avec effraction ou des délits de cet ordre. Cette définition d’une éthique de l’urbexer concerne ensuite la pratique même à l’intérieur du site : il convient de tout laisser en l’état et de rien dégrader. En ce sens les graffeurs ne s’inscrivent pas dans cette définition normative et morale de l’urbex. Enfin, la dernière règle veut que l’on n’emporte rien avec soi lorsque l’on quitte un site urbex : autrement dit un urbexer n’a pas d’intention mercantile, il n’est ni un pilleur, ni un collectionneur de souvenirs. L’idée qui préside à ces règles est que l’on laisse le site comme on l’a trouvé pour que l’urbex puisse se poursuivre. Une sentence se répète d’un site à l’autre, en différentes langues et avec des légères modifications de formulations : Ne rien laisser que des traces de pas, ne rien prendre que des photos. Il y a là, à notre sens, un rapport au lieu qui s’inscrit hors de toute réflexivité de sciences sociales, historique ou géographique.
En effet beaucoup de sites phares de l’urbex : casernes, usines, bâtiments administratifs ont été fermés depuis des décennies et ont connu depuis de nombreux autres usages que ceux pour lesquels ils avaient été érigés. Si l’on prend l’exemple des usines du bloc de l’Est, certaines ont été rachetées par des groupes ou entrepreneurs privées après 1990-1991, parfois plusieurs à la suite qui n’ont pas toujours occupé tout l’espace. Elles ont connu d’autres usages parfois successifs : discothèques, habitats précaires, lieu de sociabilité de bandes diverses. Autrement dit ces intérieurs sont extrêmement vivants et évoluent, quoiqu’en pensent les urbexers. Ils continuent à être pillés pour les ventes de métaux par exemple, abritent des sans domicile fixe par intermittence qui modifient aussi les lieux et des bandes ou des groupes qui les aménagent en repères de sociabilité. En ce sens, le lieu n’est pas une stase que l’urbexer aurait à préserver mais un lieu sans cesse modifié et modifiable. Une archéologue, Séverine Hurard, remarquait récemment qu’on pourrait très bien utiliser sa discipline pour y analyser les différentes couches d’occupation récente, l’histoire contemporaine même du site. La pratique en effet montre par exemple qu’une usine ou un hôpital abandonné peut recéler diverses strates d’objets ou d’archives échelonnées sur des décennies, témoignant à la fois d’usages et de temps multiples, pas toujours clairement dépliables par la simple analyse formelle ou de contenu.
Reste à mesurer les enjeux savants, sociaux et politiques de ces pratiques. A suivre.
NDLR : Nicolas Offenstadt vient de publier Le Pays disparu . Sur les traces de la RDA, un très beau livre qui repose notamment sur une longue expérience de l’urbex.
