Ce que devrait savoir le président
Il est prématuré de faire le portrait sociologique des « gilets jaunes ». À l’exception de quelques travaux en cours, tout ce qu’on sait provient essentiellement de ce qu’on savait d’avance des inégalités sociales à l’œuvre et plus encore des situations socio-économiques insupportables et souvent peu publicisées dans lesquelles tant d’individus appartenant aux milieux populaires se trouvent soumis. Aussi le mérite des mobilisations récentes a-t-il été de rompre l’indifférence sociale et politique dont souffrent celles et ceux qui vivent avec des revenus ou des salaires qu’ils jugent insuffisants. Face à ces revendications mobilisées de manières inédites et contradictoires, nombre de responsables politiques se sont dit surpris de découvrir tant de détresse. Nombreux sont celles et ceux reconnaissant n’avoir pas vu venir cette révolte sociale et politique, comme chez les observateurs – sociologues ou commentateurs – d’ailleurs.
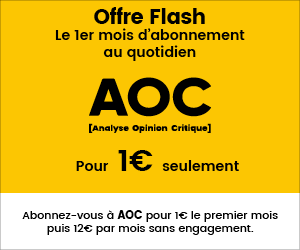
Et pourtant, les élu.e.s français.e.s disposent tout.e.s de moyens humains et de dispositifs dédiés à recueillir les suppliques et les requêtes de leurs concitoyens. Ces dispositifs sont périodiquement mis en avant par les représentants politiques eux-mêmes lorsque ces derniers entendent affirmer leur monopole de la connaissance de leurs concitoyens. Ils disent en effet entendre les Français, les comprendre, partager leurs préoccupations, bref pouvoir les représenter dans tous les sens du terme.
Les élus de la République sont les spécialistes de la proximité d’avec le peuple, les experts en problèmes concrets, les « fonctionnaires » du quotidien. Ils savent par le terrain, par les sondages, par leurs « capteurs », par leur métier, ce que pensent et ressentent « leurs électeurs ». Et si cela ne suffisait pas à étouffer la critique de la distance entre représentant.e.s et représenté.e.s, sont alors brandis les nouveaux outils du numériques qui, par milliers de tweets, de posts et de likes créent une sorte d’osmose, de lien direct, de familiarité même où tout le monde se suit, s’aime, se parle et se répond en direct.
À l’Élysée, ces mêmes mantras et dispositifs existent, si ce n’est que les moyens déployés pour recevoir les demandes des Français sont bien plus importants. Comme chacun le sait à peu près, la présidence de la République dispose d’une adresse-courriel et d’une adresse postale vers laquelle, sans qu’un affranchissement ne soit requis – jusqu’à 20 grammes – chaque Français.e peut écrire au chef de l’État. Tout comme l’appel téléphonique (une dizaine par jour contre 50 il y a 20 ans), le nombre de courriers a lui aussi décru. De presque 1,7 million sous les présidences Chirac et 1,3 million sous la présidence Sarkozy, il est passé à environ 1 million sous Hollande, soit plusieurs milliers par jour.
Certes, les échanges sur les réseaux sociaux ont, depuis plusieurs années, proliféré, et sont considérés dans le service du courrier comme plus aptes à permettre de déceler des « signaux faibles ». D’où cette formule d’un des principaux responsables du service : « On sait analyser le temps d’hier, pas celui de demain. » Il n’en reste pas moins que cette gigantesque masse documentaire constitue un formidable sismographe des préoccupations, des ressentiments, des émotions et des opinions individuelles et partagées des Français.
L’enquête que nous avons été autorisés à mener à la fin du mandat de François Hollande a consisté à analyser ces multitudes de lettres que nous avons lues en série et en détail. Nous pouvons affirmer qu’à peu près tous les milieux sociaux y ont recours, même si, faute d’avoir pu consulter tous les matériaux, nous ne sommes pas en mesure d’en établir les proportions.
Quotidiennement, le service de la correspondance présidentielle, composé de 70 agents environ, reçoit, classe et répond aux courriers qui leur parviennent. L’un des objectifs est de leur apporter au plus vite une réponse. Le plus crucial est de savoir ce qu’il faut porter à la connaissance du cabinet (appelé le Palais) et plus encore ce qui mérite d’être signé de la main même du président quand il s’agit de répondre. Cet objectif n’est bien entendu pas une mince affaire. À quel sujet faire « remonter » une lettre au PR comme l’on dit dans les services ?
Le classement effectué témoigne de la manière dont l’Élysée entend se saisir des interpellations qui lui sont faites. Schématiquement, une lettre ou un courriel envoyé est d’abord trié et répertorié à son arrivée dans une grande salle de tri équipée d’un scanner. Il est ensuite réparti en trois catégories : comme relevant du « service des affaires réservées » (les courriers des personnalités françaises et étrangères, les élus, certains chefs d’entreprises, les intellectuels, certains groupes d’intérêts, etc.), du « service bureau Madame » (les courriers adressés à la femme du président) ou du « service des particuliers ». Ce dernier bureau opère un nouveau classement selon cette fois le contenu du courrier. S’il est d’ordre politique, il est acheminé vers le service dit « opinion » où il recevra une réponse ad hoc argumentée. S’il s’agit en revanche d’une « requête », quand l’objet de la missive contient ce qu’on pourrait appeler une demande d’aide sociale, ou une plainte, inégalement articulée, il est, le plus souvent, renvoyé à d’autres administrations (ministères, services sociaux départementaux, etc.). Ce sont ces demandes qui constituent la plus grande partie des lettres reçues à l’Élysée.
Pour un politiste ou un sociologue, ce classement ne peut qu’interroger. Qu’est-ce qu’une lettre politique ? Qu’est-ce qu’une requête ? Certes, est généralement « politique » une expression qui interroge les choix de l’exécutif quand ceux-là se rapportent à la question de l’exercice de son pouvoir, à ses promesses antérieures ou à ses politiques publiques présentes. Pour ce faire, ces scripteurs font montre d’une aptitude différentielle à monter en généralité en vue d’interroger plus ou moins « courtoisement » ou « familièrement » le style, les manières de faire et le positionnement idéologique du locataire de l’institution présidentielle. Chaque fin de semaine et chaque mois, d’ailleurs, les agents du « service opinion » sélectionnent des courriers dits « représentatifs » en faisant attention à leur appartenance en termes de clivage gauche/droite pour les proposer à la lecture du chef d’État ou de ses collaborateurs. Ces courriers dits « politiques » constituent environ 20 % de l’ensemble du courrier.
Quant aux courriers et courriels qui paraissent cibler un problème social, administratif, fiscal et judiciaire de nature toute personnelle, ils sont acheminés quant à eux vers le « service des requêtes ». Pour ceux-là, une réponse rapide sera apportée. On pourrait l’assimiler à un secteur chargé de traiter les affaires sociales dans la mesure où il gère tous les courriers écrits par des personnes sollicitant l’intervention du président de la République au sujet de leurs allocations familiales, de leurs pensions de retraite, de leurs impôts, de leur dossier de surendettement, de leur contentieux avec une banque, bref de leur difficulté à vivre. Chaque jour, ces difficultés à vivre sont rappelées avec force et urgence par des individus menaçant de se suicider, après avoir, disent-ils, « tout essayé ». Ces appels au secours suicidaires sont traités en toute priorité.
La personne du président de la République fonctionne comme une figure centrale et emblématique d’un pouvoir souvent indéterminé auquel on s’adresse à propos de toute chose
Ces lettres sont non seulement pléthores, mais leur lecture, en plus de provoquer l’empathie des agents du SCP, est passionnante. Les contenus, en effet, peuvent être appréhendés d’une certaine manière comme des formes écrites, plus ou moins argumentées de ce que tant de « gilets jaunes » entendus ici ou là disent à voix haute.
D’abord, il est frappant de constater que la personne du président de la République fonctionne comme une figure centrale et emblématique d’un pouvoir souvent indéterminé auquel on s’adresse à propos de toute chose. C’est en ce sens une présidentialisation qui est moins constitutionnellement inscrite juridiquement parlant que profondément logée dans la vision ordinaire de citoyen.ne.s, dont certain.e.s sont pourtant dans l’évitement et « l’incompétence » politiques. Le président est le recours pour exprimer une situation qui est jugée économiquement et socialement insupportable.
« Il est 5h du matin et je suis épuisée. Je pleure de fatigue, je n’arrive pas à trouver le sommeil. Je leur ai demandé d’arrêter en vain, je leur ai dit vous voulez que je me pende à cause de vous, vous me poussez à bout de nerf […] S’il vous plaît aidez-moi, je demande de l’aide externe s’il vous plaît monsieur le président monsieur Hollande. » (Une jeune femme enceinte, vivant en province, qui connaît des difficultés sur son lieu de travail et réclame l’intervention de la médecine du travail [1].)
Ensuite, il est poignant de découvrir comment ces scripteu.r.se.s s’y prennent pour essayer d’attirer l’attention du président de la République et rendre à la fois sincère, urgente et impérieuse leur demande de soutien et d’intervention en leur faveur. Ces lettres, parfois très brèves peuvent aussi être parsemées d’arguments dont l’un des points communs est d’indiquer que les signaux de détresse envoyés émanent de gens méritants, courageux et prêts à tout, enlisés qu’ils sont dans « cette vraie vie », dans le quotidien le plus crasse en quelque sorte où la seule vie possible est de trouver le moindre euro pour manger, se loger, s’habiller et élever les enfants. Ce qui marque à la lecture de ces appels au secours est que beaucoup n’hésitent pas à joindre des détails chiffrés, des tableaux de comptes exhibant les tréfonds de leur existence, parfois de leur intimité, des extraits de comptes bancaires ou des examens médicaux voire des photographies montrant leurs corps en souffrance, pour apporter la preuve de ce qu’ils disent vivre et souffrir, pour qu’on les croie quand ils ont, chevillée au corps, l’angoisse de la faillite, de l’interdiction bancaire, de la perte de leur logement et de leur travail ; pire encore, de devoir abandonner leurs enfants à un triste sort.
« En cette dernière année de votre mandat, je constate que mes pensions de retraite (1 272 euros et 12 centimes mensuels) n’ont connu aucune revalorisation depuis votre arrivée au pouvoir. Soyons précis : la CNAV m’a accordé une généreuse augmentation de… 80 centimes en janvier 2016, tandis que l’IRCANTEC, à la même période, une augmentation de 35 centimes. Vous comprendrez que je ne remercie personne de cette situation. D’autant que dans ces mêmes quatre années écoulées, les augmentations ont été fréquentes pour les loyers, pour tous les services publics, pour les mutuelles, pour l’alimentation, etc. Je dois ajouter que la CAF m’a supprimé toute aide au logement en 2015 […] Je doute de votre capacité à réparer un tant soit peu cette injustice et ce mépris à mon égard et donc à l’égard de beaucoup d’autres de nos concitoyens […]. » (Un homme, retraité, vivant en province.)
Ces personnes modestes ne sont, de toute évidence, pas loin d’autres passages à l’acte possible comme celui qu’ont commis les « gilets jaunes ».
Ces lettres sont généralement respectueuses, détaillées, argumentées et appliquées. Les graphismes, les grammaires et les orthographes, s’ils varient selon les milieux sociaux, sont majoritairement des styles d’écriture populaires. Fréquemment, ils sont assortis de remarques implicitement désabusées au travers de formulations révélant la faible illusion quant à la possibilité non seulement d’être lu effectivement par le président de la République en personne, mais aussi que leur cause soit entendue ne fût-ce qu’administrativement. On écrit au président, mais on le sait lointain, protégé, filtré, embourgeoisé et trop coutumier des médias pour voir ce qui se passe au cœur de la France d’en bas.
« Je vous explique pourquoi je suis mécontent. Je suis chauffeur conducteur routier, avec la défiscalisation des heures supplémentaires, nous avons perdu 250 euros nets par mois. En plus de cela s’est ajouté une augmentation des impôts et de l’essence […] Faites le calcul, cela représente tout compris une diminution de mon pouvoir d’achat de l’ordre de 500 euros par mois. Sans compter les impôts… Seriez-vous vous prêt à diminuer votre salaire de l’ordre de 25 % comme cela va être le cas pour moi. Je ne le pense pas. Métez-vous un peu à la place de nous, des gens d’en bas (…) Je suis conscient que ce mail ne vous parviendra jamais, mais j’avais besoin d’exprimer ce que je rescent en sachant pertinament que cela ne servira à rien. Cordialement Mr le Président Hollande et avec tout le respect que je vous dois. » (Un homme, conducteur routier, vivant en province.)
Dans tous les cas, à rebours de thèses sociologiques affirmant que se mobiliser est un privilège que n’ont que celles et ceux disposant de ressources telles que du capital relationnel, réputationnel et professionnel, ces personnes modestes qui saturent ces services de l’Élysée plaident, portent et travaillent leur cause. Ils ne sont, de toute évidence, pas loin d’autres passages à l’acte possible comme celui qu’ont commis les « gilets jaunes ». En tout cas, en prenant au sérieux ce que nombre de Français.e.s écrivent solennellement au président de la République, à découvert, il est difficile de ne pas imaginer que la vie sociale et politique, après tant de décennies de rigueur économique, de libéralisme et de chômage a tout pour imploser.
« À l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux et de vous transmettre ma contribution à l’amélioration de la situation économique de notre pays. Vous trouverez ci joint un chèque de 1,44 euros correspondant à l’augmentation mensuelle du montant de ma retraite depuis octobre dernier. Plusieurs éléments m’ont poussé à prendre cette décision. Tout d’abord mon éducation, mes parents n’ont jamais demandé l’aumône […] Le comportement inapproprié, à mon sens, de grands patrons en général, et de bon nombre de politiques au regard de la situation financière de notre pays, m’a finalement aidé à faire ce pas […] Je pense qu’il est grand temps que les plus pauvres qui sont aussi les plus nombreux montrent l’exemple et fassent un geste certes petit, mais les petits ruisseaux ne font-ils pas les grandes rivières […] Chaque mois je vous adresserai ce chèque preuve de la volonté de prendre le taureau par les cornes […]. » (Une femme, retraitée, vivant en province.)
Nous avons pu constater aussi comment certaines phrases telles que celle concernant les « sans-dents » ont pu être reprises dans de nombreuses lettres, pendant plusieurs semaines et donner lieu à de multiples courriers, reprenant souvent la formule en exergue « c’est un-e sans-dents qui vous écrit », protestant contre le mépris social que ces Français.e.s ressentaient dans cette formule et engendrant des insultes répétées et multiples. Valérie Trierweiler, qui avait en effet fait de son ouvrage Merci pour ce moment (paru en 2014, il aurait eu 2 millions de lecteurs) un règlement de comptes avec son ex-compagnon, y écrit : « Il s’est présenté comme l’homme qui n’aime pas les riches. En réalité, le président n’aime pas les pauvres. Lui, l’homme de gauche, dit en privé : “les sans-dents”, très fier de son trait d’humour. » François Hollande avait par ailleurs tenu à répliquer dans Un président ne devrait pas dire cela (2016), en confiant : « Je lui ai dit : “je vois les gens qui viennent vers moi dans les manifestations, ce sont des pauvres, ils sont sans dents” ».
Que dire également de l’affaire Cahuzac où le mensonge d’un responsable politique au sujet de ses comptes cachés a exacerbé les procès pour mépris, mensonge et enrichissement ?
« Monsieur le Président, Démission de M. Cahuzac, mise en examen de l Agence du médicament, raid de petits malfrats sur un RER à Grigny, etc. décidément, la France de 2013 se décompose à grande vitesse et sa puanteur nous donne envie de vomir. Bien sûr, bien planquées dans leurs Palais, engraissées par l argent public qu elles gaspillent allègrement pour leur confort et leurs caprices, nos « élites » [les guillemets s imposent] ferment les yeux et veulent se persuader que tout continuera comme avant. L austérité, c est pour les autres ! Mais les Français ne sont pas idiots : ils étaient déjà convaincus de l incompétence, de l impuissance et de la corruption de leurs élus ; Ils commencent à comprendre, en outre, que lesdits élus ne contrôlent plus rien, et que la France est désormais gouvernée, comme toute la zone euro, par Mme Merkel [à cet égard, les politiciens français de 2013 nous font de plus en plus penser aux collabos de 1943…]. Mais l heure des comptes approche à grands pas. Seuls un aveugle ou un autiste refuserait de sentir la violence de la tempête qui s apprête à se lever dans notre pays. Vous prenez les Français pour un peuple résigné et passif, à qui vous pouvez tout faire avaler. Vous vous trompez, et le proche avenir vous le rappellera cruellement. Veuillez agréer, monsieur le Président, l expression de mes salutations distinguées. » (Un homme, vivant en province.)
Il suffirait d’actualiser les formules pour retrouver la trace du mépris ressenti qui se traduit chez nombre de « gilets jaunes » par des expressions de haine sociale.
Les courriers sont en effet décrits par les membres du service comme de « la vraie vie », « du concret », « on est dans l’aspérité », « ce sont des gens à histoire qui nous écrivent », mais aussi comme des réceptacles de la haine ordinaire qui s’extériorise dans des lettres de dimensions variées qui profèrent des insultes. Certaines d’entre elles, sous le quinquennat de François Hollande, étaient, selon les mêmes sources, particulièrement suivies sur demande de l’Élysée, celles concernant les « impôts » et la « question sociale ». Une sensibilité à la saisonnalité est prégnante dans le service du courrier qui note la rentrée scolaire, le temps fiscal et l’hiver comme moments-clés de la montée des requêtes et des récriminations. L’Élysée, contrairement aux quinquennats précédents, souhaitait la remontée des courriers qualifiés de « véhéments », de « virulents », mais les courriers de pure insulte, qui ne donnent pas lieu à réponse et qui constituent une faible part de l’ensemble, ne bénéficient pas de ce traitement.
Il suffirait d’actualiser les formules pour retrouver ici la trace du mépris ressenti qui se traduit depuis plusieurs semaines chez nombre de « gilets jaunes » par des expressions de haine sociale. Emmanuel Macron et certains de ses porte-parole ont manifesté depuis plusieurs années leur distance sociale, par des formules et des petites phrases parsemées, reprises comme autant de vignettes désormais évidentes : les « illettrées » de chez Gad, les « premiers de cordées », « la meilleure façon de se payer un costard, c’est de travailler », « les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien », « les fainéants et les cyniques », « certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d’aller regarder s’ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas », « pognon de dingue », « les Gaulois réfractaires », « venez me chercher ». Pour ne pas parler des traits plus récents de ses ministres : « Wauquiez, c’est le candidat des gars qui fument des clopes et qui roulent au diesel », ou les additions qui, « dans les restaurants parisiens tournent autour de 200 euros lorsque vous invitez quelqu’un et que vous ne prenez pas de vin », ou encore très récemment : « Nous avons été sans doute trop intelligents, trop subtils, trop techniques. »
Face à des questions que l’Élysée ne peut régler directement en raison de son incompétence administrative et de la séparation des pouvoirs, une fin polie et empathique de non-recevoir sera retournée. En certains cas, les services de la correspondance présidentielle se fera facilitateur des problèmes et réexpédiant les demandes auprès des administrations réellement qualifiées pour gérer ces requêtes.
Reste à savoir ce que le président de la République fait de ces courriers. Peu de choses à vrai dire. En premier lieu, parce qu’il ne peut matériellement et physiquement les lire tous, ses services les lui trient. Par exemple, le « service opinion » se charge de lui sélectionner chaque mois des « courriers représentatifs ». Ces documents qui sont confectionnés avec le souci de l’équilibre politique (des lettres émanant de la droite, du centre, de la gauche par exemple, indépendamment de leur proportion initiale), sont censés arriver sur le bureau du président. Mais il s’agit là de courriers manifestant une expression explicitement politique, de lettres souvent de lettrés sachant monter suffisamment en généralité pour accéder à ce qu’opiner politiquement veut dire.
Les endettés, les allocataires, les travailleurs pauvres et les sans-logements, parce qu’ils parlent de leurs problèmes et de leurs ras-le-bol, sont dirigés vers le « service des requêtes ». Au sein de ce service, l’enjeu n’est pas de se focaliser sur la misère du monde en vue d’alerter le président de la République sur l’état dramatique d’une partie de la société, même si nombre d’agents se disent bouleversés par ce qu’ils lisent et sont conscients que le monde va décidément mal dans certains endroits de la France. L’objectif est d’abord de traiter le courrier en vue de lui apporter une réponse rapide avec comme souci de rediriger les demandes sociales vers les services décentralisés ou déconcentrés de l’État jugés compétents. Certes, ces lettres de réponse reçoivent la signature électronique du président de la République et sont parfois portées à la connaissance d’un conseiller technique de l’Élysée. Dans ce flot incessant de courriers bien souvent désespérés, il faut trouver la lettre qui méritera, à côté des courriers réputés urgents d’élus, de personnalités, d’amis, de syndicalistes, de citoyens armés et éclairés politiquement, d’arriver sur le bureau même du président afin qu’il soit signé de sa main et, nec plus ultra, à laquelle sera adjoint un petit mot.
