Netanyahou – Orban, même combat ?
Lorsque le parti de Viktor Orban remporte, le 8 avril 2018, sa troisième victoire consécutive, avec près de la moitié des suffrages (et 133 sièges de députés sur 199), Benyamin Netanyahou se vante d’avoir été le premier dirigeant étranger à féliciter son homologue hongrois.
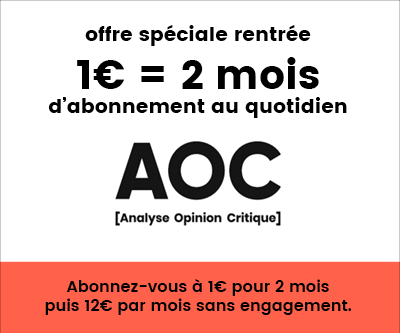
Orban a pourtant, quelques semaines plus tôt, prononcé un discours aux relents clairement antisémites, fustigeant « un adversaire qui est différent de nous. Il n’agit pas ouvertement, mais caché, il n’est pas droit, mais tortueux, il n’est pas national, mais international, il ne croit pas dans le travail, mais spécule avec l’argent, il n’a pas de patrie, parce qu’il croit que le monde entier est à lui ». La cible d’une attaque aussi violente est « le réseau des ONG financées par les spéculateurs internationaux, englobé et incarné dans la personne de George Soros ». L’hostilité à l’encontre de Soros, partagée entre Netanyahou et Orban, a sans doute scellé leur rapprochement, mais celui-ci apparaît désormais ancré sur des convergences bien plus profondes.
Deux populistes sans complexe
Netanyahou, en 2009, et Orban, en 2010, sont tous les deux revenus à la tête du gouvernement après une première expérience comme Premier ministre (de 1996 à 1999 pour le premier, de 1998 à 2002 pour le second). Ils ont tous deux mûri, durant leurs années d’opposition, leur détermination à conserver coûte que coûte le pouvoir, ce qui passe, en régime parlementaire, par le discrédit et la fragmentation de l’opposition, dont une partie est cooptée pour mieux invalider les prétentions de l’autre à gérer le pays.
De telles manœuvres politiciennes, somme toute classiques, s’accompagnent d’une offensive en règle, cette fois d’une intensité inédite, visant la Cour suprême, puis les organisations de défense des droits de l’homme, et enfin les médias indépendants. Ces contre-pouvoirs sont en effet accusés de s’opposer à la volonté du peuple, qui aurait été une fois pour toutes exprimée dans les votes de soutien au chef du gouvernement, Orban revendiquant même en 2014 le caractère « illibéral » de sa politique. Le rouleau compresseur « illibéral » transforme, en Hongrie comme en Israël, les milieux culturels « libéraux » en bastion d’une résistance plus symbolique que politique au pouvoir en place.
Des dynamiques tellement comparables participent d’un populisme de combat qui conduit à amender les textes fondateurs pour y inscrire une affirmation identitaire. La Constitution hongroise, adoptée en avril 2011 par les seuls députés du parti d’Orban, honore dans son préambule « la vertu unificatrice de la chrétienté pour notre nation». La Loi fondamentale, votée en juillet 2018 par 62 des 120 élus de la Knesset, définit Israël comme l’« État-nation du peuple juif » et supprime le statut de langue officielle dont l’arabe jouissait jusqu’alors aux côtés de l’hébreu (les « Arabes d’Israël » représentent un cinquième de sa population). Ce texte, qui ne mentionne pas une seule fois le caractère démocratique de l’État, revient aussi sur la « complète égalité de droits » promise lors de la Déclaration d’indépendance d’Israël, soixante-dix ans plus tôt. Le jour même de l’adoption de cette loi, Orban entame une visite officielle en Israël, durant laquelle Netanyahou multiplie les gestes amicaux, voire complices. Le Premier ministre hongrois s’abstient en retour de tout contact avec l’Autorité palestinienne, à la différence de ses prédécesseurs européens qui, conformément à l’engagement de l’UE en faveur de la « solution à deux États» (Israël et la Palestine), avaient toujours équilibré leur déplacement en Israël par des entretiens à Ramallah.
Sus au « multiculturalisme »
George Soros, né à Budapest en 1930, a été sauvé de l’Holocauste par un fonctionnaire hongrois, avant de rejoindre les États-Unis en 1956 pour y construire une fortune chiffrée aujourd’hui en milliards. Mais c’est son activisme philanthropique, notamment par le biais d’Open Society, qui suscite le courroux d’Orban et de Netanyahou. Celui-ci accuse Soros « de porter atteinte aux gouvernements israéliens démocratiquement élus en finançant des organisations qui diffament l’État juif » (Open society soutient en effet des ONG israéliennes de défense des droits de l’homme dont le Premier ministre veut brider l’action et la communication). Netanyahou voit aussi dans Soros le principal soutien international des « infiltrés » africains, un terme qui désigne en Israël les immigrants illégaux, majoritairement originaires d’Érythrée et du Soudan. Il rejoint là l’obsession d’Orban, qui pose Soros en maître d’œuvre d’une politique d’implantation en Hongrie de réfugiés largement musulmans. Dans cette vision vite teintée de complotisme, Soros le cosmopolite serait l’agent d’une subversion « multiculturaliste » de l’identité chrétienne de la Hongrie et de l’identité juive d’Israël.
Ces débats trouvent un formidable écho aux États-Unis, où Soros, très engagé au profit de Barack Obama lors des campagnes présidentielles de 2008 et de 2012, est devenu une des « bêtes noires » favorites de Donald Trump. Là encore, l’accusation majeure repose sur un encouragement supposé à l’immigration illégale. Rien d’étonnant dès lors à ce qu’Orban, et plus encore Netanyahou, aient été confortés par l’entrée de Trump à la Maison-blanche et encouragés, de ce fait, dans leur campagne anti-Soros.
L’autre cible d’une telle campagne est le « multiculturalisme » que prétendrait imposer l’Union européenne, à la fois au niveau de la technocratie de Bruxelles et du tandem franco-allemand, aujourd’hui incarné par Emmanuel Macron et Angela Merkel. Le Premier ministre israélien établit un amalgame douteux entre les complaisances supposées de l’UE envers l’immigration musulmane et les injonctions de la même UE à l’arrêt de la colonisation israélienne en Cisjordanie. Reçu en juillet 2017 à Budapest par les dirigeants du « groupe de Visegrad » (Hongrie, Pologne, Tchéquie et Slovaquie), Netanyahou prédit même « la décomposition et la disparition » de l’Europe si celle-ci persiste dans sa politique actuelle envers Israël. Une rhétorique aussi agressive se double d’une compréhension sans précédent envers les dirigeants populistes de l’Italie et de l’Autriche (où l’extrême-droite du FPÖ participe au gouvernement, ce qui avait suffi à Israël en 2000 pour rappeler son ambassadeur à Vienne).
La réécriture de la Shoah
Netanyahou franchit un nouveau stade dans sa complaisance envers Orban et ses émules européens en acceptant de réécrire l’histoire de la Shoah et de la rendre plus conforme aux « grands récits » que les leaders populistes entendent élever au rang d’histoire officielle de leur pays respectif. C’est ainsi qu’Israël endosse, en juin 2018, un communiqué conjoint avec les autorités de Varsovie selon lequel le gouvernement polonais, exilé à Londres lors de la Seconde guerre mondiale, aurait institué un « mécanisme d’assistance et de soutien systématiques au peuple juif ». Netanyahou offre ainsi une porte de sortie au gouvernement polonais enlisé dans la querelle sur sa propre loi mémorielle, visant la criminalisation de toute mise en cause du peuple polonais dans la Shoah. La manœuvre du Premier ministre provoque un véritable tollé en Israël, où les historiens de Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, mettent en garde contre le risque d’un « dommage sérieux à la mémoire historique de l’Holocauste ».
Il en faudrait plus pour dissuader Netanyahou d’accomplir un geste comparable envers Orban dont le « musée de l’Holocauste», à l’ouverture prévue en 2019, exonère le régime collaborationniste, au pouvoir à Budapest jusqu’en 1944, de toute responsabilité dans l’extermination nazie des Juifs de Hongrie. Comme dans le cas du révisionnisme polonais, c’est de Yad Vashem qu’émane la critique la plus cinglante de cette « grave falsification de l’Histoire». Gageons qu’il en importera peu à Netanyahou, qui mène sa « campagne d’Europe » et de soutien aux populistes à la Orban en parallèle de sa propre campagne pour les législatives anticipées du 9 avril prochain. Le Premier ministre a transformé, comme Orban un an plus tôt, ce scrutin parlementaire en véritable référendum sur sa personne. Il mise dès lors sur la polarisation de l’opinion, alimentée par des clivages volontairement caricaturaux, et sur des repoussoirs éprouvés (Soros, l’Europe, l’immigration et, naturellement, les Arabes).
La « campagne d’Europe » de Netanyahou n’est pas sans rappeler sa « campagne d’Amérique », où il avait mobilisé ses soutiens au Congrès et chez les évangéliques contre Obama, pourtant le candidat favori des Juifs américains. Mis en échec en 2008 et 2012, l’actuel Premier ministre israélien avait pu crier victoire lors de l’élection de Trump en 2016. Il croit aujourd’hui qu’une vague populiste lors des élections européennes de mai 2019 peut déstabiliser Bruxelles, Paris et Berlin, offrant, à ses yeux, une opportunité historique de renverser la politique moyen-orientale de l’UE. C’est pourquoi il mise ouvertement sur Budapest et Varsovie, ainsi que, dans une moindre mesure, Rome et Vienne. Encore faut-il, pour réaliser un aussi formidable dessein, qu’il soit reconduit à la tête du gouvernement israélien en avril prochain. C’est ainsi que s’entremêlent les échéances en Israël et dans l’UE, débouchant sur un authentique choix de société, ici comme là-bas, là-bas comme ici.
