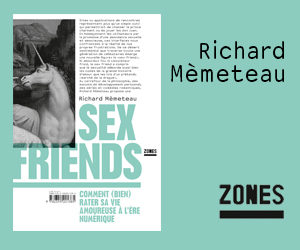La contre-insurrection qui vient
On ne sait encore ce qu’il adviendra du mouvement dit des « gilets jaunes », mais on peut d’ores et déjà affirmer qu’il aura agi en son corps défendant comme un révélateur de la brutalité de la doctrine du maintien de l’ordre en vigueur en France aujourd’hui – une violence qui s’exerce aussi bien par l’intermédiaire de la convocation d’un arsenal juridique inédit et particulièrement répressif, que par le recours à un armement militaire face aux manifestants.
Depuis le début des manifestations hebdomadaires, au moins 2000 personnes ont déjà été condamnées – un chiffre élevé, mais qui fait véritablement froid dans le dos si l’on considère que 40% d’entre elles l’ont été directement à des peines de prison ferme. La LDH parle de 2000 blessés, et à la date du 11 janvier quatre-vingts trois personnes avaient déjà été gravement touchées, dont 60 directement à la tête, par les LBD et les grenades GLI-F4. Le Conseil d’État rejette la demande d’interdiction de ces armes le 1er février, la France est poliment rappelée à l’ordre par le Parlement Européen le 14 février, et les choses semblent s’être arrêtées là. Le décompte des blessés a disparu des journaux. Pendant que l’on se demande s’il est bien légitime de désobéir en démocratie, les gouvernants renforcent une doctrine qui privilégie la conflictualité sur la désescalade.
Ces faits contrastent avec les récits qui en sont faits sur certains médias, chaînes d’information continue en première ligne. La violence qui ferait scandale, ce ne serait pas celle que les « gilets jaunes » subissent, ce serait celle qu’ils commettent, celle qui vient se greffer à eux – le black-bloc, en particulier – et dont ils se rendraient par conséquent complices. Le procédé n’est pas nouveau. La piqûre de rappel que nous administre Michaël Fœssel dans son dernier ouvrage, intitulé Récidive 1938, est de ce point de vue tout à fait opportune : dans un contexte où il était déjà question « d’assouplir » la durée légale de travail, de « lier politique sociale et immigration », « de mettre enfin en œuvre la “réforme de l’État” », de rappeler que « sur le terrain de la paix sociale il ne faut plus admettre aucune illégalité sous aucune forme », la mission attribuée à la presse par le Président Lebrun consistait alors à « convaincre les lecteurs que “personne ne doit échapper à l’effort nécessaire et que tous doivent se résoudre au sacrifice momentané indispensable” ». Les années passent, la rhétorique reste.
Les discours qui se déploient pour condamner la violence de ceux qui résistent consistent invariablement à convoquer Max Weber et sa conception de l’État comme détenteur du « monopole de l’usage légitime de la violence. » Passons sur le fait que dans le texte de Weber l’État ne fait que « revendiquer » ce monopole (« un État est une communauté humaine qui revendique le monopole de l’usage légitime de la force physique sur un territoire donné ») ; l’idée qu’il s’agit d’imposer ici est qu’il n’existe aucune distance entre légitimité et légalité dans une démocratie représentative comme la France, qui s’appuie sur une conception positiviste du droit. Ce qui est légal est juste, ce qui est juste est légal : il n’est pas de norme extra-juridique à partir de laquelle on pourrait juger de la justice de la légalité. Emmanuel Macron, lorsqu’il affirme qu’il est inacceptable de parler de « violences policières » dans un État de droit, n’affirme pas autre chose que cette identité entre légitimité et légalité.
À défaut de dissuader, l’entêtement du gouvernement inquiète. D’autant plus que dans leur « Appel de Saint-Nazaire », les « gilets jaunes » eux-mêmes invitent à « assumer une conflictualité avec le système actuel » ; le mouvement se présente comme une « répétition générale » en vue de la prochaine grande crise du capitalisme – il s’agit d’être prêts, mais prêts à quoi ? Une insurrection ? Une révolution ? Difficile de ne pas avoir ces termes à l’esprit. Du côté de l’État, la tentation serait alors justifiée de confondre maintien de l’ordre et conduite d’une guerre révolutionnaire. Mais la difficulté des insurrections, c’est qu’on ne sait jamais vraiment quand elles commencent.
L’enjeu de l’état d’urgence était donc bien de cibler des ennemis politiques – des « séditieux », plutôt que des « terroristes ».
Le spectacle des acteurs figés dans leurs antagonismes laisse entendre une hypothèse, une anticipation, une peur exprimée à mots couverts par différents observateurs : et si l’armée remplaçait la police ? Il est vrai qu’avec son inscription dans la loi, l’état d’urgence perd son caractère d’exception. Et depuis la mise en place du plan « Vigipirate », les émeutes de 2005, les attentats, la majorité de la population serait préparée à voir l’armée jouer un rôle plus direct dans le maintien de l’ordre. Les peurs ont muté, et avec elles les exigences de sécurité. Le concept « d’ennemi intérieur » renaît de ses cendres Schmittiennes. Rappelons que l’inscription de l’état d’urgence dans la loi n’a pas accru les marges de manœuvre de l’Armée, mais celles de la Police. Rappelons aussi que les premières et principales cibles des forces de l’ordre au lendemain de ce bouleversement juridique n’ont pas été des fondamentalistes religieux suspectés de préparer des attentats, mais des écologistes, des anarchistes, et autres activistes d’extrême-gauche. L’enjeu de l’état d’urgence était donc bien de cibler des ennemis politiques – des « séditieux », plutôt que des « terroristes ».
En ce sens, la crainte de voir appliquées les techniques de la « guerre révolutionnaire » à la population semblerait fondée, à première vue. Cette doctrine, conçue initialement par des militaires Français lors des guerres de décolonisations (Indochine et Algérie en particulier), se définit de la manière suivante : « doctrine de guerre moderne qui met en œuvre des techniques de conditionnements psychologiques et d’organisation de l’espace susceptibles de transformer la population civile en arme de conflit ultime où la seule issue consiste à éradiquer un groupe désigné par son essence même » (Cf. D. Servernay et J. Raynal, La Septième Arme. Une autre histoire de la République).
Plongés dans des situations dites de « guerre asymétrique » (définie essentiellement comme une configuration dans laquelle « le faible » a déclaré la guerre au « fort »), les militaires Français ont été mis en échec parce qu’ils n’ont pas compris à temps que ces conflits nouveaux se remportaient davantage sur le plan des idées que sur celui des armes : « les opérations militaires ne devraient constituer que 20% du combat de contre-insurrection, le reste étant consacré à la politique », écrit le Général Petraeus dans sa préface de l’ouvrage de David Galula. Dans une configuration asymétrique, les « faibles » privilégient les opérations de terrorisme (essentiellement des attentats contre les « forts » et ceux qui les soutiennent parmi la population), de guérilla (embuscades, attaques d’avant-postes, etc.), et de propagande ; tandis que les « forts » privilégient le renseignement, la collaboration avec les populations locales, et la propagande.
Autrement dit, si « forts » et « faibles » ont la propagande en commun, c’est parce qu’il s’agit de ranger à son côté la population afin qu’elle se purge elle-même des éléments que l’on souhaite éliminer – « loyalistes » ou « insurgés ». Galula précise qu’il s’agit « d’identifier la minorité favorable, et l’organiser de façon à mobiliser la population contre la minorité insurgée. […] L’objectif principal à fixer pour la propagande loyaliste : prouver que le statu quo loyaliste est plus profitable à la population que la révolution prônée par les insurgés. » En ce sens, la population est à la fois l’objectif et le champ de bataille de la guerre révolutionnaire, et l’on peut trouver sans peine des similitudes entre « gilets jaunes » et communication gouvernementale au sujet de cet impératif pour l’un et l’autre camp de remporter la bataille médiatique des images, des discours, des interprétations.
La question de savoir si l’armée devrait remplacer la police n’a d’utilité que comme contre-feu médiatique, effet d’annonce destiné à mobiliser l’imaginaire raciste d’une certaine frange de la population.
Toutefois, quand bien même on pourrait retracer la généalogie de la doctrine du maintien de l’ordre en France grâce à l’étude des guerres d’Indochine et d’Algérie, cette approche ne semble pas pertinente pour comprendre ce qui se joue de nouveau aujourd’hui. Premièrement, parce qu’en se concentrant sur l’antagonisme entre « forts » et « faibles », cette grille de lecture nous amène à concevoir le déséquilibre en termes de moyens, alors que l’asymétrie relève tout autant – si ce n’est davantage – d’une opposition entre visibles et invisibles. Si le « fort » est désavantagé, c’est précisément parce qu’il n’a pas la possibilité d’utiliser toute cette force qui le caractérise a priori – il est au contraire contraint d’affronter le « faible » sur son terrain, avec des armes similaires.
Dans une guerre asymétrique, il n’y a donc ni fort ni faible, simplement des occupants visibles, identifiés, avec leurs points d’ancrages territoriaux (bases, avant-postes, aéroports, etc.) et leurs blasons (uniformes, drapeaux, emblèmes de compagnie, couleurs et formes de casque, etc.) ; et des occupés invisibles, fondus dans la population, qui poursuivent leur vie quotidienne lorsqu’ils ne combattent pas – dans leurs maisons, avec leurs vêtements quotidiens, etc. – de sorte qu’ils combattent comme ils vivent, ainsi que l’écrit Mao, « comme des poissons dans l’eau ». Or, sur ce point, la comparaison avec les « gilets jaunes » ne tient plus. Car il s’agit précisément là de revendiquer la visibilité, au point que l’uniforme qu’ils portent est devenu le symbole et le nom de leur mouvement ; même chose pour le black-bloc.
Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de combattre l’invisibilité – d’être vus, d’exister enfin dans l’espace public, d’occuper le terrain médiatique, de ne plus laisser aux gouvernants la liberté d’interpréter à leur guise la parole des gouvernés. Deuxièmement, parce que dans le cadre des guerres révolutionnaires, l’insurgé cherche à prendre le pouvoir ; ce qui n’est pas le cas des « gilets jaunes », qui ont parmi leurs objectifs déclarés une refonte et un assainissement des institutions (cf. « L’Appel de Saint Nazaire »). Troisièmement, parce que les militaires eux-mêmes ne semblent pas prêts à jouer le rôle de la Police sur le territoire national : les soldats n’y sont peu ou pas formés, leurs armes n’y sont pas adaptées, et plus encore, ce n’est pas inscrit dans les gènes de l’institution, dédiée à l’utilisation de la force contre un ennemi extérieur.
La question de savoir si l’armée devrait remplacer la police n’a d’utilité que comme contre-feu médiatique, effet d’annonce destiné à mobiliser l’imaginaire raciste d’une certaine frange de la population. Le basculement dans la dictature fait figure d’épouvantail, fantasme récurrent de la Ve République, par contraste avec l’ombre grandissante de l’État policier.
Car s’il y a bien une institution formée pour être au contact de la population sur le territoire national, pour y mener des opérations de renseignement, pour lutter contre « l’ennemi intérieur », il s’agit de la police. L’ouvrage de Rupert Smith, l’Utilité de la force, aide à mieux saisir ce qui se joue dans les nouvelles formes de conflictualité auxquelles font face les gouvernants. Il privilégie le concept de « guerre au sein des populations » à celui de « guerre asymétrique », afin de dégager les six caractéristiques suivantes aux nouveaux enjeux de l’utilisation de la force : les buts pour lesquels nous nous battons ne sont plus ceux de la guerre industriels, « mais des objectifs plus insaisissables, relatifs à des individus et des sociétés qui ne sont pas des États » ; « nous combattons au sein des populations […] et les médias jouent un rôle majeur » ; « les conflits semblent désormais sans fin » ; « nous combattons de façon à minimiser les pertes » ; « chaque fois, ce sont de nouveaux usages qui sont définis pour les armements anciens » ; « les parties sont principalement non-étatiques ».
Dans son approche, Smith saisit parfaitement deux faits fondamentaux : premièrement, que dans le cadre d’une guerre au sein des populations, l’emploi disproportionné de la force est contre-productif (« aucune action par la force ne sera décisive : gagner l’épreuve de force n’apportera pas l’adhésion de la population. Or, fondamentalement, il s’agit là de la véritable finalité de tout recours à la force dans nos conflits actuels ») ; deuxièmement, dans ce contexte, le maintien de l’ordre ne peut pas être une fin mais seulement un moyen : il s’agit d’obtenir l’adhésion de la population grâce à la sécurité qu’on lui procure. Le travail de Rupert Smith a beau se concentrer sur la dimension militaire de l’utilité de la force, il permet ainsi de saisir en filigranes les risques inhérents à la militarisation progressive de la police – au sens où elle s’équiperait progressivement d’armes de guerre, comme c’est le cas aux États-Unis ; dans la mesure où son champ d’intervention est la population du territoire national ; enfin, parce qu’elle est aujourd’hui susceptible d’être soutenue dans son action par un régime d’exception.
On peut interroger le bien-fondé d’analyser ainsi les mouvements sociaux par le biais de la guerre. Le fait est que l’État lui-même accepte et justifie cette approche : militariser la police, c’est désigner la population comme l’ennemi. Par l’utilisation qu’il fait d’armes de guerre dans la répression des mouvements sociaux, l’État lui-même élève les manifestants au rang d’insurgés, et déplace dans le même mouvement le curseur des moyens de maintien de l’ordre auxquels il s’autorise d’avoir recours. La violence étant contreproductive dans le cadre de « la guerre au sein des populations », les options retenues en termes de maintien de l’ordre semblent ainsi entraîner l’État dans une spirale dont on ne distingue pas l’issue.
Plus encore, si l’essence du politique ne peut être saisie que dans sa continuité ou sa réversibilité avec la guerre, que conclure alors du fait que l’État lui-même soustrait progressivement la chose publique à la délibération, en faveur d’une délégation de sa gestion par l’entreprise et les marchés ? Si l’État organise le suicide du politique, que conclure si ce n’est qu’un perpétuel « état de violence » (cf. l’ouvrage éponyme de Frédéric Gros) contre la population représente l’horizon du néolibéralisme ? Comment dès lors se préparer, en tant que gouvernés, à l’extension indéfinie de la contre-insurrection comme stratégie de gouvernement ?
(NDLR : Thomas Skorucak a récemment publié Le courage des gouvernés aux éditions du CNRS)