L’Europe, continent philosophique
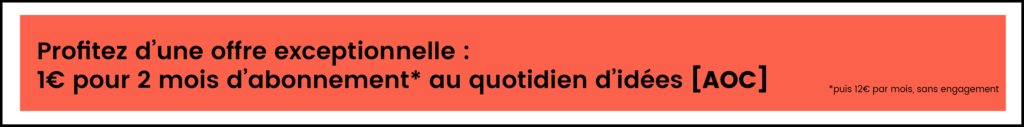
Quel sens y a-t-il, dans un moment dramatique pour le destin de l’Union européenne, à convoquer la philosophie ? Comment son langage séculaire peut-il interpréter les dynamiques contemporaines, qui semblent dépasser toutes les limites de la raison ?
La première réponse que je donnerais à cette question est que, face à des événements qui vont au-delà du plan des choix économiques et des arrangements institutionnels, et impliquent une véritable décision existentielle – celle de l’Europe en tant que sujet politique – la pensée ne peut pas ne pas être interpellée. Mais une réponse encore plus intrinsèque porte sur le caractère en quelque sorte philosophique de l’Europe elle-même. Comment définir un continent « philosophique » ? Je ne parle pas seulement du fait que ce que nous sommes habitués à nommer « philosophie » depuis plus de deux mille ans est né et s’est développé principalement en Europe. Mais aussi au fait que l’Europe elle-même s’est constituée dans un rapport nécessaire avec la dimension de la pensée.
Pour saisir ce nœud, il faut partir d’un manque. De ce que l’Europe n’est pas et n’a jamais été. Contrairement aux autres continents, l’Europe n’est pas limitée par des éléments géographiques stables : mers, rivières, montagnes. Elle n’a pas de frontières solides, du moins à l’Est, à l’inverse de l’Afrique, de l’Amérique ou de l’Océanie. Sa distinction d’avec l’Asie est problématique au point qu’au moins deux grands pays, la Russie et la Turquie, ont toujours été en équilibre entre les deux continents et ce qu’ils ont signifié dans l’histoire mondiale.
Mais ceci – cette contiguïté spatiale avec l’Asie – plutôt que d’entrainer une assimilation à son monde, a constitué un élément de distinction, voire de contraste, qui a été décisif pour la conscience de soi de l’Europe. Si l’on veut délimiter le moment de sa genèse, il faut le repérer dans les guerres des villes grecques contre l’empire perse. Comme Hegel l’a soutenu, lors de cet affrontement l’Occident est devenu pour la première fois plus qu’un simple point cardinal, ouvrant une histoire qui est encore loin d’être terminée. C’est précisément ce conflit – non seulement entre puissances militaires, mais aussi entre formes politiques et culturelles opposées – qui a déterminé une première couche de signification de ce que nous avons voulu dire pendant des siècles avec le nom « Europe ».
Depuis son émergence, la vie européenne a été inextricablement liée aux vicissitudes de la politique et au travail de la pensée.
À son origine, et constitutive de celle-ci, se trouve la revendication consciente d’une forme de vie politique – celle des poleis grecques – qui diffère fondamentalement de tous les autres régimes existants. Le fait que ce conflit, qu’il n’est pas arbitraire de définir aussi comme « philosophique », a sa propre signification politique spécifique traduit la correspondance originaire entre la formation de la polis et la naissance de la philosophie. L’une en face de l’autre et l’une dans l’autre.Depuis son émergence, la vie européenne a été inextricablement liée aux vicissitudes de la politique et au travail de la pensée. Comme cette dernière témoigne d’emblée d’une tendance à s’objectiver sous des formes institutionnelles, la politique se sépare de la violence nue, en se référant à des hypothèses de nature rationnelle. Bien qu’ils ne se chevauchent jamais, demeurant toujours en tension, logos et polis se développent selon des lignes qui se trouvent plus d’un point de tangence.
L’Europe en est marquée dès le départ sous une forme qui en conditionnera toute l’histoire ultérieure. Non déterminée par des frontières naturelles, la civilisation européenne élabore son propre profil sur la base d’hypothèses de nature rationnelle librement assumées. Naturellement, son histoire concrète se développe parfois en contradiction vis-à-vis ces mêmes principes — selon les besoins contingents, les intérêts matériels, les instincts de domination qui les délaissent souvent, au point de les renverser dans leur contraire.
Mais sans jamais se défaire d’une relation problématique avec eux, même au moment des crises les plus profondes. Même lorsque le logos est apparu accablé par des pouvoirs destructeurs. Au contraire, on dirait que c’est précisément dans ces temps difficiles que l’Europe fait retour vers la force constituante de la pensée, en rétablissant le fil de communication avec la philosophie qui a caractérisé son origine.
Cela s’est produit dans toutes les grandes crises qu’a connues notre continent : durant la période agitée qui a précédé la chute de l’empire romain, quand Augustin d’Hippone a posé les bases d’une nouvelle civilisation spirituelle. À l’ère des guerres de religion, lorsque Descartes et Hobbes fondent les principes de la science et de la politique modernes. Au tournant de la révolution française, interprétée par Kant et Hegel comme un événement aux effets philosophiques destiné à changer l’histoire du monde. Enfin, au cours des vingt années qui se sont écoulées entre les deux guerres, quand l’Europe a risqué d’être submergée par l’affrontement – à la portée métaphysique – entre totalitarisme et démocratie, qui ne devait se conclure qu’avec la chute du mur de Berlin.
Si tout cela est vrai, pourquoi ne pas imaginer, et même dans la situation actuelle – où une fois de plus, l’Europe risque d’être happée par la division et l’insignifiance – que la philosophie puisse indiquer, sinon une solution, du moins une nouvelle façon de voir les choses et même une direction à prendre ?
On a parlé de la dialectique entre la philosophie et la politique, constitutive non seulement de l’idée de Europe, mais de son existence historique même en tant que partie spécifique de la terre. C’est la dimension spatiale qui les a mis en relation, objectivant la philosophie dans des systèmes politiques concrets. L’Europe se perçoit comme un espace donné dans le monde et, simultanément, comme un point de vue sur lui. Depuis les guerres avec l’empire perse, ce que sera l’Europe, plutôt que défendant un espace déjà défini, elle le crée et le définit à chaque fois, en avançant la ligne qui la sépare de l’Asie. Alexandre puis Rome élargissent énormément cet espace, brisant les frontières précédentes et projetant l’Europe au-delà.
Après la rupture de l’unité chrétienne entre catholiques et protestants, un ordre se crée entre les États modernes, engendrant une situation d’équilibre dans laquelle chacun d’eux peut exercer son pouvoir indépendamment de celui des autres. L’exercice de la force politique sur son propre territoire, la particularité de l’ordre juridique et le droit d’imprimer la monnaie sont les prérogatives de ce que Jean Bodin définit comme « la souveraineté ». Elle repose sur la relation à double sens entre politique et espace dans laquelle l’une est l’expression concrète de l’autre. Le pouvoir, pour se manifester, a besoin d’un cadre territorial qui le rende efficace et le circonscrit. Chaque territoire européen appartient à son tour à un État qui le gouverne légitimement, indépendamment des autres.
L’Europe vit de la diversité de ses espaces intérieurs, tant que ceux-ci ne deviennent pas rigides dans leur séparation ou leur opposition mutuelle.
Depuis lors, l’Europe se considère comme un vaste espace constitué d’espaces plus petits, et très différents d’un point de vue linguistique, culturel et institutionnel. Une unité multiple, donc, et par là fondamentalement différente du despotisme asiatique, telle que l’ont défini Machiavel et Montesquieu, faisant allusion à l’hétérogénéité de ses régimes politiques. Cela constitue une relation de plus la liant, dans sa constitution très matérielle, à la philosophie, comme à ce savoir que plus qui tout autre a pensé la relation indissoluble entre identité et différence. Contrairement à ce que l’on peut croire, et comme le font valoir Hegel et Heidegger sous différents angles, non seulement identité et différence ne sont pas opposées, mais chacune est impensable en dehors de sa relation avec l’autre.
L’Europe vit de la diversité de ses espaces intérieurs, tant que ceux-ci ne deviennent pas rigides dans leur séparation ou leur opposition mutuelle. Mais pour qu’elle devienne pleinement consciente de sa place dans le monde, elle doit se mesurer à des espaces extérieurs. Je ne parle pas seulement du vieux continent asiatique, dont elle s’est séparé, mais du nouveau continent américain qui s’ouvre à un moment donné au regard, et à la domination, européenne. C’est alors, en traversant l’océan, que l’Europe commence à percevoir le monde comme une sphère et soi-même comme faisant partie d’un tout infiniment plus grand. Pour la première fois, elle commence à affronter son propre « extérieur ».
Le fait même de le définir comme « propre » exprime, avec la conscience de sa propre identité, la violence appropriative d’une conception qui conditionnera la conscience européenne pendant quatre siècles. Naturellement, ses philosophes les plus sensibles – de Las Casas à Montaigne – ressentent l’illégitimité de ce point de vue et ouvrent une réflexion fondamentale sur les limites de ce que l’on pense être la seule civilisation existante. Avec eux, la perspective européenne acquiert une dimension autocritique qui vient remettre en question de manière radicale sa revendication hégémonique sur le reste du monde.
Dans les Lettres persanes, pour la première fois, Montesquieu s’efforce de regarder l’Europe de l’extérieur. Mais déjà dans la pensée de Giordano Bruno, la perspective eurocentrique s’était brisée en un nombre infini de points de vue, tout comme infinis apparaissent les mondes d’un univers illimité. Après Galilée et Copernic, personne ne peut plus nier le caractère sphérique de la Terre. Et à la surface d’une sphère, il n’est pas possible de fixer un point central vis-à-vis duquel tous les autres sont subordonnés.
Les Lumières introduisent un élément encore plus radical dans cette perspective. Chez des auteurs tels que Voltaire et Rousseau, bien que différents l’un de l’autre, la raison entre dans une relation toujours plus déterminante avec le pouvoir. Une fois encore, et de manière de plus en plus marquée, la philosophie montre sa fonction constitutive dans la formation de l’Europe moderne.
La pensée de Kant se situe au sommet de cette tendance. Dans son ouvrage Qu’est-ce que les Lumières, il propose une relecture de l’évolution de l’Europe moderne à la lumière d’une raison qui tend à se répandre même en dehors de son espace. Le fait que, comme il le prétend, la violence commise dans un seul coin du monde affecte négativement toute la surface de la terre signifie que les frontières artificiellement conçues par la politique sont soumises à un jugement supérieur, fondé sur des valeurs non négociables. Le droit d’asile et le droit cosmopolite de tous ceux qui vivent dans le monde traduisent cette prise de conscience nouvelle et radicale dans l’élaboration politique de Kant. Avec lui, la sphéricité de la terre acquiert une connotation jamais reconnue jusque-là. Cela ne signifie pas seulement qu’aucun point ne peut prétendre organiser le reste de la planète à son avantage, mais aussi que tout homme doit pouvoir se déplacer partout sans perdre ses droits.
Que la terre soit une sphère signifie que les hommes peuvent se rencontrer et coexister sans s’opprimer les uns les autres, selon le régime que Kant définit lui-même comme « républicain ». Certes, on peut soutenir – comme le fera Hegel – que ces écrits kantiens, à partir de celui sur la paix perpétuelle, sont traversés par une veine utopique, dans un monde encore dominé par le pouvoir des États individuels. Mais nous ne pouvons pas ne pas reconnaître en eux un souffle universaliste qui investit les grandes questions de notre temps d’une intelligence qui paraît aujourd’hui engourdie.
Ce qui est en jeu dans l’opposition entre Kant et Hegel, est une question d’une extrême actualité – la relation entre l’ordre étatique et horizon global. En le reconstruisant, nous ne devons pas perdre de vue les termes historiques du problème et l’écraser sur notre perspective contemporaine. Comparé au projet cosmopolite de Kant, le point de vue de Hegel – qui place l’ordre étatique au sommet de la vie de l’esprit – est beaucoup plus en phase avec une époque historique caractérisée par la naissance et le développement effréné de l’idée de nation. Sans cela, l’État serait apparu comme un pur organisme formel, une coquille bureaucratique, dépourvue de la substance historique nécessaire pour réunir un peuple autour d’un même but. En ce sens, Hegel peut affirmer que l’État constitue la forme la plus complète de l’histoire moderne, entendue comme l’objectivation institutionnelle d’une pensée vivante.
La perte d’influence de l’Europe est-elle imputable à la catégorie de souveraineté, ou dépend-elle au contraire de son affaiblissement ?
Mais l’ordre politique qui paraît à son apogée durant cette période commence bientôt à montrer ses premières fissures. Le tournant est le passage de l’idée de nation, diffusée par la Révolution française, à celle de nationalisme puis d’impérialisme, destinées à entraîner l’Europe vers le totalitarisme et la guerre, comme en avertit Stephan Zweig, bientôt exilé, dans son « appel aux Européens » de 1932. Il est singulier que le moment de la plus grande expansion territoriale des puissances européennes coïncide avec la crise générale de l’Europe, bientôt surmontée, et écrasée, par la Russie et l’Amérique, comme Tocqueville en avait eu précocement l’intuition, et comme cela a été reconstitué par ce juriste allemand, aussi génial qu’ambigu, qui répond au nom de Carl Schmitt, dans le Nomos de la terre.
Mais cette perte d’influence de l’Europe est-elle imputable à la catégorie de souveraineté ? Ou dépend-elle, au contraire, de son affaiblissement ? A cette question, qui est au centre d’un large débat entre historiens, philosophes, juristes, il est nécessaire d’apporter une réponse pondérée. Du point de vue historique, l’idée de souveraineté a eu une importance incontestable dans l’histoire moderne, pas seulement en Europe. Sans États souverains, l’Europe moderne n’aurait pas résisté aux forces dissolvantes qui l’ont investie.
Ils contenaient à l’intérieur de leurs frontières des conflits de nature sociale, ethnique et religieuse qui auraient autrement détruit la civilisation européenne. Après tout, même aujourd’hui, l’État reste de loin l’organisme politique le plus répandu dans le monde, à l’extérieur et à l’intérieur de l’Europe. Cela n’empêche pas que, à partir d’un moment donné, marqué par l’effondrement de l’empire soviétique, il ne suffise plus à gouverner la dynamique socioculturelle qui a profondément transformé la planète, désormais mondialisée.
Ces dynamiques ont provoqué une profonde transformation des mondes vivants, qui ne peuvent plus être gérés à l’intérieur des frontières des États-nations, précisément parce qu’ils les dépassent à tout point de vue. Déjà, l’économie financière et l’informatique sont en elles-mêmes soustraites aux limitations territoriales, à l’instar des grands problèmes environnementaux. À cela s’ajoute, d’une part, la croissance exponentielle du flux migratoire et, d’autre part, l’explosion du terrorisme fondamentaliste islamique. Il est évident qu’aucun de ces phénomènes ne peut être confiné à l’intérieur d’organismes restreints. Ce n’est pas un hasard si les puissances qui dominent le monde d’un point de vue politique, militaire et financier sont bien des États, mais des États à dimension continentale, tels que les États-Unis, la Russie et la Chine. Dans cette situation, le seul espoir de survie de l’Europe face à la marée qui risque de la submerger est celui de son intégration politique.
Les raisons des difficultés rencontrées par une telle intégration sont connues. Le choix, qui s’est imposé dans les années 50, de limiter l’intégration à la sphère économique, s’est avéré dramatiquement erroné. Penser que l’unité politique suivrait l’économie, puis aboutirait à la constitution de la monnaie unique, était doublement illusoire. Tout d’abord parce que l’économie, comme le marché, a une étendue mondiale et non continentale. Ensuite parce que cela aura abouti, comme nous l’avons vu au cours de ces années de crise, à la suppression et au non-rapprochement des États européens sur la base de leurs intérêts respectifs. Mais une difficulté encore plus grande, car implicite à cette logique politique même, réside dans l’absence de constitution européenne, abandonnée après les référendums manqués de 2007.
Comme Habermas et d’autres l’ont fait valoir, une Constitution ne peut être que l’expression du libre choix d’un peuple souverain. Bien entendu, le fait qu’un peuple européen n’existe pas à l’heure actuelle n’empêche nullement qu’il puisse être progressivement “construit” par la formation d’une opinion publique consciente. Mais cette construction suppose à son tour la présence de médias européens et, avant cela, d’un langage commun, deux éléments qui font actuellement défaut. Dans cette situation d’impasse, où la Grèce a été mortifiée, et où un pays, à tous égards décisif comme le Royaume-Uni, a quitté l’Europe, la pression de l’immigration, avec la réponse régressive des nouveaux nationalismes, est en train de modifier toujours plus la situation, avec des résultats potentiellement dramatiques.
Nous pouvons dire que trois crises simultanées se superposent sur notre continent : une crise économique jamais complètement épuisée, une crise institutionnelle impliquant tous les organes de l’Union et une biopolitique qui engage sur les côtes européennes des décisions littéralement de vie et de mort, dans lesquelles est en jeu la civilisation que le nom de l’Europe a représenté au fil du temps. Mais c’est la démocratie elle-même qui est en crise, telle que nous la connaissons jusqu’à présent, dans un espace qui s’étend au-delà de l’Europe et concerne tout l’Occident. Ce qui s’effondre, c’est le paradigme libéral-démocrate qui caractérise depuis longtemps les gouvernements occidentaux. Le nœud qui lie depuis longtemps le libéralisme et la démocratie a été brisé, les poussant dans des directions divergentes et incompatibles.
Alors que le néolibéralisme apparaît de moins en moins démocratique, la démocratie introduit en son propre sein des germes illibéraux et autoritaires. Aussi parce que, si les États-nations sont régis par le droit public, le marché mondial ne connaît que le droit privé. De ce point de vue, la mondialisation anticapitaliste est nécessairement antidémocratique – extérieure au principe de la souveraineté populaire. L’Europe semble être traversée par trois clivages qui additionnent leurs effets négatifs. Le clivage économique entre le néolibéralisme atlantique et l’ordolibéralisme allemand, à l’origine du Brexit. Le clivage géopolitique entre les pays antirusses, tels que ceux nés de l’ancien empire soviétique, et de pays russophiles. Et le clivage institutionnel, qui traverse tous les pays de l’Union, entre partis traditionnels et mouvements populistes.
L’intersection de ces trois clivages a eu pour résultat la délégitimation sans précédent des institutions politiques européennes, accompagnée d’une pulvérisation du tissu social dans ses différents pays et d’une croissance vertigineuse des inégalités entre États et dans les États. Comment répondre à cette crise systémique réelle qui a envahi tout le continent européen, risquant de le pousser dans une impasse ?
Si fermer les frontières ouvertes par Schengen, selon les pulsions les plus régressives des souverainistes, ramènerait le continent des décennies en arrière sans résoudre, et même en aggravant, les problèmes qui se posent, la perpétuation du chaos actuel ne donnerait pas de meilleurs résultats. Ni l’immigration de masse ni le terrorisme ne sont possibles à appréhender avec les instruments, de plus en plus faibles, des États-nations – c’est-à-dire sans coordination des informations et des protocoles et de réception. L’unification des politiques d’accueil, l’intégration de l’appareil judiciaire pour les infractions terroristes, la création d’une police continentale pour le contrôle des frontières extérieures, la mise en place d’une politique environnementale organique sont tous possibles et nécessaires face à des problèmes qu’aucun État européen n’est capable d’affronter seul.
C’est précisément l’échec de l’économie et la faiblesse croissante de la politique qui peuvent rouvrir un espace, certes non décisif, mais non négligeable, à la réflexion philosophique.
Bien entendu, les mesures d’urgence ne suffisent pas, si elles sont détachées d’une politique et, avant cela même, d’un horizon commun capable de donner à l’Europe une perspective de développement et de réduction du fossé insoutenable entre les pays les plus riches et les plus pauvres – tout comme à l’intérieur de chaque pays. La stratégie nécessaire pour atteindre cet objectif doit reposer sur un double plan économique et politique entrelacé. En ce sens que même les mesures économiques – définition d’une politique monétaire différente, transfert de ressources et de capacité d’investissement à des pays plus faibles, accumulation budgétaire au service d’un développement concerté – devraient revêtir un caractère politique spécifique. Il s’agit de renverser la tendance des dernières décennies à la réduction de l’État-providence dans un projet néo-keynésien renouvelé – une sorte de plan Marshall non plus perçu de l’extérieur, mais mis en œuvre par l’Europe elle-même.
Seul un programme de cette ambition, qui relierait les pays européens de manière transversale, pourrait surmonter l’opposition lasse entre mondialistes et souverainistes qui affaiblit actuellement l’Union et ses membres. Démocratie nationale et démocratie européenne ne doivent pas être opposées mais superposées dans une nouvelle synergie. Est-il concevable que ce qui n’a pas réussi à s’organiser en plusieurs décennies se réalise en quelques mois sous la pression des événements ? Un tel doute en pousse bon nombre à déserter le front de l’intégration, en favorisant le populisme anti-politique et la montée des impulsions nationalistes dans toute l’Europe. Le climat anti-européen largement répandu dans les pays de l’UE décourage les partis survivants d’épouser ambiguïté avec la cause européenne.
Or, c’est précisément l’échec de l’économie, affaiblie par la crise, et la faiblesse croissante de la politique qui peuvent rouvrir un espace, certes non décisif, mais non négligeable, à la réflexion philosophique. C’est ce qui s’est passé dans toutes les phases critiques que l’Europe a connues. C’est seulement si elles ont été considérée comme une opportunité de transformation radicale, que les crises ont eu un effet constitutif, au-delà des répercussions négatives immédiates. Les guerres de religion n’ont-elles pas provoqué la création, au XVIIe siècle, du ius publicum europaeum ? Et la première idée de fédération européenne n’est pas née, à Ventotene, d’une guerre encore en cours ? Parfois, sous la pression de la nécessité, l’on se trouve obligé d’anticiper ce qu’il semble encore possible d’éviter ou de différer dans des temps meilleurs.
Si tel est le cas, ce que la crise économique n’a pas provoqué – un rééquilibrage général entre les différents pays par la création d’une banque européenne capable de venir en aide aux plus faibles, une unification de la politique étrangère et de défense, et même l’élection directe d’un président européen – pourrait aujourd’hui résulter de la crise de civilisation qui menace de marquer de son sceau les présentes années. Cela pourrait et devrait être la mission spécifique du « grand espace » européen au sein d’un espace global encore plus vaste : indiquer une alternative viable à la mondialisation actuelle, différente du capitalisme mondial américain et du capitalisme autoritaire asiatique. Enclencher un regard critique sur nous et sur les autres – sur la ligne inévitable qui les relie.
Que représente l’Europe, pour toute la durée de son histoire, sinon un point de vue sur le monde et sur son propre rôle dans le monde ? Même lorsque ce point de vue a été entaché d’égoïsme et de volonté de puissance, il n’a jamais perdu de vue une série de principes considérés comme indispensables.
De l’humanisme italien aux Lumières françaises à l’idéalisme allemand, la pensée européenne a toujours contenu un élément émancipateur se référant à des mesures d’égalité entre chaque être humain et chaque peuple. Pourquoi abandonner cette vocation justement alors que tous les hommes et tous les peuples sont unis dans le même destin, à la fois par les moyens de destruction massive et par les moyens techniques d’ouvrir de nouvelles possibilités au genre humain dans son ensemble ?
Revient alors la question, posée en premier lieu, de ce que peut être, et, avant même cela, de comment peut être formé un peuple européen. À l’heure actuelle, celui-ci n’existe pas, pas plus, peut-être, qu’un seul peuple n’existe-t-il encore dans chaque État. Dans chacun d’eux, deux peuples se font face, inégaux en ressources et en opportunités, souvent sans se rencontrer. Le futur peuple d’Europe ne peut naître que de leur rencontre. Et cela provient du changement de rapport de force entre ceux qui détiennent la majeure partie de la richesse pour eux-mêmes et ceux qui doivent se satisfaire des miettes. En revenir à nous interroger sur le moyen de sortir de cette situation, imaginer un autre continent et essayer de le réaliser, peut être, doit être, la tache future de la philosophie européenne.
NDLR : Ce texte de Roberto Esposito est publié dans le cadre d’un partenariat avec AOC en prélude de son intervention dans le cadre de la conférence « Le Jour d’avant : Une philosophie pour l’Europe », Séminaire d’Actualité Critique de l’ENS du jeudi 23 mai, gratuit et ouvert au public.
