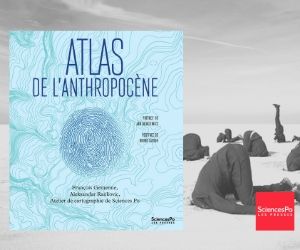Tunisie : joyeux cérémonial et triste bilan présidentiel
A quoi se mesure un bilan politique ? Comment le juger ? Doit-on, comme la presse tunisienne l’a fait de manière parfois caricaturale, célébrer le symbole, celui du président élu lors de la première élection au suffrage universel direct de l’histoire de la Tunisie, de l’homme à la tête d’un pays qui malgré toutes les embuches (économie déclinante et peu diversifiée, tourisme en berne, corruption, terrorisme, conflit libyen, enlisement régional…), est parvenu depuis huit ans à ne pas hypothéquer son destin démocratique ? N’est-il utile d’examiner avec attention les positionnements successifs d’un homme politique jamais très loin du pouvoir depuis l’indépendance en 1956, et la somme des rendez-vous manqués sous sa présidence ?
Il y avait quelque chose de désagréable, dans ces funérailles nationales qui étaient avant tout, certes, une manière pour les Tunisiens et le monde de célébrer leur pays, mais qui s’accompagnaient d’une chasse systématique au commentaire critique. Comme si le fait de ne pas honorer Béji Caïd Essebsi, président en exercice décédé le 25 juillet 2019 à l’âge de 92 ans, revenait à insulter la nation tunisienne. C’est pourtant tout le contraire : porté sur le devant de la scène dès le lendemain de la révolution sur proposition de plusieurs cadres de l’ancien régime pour tenter une synthèse entre la révolution et l’ordre ancien, « BCE » a davantage pesé sur le sort de la Tunisie post-révolutionnaire qu’aucun autre homme politique, hormis le dirigeant du parti Ennahda, Rached Ghannouchi.
Béji Caid Essebsi représentait cette personnalité d’un autre temps, à même de jeter un pont entre toutes les époques de la Tunisie indépendante.
Dans les faits, Beji Caïd Essebsi a concentré tous ses efforts pour limiter les effets de cette révolution sur son pays et le renouvellement de ses élites politico-économiques. Avec un certain succès : en dehors de la possibilité nouvelle pour les femmes tunisiennes d’épouser un non-musulman depuis septembre 2017, on est ainsi bien en peine de citer une seule réforme majeure qui porte le sceau de sa présidence. Le retard pris dans les réformes prévues par la constitution de janvier 2014 sont, eux, considérables, et en grande partie imputable à l’inertie de la présidence BCE. Heureusement pour la Tunisie, BCE perd ces deux combats, mais il se rattrapera les années suivantes
Pourquoi alors un tel hommage ? Peut-être parce Béji Caid Essebsi représentait cette personnalité d’un autre temps, à même de jeter un pont entre toutes les époques de la Tunisie indépendante. Pour paraphraser bien des textes et commentaires lus dans la presse et sur les réseaux sociaux depuis un mois, on apprécie l’ « homme public » parce qu’il représente la Tunisie et son histoire. Et l’on met de côté son bilan politique qui divise ce même pays et rappelle, au passage et de manière désagréable pour tous, les errements des partis politiques qui ont eu la charge des affaires publiques depuis 2011.
Directeur de la sureté nationale puis ministre sous Bourguiba, membre du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) après le coup d’État de Zine el Abidine Ben Ali le 7 novembre 1987, député puis Président du parlement sous la dictature de « ZABA », BCE fut, à la surprise de bien des observateurs, celui que l’on appela le 27 février 2011 pour chapeauter la période de transition et contribuer à mettre fin à la période Ben Ali. Son retour aux affaires en tant que Premier ministre se manifeste alors d’emblée de manière très claire : opposé au régime parlementaire, il tente d’imposer une élection présidentielle sous trois mois. Une présidence voulue à nouveau toute puissante, dans l’esprit des deux précédents régimes. Puis il s’oppose à la commission présidée par le juriste Yadh Ben Achour, qui réunit une large partie de la société civile et souhaite exclure les figures de l’ancien régime de l’élection législative programmée pour octobre. Heureusement pour la Tunisie, BCE perd ces deux combats, mais il se rattrapera les années suivantes. En 2012, il fonde Nida Tounes, un parti bâti autour de lui et pour lui, qui n’a d’autre but que de le porter à la présidence du pays.
BCE est cet homme politique qui, pour perpétuer sa domination, a constamment cherché à instrumentaliser la construction démocratique tunisienne.
A l’été 2013, au plus fort de la crise politique dans laquelle est embourbé le parti Ennahda, BCE – qui n’a alors plus aucun mandat électif ni responsabilité officielle – rencontre Ghannouchi à Paris, en tête à tête. Ennahda, qui a reporté les élections législatives d’octobre 2011, se révèle incapable d’administrer le pays de manière collégiale et fait face à d’importantes manifestations après l’assassinat de deux opposants politiques. L’annonce de la rencontre parisienne fuite, à dessein. Les deux hommes mettent en scène leurs pourparlers à Paris, censés apaiser les tensions à Tunis. Ce faisant, BCE réussi le tour de force politique qui lui assurera son élection l’année suivante : s’imposer comme le représentant du camp « moderniste » et circonscrire l’espace politique tunisien à un duel/duo entre son camp, porté par une bourgeoisie tunisienne en partie proche de l’ancien régime, et celui d’Ennahda, qui espère un regain de notabilité.
En 2011, le choix du mode de scrutin – la proportionnelle au plus fort reste – avait enterré d’avance les chances des nombreux candidats indépendants issus de la société civile, et pas un ne fut élu. En 2014, c’est ce duo Ghannouchi/BCE qui va annihiler celles de toutes les autres formations, incapables d’émerger sur la scène politique face à ces deux mastodontes, héritiers chacun de deux courants historiques. Ensemble, Ennahda et BCE asphyxient la scène politique tunisienne.
Elu en 2014, BCE accède à la présidence à la fin de l’année, à l’issue d’une campagne électorale où il affronte Moncef Marzouki, opposant historique et premier président de la transition, soutenu par Ennahda. Comme celle des législatives qui ont lieu la même année, la campagne fait figure de farce électorale : BCE et Nida Tounes font feu de tout bois contre Ennahda, accusé de tous les maux et notamment de livrer le pays à l’obscurantisme religieux. Une manière efficace de masquer l’absence de programme en singeant les clivages artificiels dont est friand une partie de la presse, tunisienne et occidentale. Nida Tounes fait ainsi le plein des voix à peu de frais en galvanisant son camp. Une comédie électoraliste mal vécue par beaucoup de Tunisiens, car les deux adversaires ne vont pas manquer de se retrouver ensuite. De fait, aucun des deux partis ne disposant du poids politique suffisant pour gouverner seul, l’alliance post-électorale entre les deux partis est alors inévitable.
La démocratie tunisienne souffre alors de ces affrontement factices entre deux blocs aux politiques finalement très semblables – conservatrices mais libérales du point de vue économique, favorable aux prêts des organismes internationaux – et qui se sont très bien entendus pour ne pas faire progresser la Tunisie sur la front de la justice sociale, de la transition écologique, de la réforme de la justice et du rééquilibrage économique des régions. L’un des exemples les plus marquants de l’absence de réforme de fond est le domaine de la justice transitionnelle : alors que BCE avait intégré l’ancien secrétaire général du RCD, Mohamed Ghariani à son parti dès sa sortie de prison, ses critiques contre l’instance vérité et dignité (IVD) ont fragilisé le projet, qui n’a pas eu répondu aux espoirs des lendemains de la révolution.
BCE est ainsi cet homme politique qui, pour perpétuer sa domination, a constamment cherché à instrumentaliser la construction démocratique tunisienne, et y est finalement parvenu. Peut-on oublier qu’il tenta d’imposer son propre fils à la tête de son parti, puis du pays ? Un choix qui contribua à faire exploser son camp politique, ce qui ne lui permit pas de mener à un bien son projet d’égalité successorale entre homme et femmes.
La période de la présidence BCE s’est révélée synonyme d’une dangereuse stagnation.
A sa mort, quel paysage politique lègue-t-il ? Celui d’un parti Nida Tounes en lambeaux, d’un héritage destourien (du nom du parti à la tête du pays après l’indépendance) morcelé, d’un parti Ennahda dominant. L’aura du mouvement de Rached Ghannouchi n’est certes plus le même qu’en 2011. Mais il effraye également beaucoup moins les tenants de l’ancien régime, et la déliquescence de son parti rival/partenaire, Nida Tounes, le laisse en position de force.
Si la période 2011-2014 a été celui des luttes et de l’accouchement laborieux mais salutaire d’une constitution porteuse d’espoir pour toute la région, celle de la présidence BCE s’est révélée synonyme d’une dangereuse stagnation, aussi bien sur le plan économique et social que politique. En témoignent les nombreuses manifestations qui se sont renouvelées chaque année dans les régions du centre et du Sud tunisien.
Si la Tunisie peut espérer reprendre cours de sa révolution en panne depuis la vote de la constitution en janvier 2014, la disparition de BCE devra être l’occasion d’ouvrir une nouvelle page de l’histoire politique du pays, celle de l’émergence de nouvelles figures capables de mener à bien les réformes prévues par le texte constitutionnel (décentralisation, lutte contre la corruption, justice, économie…) et dont dépend l’avenir du pays.