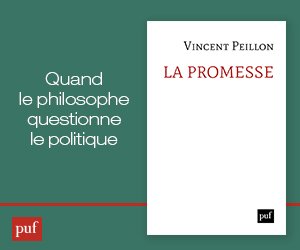Qui va gouverner l’UE (et qu’est-ce que cela pourrait changer) ?
Des élections européennes mises en scène sous la forme dramatique de l’alternative entre le chaos ou le sursaut, puis la proposition et l’investiture toutes deux controversées de la nouvelle présidente de la Commission, Ursula Von der Leyen : l’actualité de l’UE a été particulièrement chargée avant l’été. Alors que la liste des commissaires européens vient d’être publiée, et qu’on devrait connaître demain les attributions précises, où en est-on de la formation du « gouvernement de l’UE » et que peut-on en attendre ? Cette question n’est simple qu’en apparence.
Le « système politique de l’UE » est tout d’abord loin de correspondre à ce que nous connaissons des démocraties représentatives (ce qui ne veut pas dire que la démocratie y est absente) ; conçues comme un lieu de fabrication de politiques communes, les institutions européennes n’ont pas été faites pour incarner et amplifier les tendances, mais au contraire les amortir, ce qui implique une autre grille de lecture que celle dictée par nos automatismes politologiques. Surtout, il se pourrait bien que l’élément le plus « révolutionnaire » de ce qui se dessine réside contre toute attente dans la forte… permanence du noyau dur des équipes dirigeantes de l’UE. Assiste-t-on, de ce point de vue, à la formation d’une classe politique européenne de type fédéral et est-ce annonciateur d’un tournant ?
Un bref rappel
Commençons, pour le comprendre, par ajuster nos lunettes et éviter quelques malentendus. Dans la fièvre des dernières semaines des élections européennes se sont imposés des mots d’ordre visant à naturaliser des clivages politiques comme nationalistes/progressistes, anti-système/oligarque et installer la croyance en un présupposé majoritaire selon lequel le futur gouvernement de l’UE serait une émanation directe des élections. Une telle représentation du « système politique de l’UE » (le mot lui-même pose en réalité problème) est probablement un efficace argument de mobilisation électorale (qui fut meilleure que lors des dernières élections, un peu plus de 50% de participation, soit 10 points de plus), mais son apparente clarté relève davantage d’une transposition hâtive de nos schèmes politico-institutionnels et/ou du wishfull thinking que de la réalité.
L’Union européenne n’a en effet jamais été véritablement conçue comme une démocratie représentative, et encore moins une démocratie parlementaire (ce qui ne signifie pas que le Parlement n’y joue pas un rôle grandissant). Le gouvernement de l’Europe ne repose pas sur la représentation au sens de l’incarnation politique et du nombre (celle-ci est le monopole jalousement gardé des États membres), mais sur un jeu de poids et de contrepoids visant à neutraliser les clivages et dégager un intérêt commun minimal sur lequel fonder des politiques communes. De ce point de vue, les institutions européennes s’apparentent bien plus à ce que Pierre Bourdieu appelait un champ bureaucratique – c’est-à-dire un lieu d’intermédiaires dédié à la production de textes et de politiques publiques – qu’un espace politique fondé sur la représentation partisane.
Cela ne signifie pas que la politique et les enjeux de pouvoir sont absents. Tout au contraire. Mais le pouvoir des institutions européennes est, plus que tout autre système, une émanation collective résultant de la négociation permanente entre des mandataires très divers (nationalement, fonctionnellement, etc.) et relevant d’organisations et d’arènes (les gouvernements et diplomaties des États membres, les administrations des différentes institutions, le parlement européen et en partie les parlements nationaux, les juridictions, les organisations issues des milieux économiques et sociaux) elle-même multiples et différentes. Tout ici, à commencer par cette longue chaine, est organisé pour empêcher qu’un acteur seul domine et trouver un compromis qui fasse (ou soit au plus près d’un) consensus entre les mandataires à un moment t (ce qui n’exclut évidemment pas que certains dominent plus que d’autres en fonction de leurs ressources et des dynamiques de ralliement dont ils bénéficient, et explique toute la difficulté de la prétention à renégocier en solitaire).
Cette structure n’est pas sans conséquence, tant sur la distribution institutionnelle du pouvoir que sur les fondements sociaux de l’autorité. Dans ce champ, les chefs d’État et de gouvernement sont ainsi tout à la fois centraux et marginaux. Incarnant la légitimité des gouvernements élus, ils sont centraux dans des moments singuliers comme lors de la proposition du personnel clef de l’UE, les grandes réformes politiques et économiques qu’elle doit porter ou des crises (qui expliquent la fréquence bien plus élevée qu’elle n’était prévue par les textes, des conseils européens et singulièrement des conseils qualifiés « de la dernière chance » ces dernières années).
Dans les conjonctures routinières, ce gouvernement collectif est toutefois très largement en retrait. La politique demeure collective, mais elle est le fait d’autres mandataires. Rien ne se fait ainsi sans la volonté des États membres (et donc a priori des gouvernements élus), mais ceux-ci sont (en plus des contacts réguliers que les acteurs du champ entretiennent avec les capitales) représentés par les ambassadeurs des pays membres auprès de l’UE et leurs services qui œuvrent au quotidien en lien avec les administrations nationales et, plus occasionnellement, par les ministres qui n’interviennent toutefois qu’en bout de chaine lors des conseils. Autres mandataires, les parlementaires européens comptent de plus en plus du fait des pouvoirs progressivement acquis par le Parlement européen (encore toutefois assez éloigné d’un parlement fédéral).
Sauf sur quelques compétences (liées au respect des textes ou à des politiques exclusives de l’UE), la Commission tire surtout son autorité de sa capacité à préparer les compromis dans le sens de l’intérêt commun, si possible durable à moyen ou long terme, ce qui place au cœur de son autorité relative la vision et le sens du jeu de ses commissaires et de leur administration, leur capacité d’expertise directe ou indirecte, leur maîtrise relationnelle des partenaires sociaux et économiques et bien sûr leur aptitude à incarner l’intérêt commun et articuler (piloter, coordonner, monitorer, etc. et donc « gouvernancer ») l’activité de la somme des mandataires.
Quels rééquilibrages ?
Comment dès lors lire les changements qui résultent des élections et de la séquence de nomination qui a suivi. Compte tenu du schéma précédent, on se doute qu’il ne faut pas nécessairement s’attendre à une révolution. On peut toutefois voir la chose sous deux aspects différents.
Sur le plan des équilibres proprement politiques, tout d’abord, il faut prendre en compte les évolutions simultanées des principales institutions de l’UE, et donc les effets de balancier ou de contre poids que leurs relations entrainent. Le Parlement européen, pour commencer, témoigne ainsi de changements, réels sur le papier, mais à nuancer sur le plan des pratiques parlementaires. Comme l’ont noté de nombreux commentateurs, la droite de la droite additionnée à l’extrême droite de l’hémicycle est plus en nombre. Les conservateurs (l’ECR soit le groupe dans lequel aurait siégé Dupont-Aignan s’il avait été élu) ont bénéficié de la victoire massive du PIS en Pologne et se maintiennent malgré l’écroulement des conservateurs britanniques, et le groupe (désormais intitulé « identité et démocratie ») où siège le RN augmente sensiblement en nombre de sièges (aujourd’hui 74, contre 48 en 2014) grâce à l’écrasante victoire de la Lega en Italie. À ceux-là, on peut encore ajouter la force des Brexiters pour l’instant dans les non-inscrits (ils peuvent sortir ou pas au 31 octobre). Reste qu’il n’y a pas d’alliance entre ces différents groupes et que leur position à l’égard de la Commission de même que leur inclusion dans le jeu politique européen (forte pour l’ECR, faible pour les deux autres) sont très différentes.
Autre changement important, la supposée coalition PPE-S&D n’est plus majoritaire. Comme c’était prévu depuis des mois, elle doit s’adjoindre la force supplétive des libéraux (maintenant Renew Europe) qui progresse (de 41 sièges avant Brexit et de 20 après), voire des Verts qui ont légèrement progressé. C’est à noter, mais n’est pas complètement non plus une révolution au sens où l’idée que l’UE serait gouvernée par une Gro(sse) Co(alition) équivalente à celle qui a gouverné en Allemagne ne tient compte ni des réalités au sein de la Commission (où il y a toujours eu des commissaires libéraux) ni des pratiques parlementaires qui fondent souvent les majorités aux amendements au cas par cas. Ceci relativise aussi l’idée que le fractionnement du parlement est plus important. Il l’est évidemment compte tenu des rééquilibrages indiqués, mais en pratique la fragmentation dépend davantage du plus ou moins fort encastrement des délégations nationales dans leur base électorale nationale que d’une sorte de dynamique fédérale d’accord majoritaire qui demeure en réalité toujours relative.
Les élections européennes n’avaient pas vocation à changer la donne au sein des États membres et donc des conseils (celui des chefs d’État et de gouvernement et celui des ministres), mais elles ont indirectement produit des changements de tête si ce n’est d’équilibre. Si l’on excepte le cas de la Grande-Bretagne qui mérite plus que quelques lignes, la défaite de Siriza en Grèce a provoqué des élections législatives qui ont précipité son remplacement par la droite (ND) et surtout la victoire de Salvini en Italie l’a poussé à tenter un coup qui s’est soldé par son éviction du gouvernement et le retour de ses principaux opposants, les sociaux-démocrates alliés au Mouvement cinq-étoiles dans le nouveau gouvernement Conte.
On note également la grande fragilité de plusieurs gouvernements, comme en Espagne ou en Belgique, et dans une certaine mesure en Allemagne, sans parler des élections nationales qui arrivent ici ou là. Au total et en l’état, le nouveau président du conseil européen, le belge C. Michel (qui a l’étiquette libérale, mais serait sans doute plus près des républicains en France) aura à composer avec un Conseil lui-même bigarré ou les libéraux et la droite dominent (les sociodémocrates ayant cinq chefs de gouvernement représentant 15% de la population), même si on observe un rééquilibrage en son sein au profit des libéraux (où l’on classe E. Macron dont les partisans sont membres de Renew Europe au Parlement).
Dans ce contexte, le Collège de la Commission qui s’annonce selon toute probabilité, et dont les membres sont à la fois élus par le Parlement et préalablement nommés par leur gouvernement dans une concertation relative avec la présidente de la Commission n’est pas le produit d’un effet majoritaire fracassant. On constate néanmoins un peu de changement. En particulier, le PPE, c’est-à-dire la droite classique (ou ce qu’on appelle désormais pudiquement le centre droit) qui en était la force dominante des dernières commissions) régresse sensiblement, tombant de 14 sièges/28 dans la dernière Commission à 9/27. Seule la présidente en émane parmi les pays fondateurs et les grands pays. Les sociaux-démocrates profitent ainsi des accords au sein des coalitions bigarrées qui sont à la tête de plusieurs gouvernements européens et augmente de deux, les libéraux restent stables, les conservateurs un de plus et le commissaire lituanien est affilié aux verts. On a au total une commission moins à droite que lors des précédentes, et du reste moins à droite que ne l’est le rapport politique global si l’on en venait à le calculer au nombre de voix sur une base fédérale.
Mis bout à bout, ces différents déplacements font qu’il est difficile d’arguer d’un fort renouvellement sur le plan partisan, même si la droite classique est moins hégémonique et doit davantage compter avec d’autres : Renew Europe dont les leaders ont néanmoins montré par le passé qu’ils étaient dans leur majorité sur une base économique quasi-identique, mais avec d’autres aussi, à gauche, chez les vert et aussi sa droite (qui s’est du reste renforcée en son sein compte tenu du poids des hongrois et désormais des grecs de Nouvelle démocratie). On peut bien sûr arguer que les « pro-européens » dominent, mais cette catégorie plus que floue a encore moins sens dans le contexte du Brexit (rares sont les groupes demandant encore une sortie).
Il faut aussi rappeler que les étiquettes politiques recouvrent des positions politiques différentes. Par exemple, LREM évoquait à grand bruit une grande alliance avec le Premier ministre libéral néerlandais Mark Rutte, …qui fut aussi le premier à bloquer (au-devant des Allemands) la volonté du président de la République de renforcer le budget de la zone euro. On trouvera des exemples homologues dans chacune des formations européennes. Enfin et plus fondamentalement encore, le jeu collectif (ou collaboratif) européen est ainsi fait que pour qu’un tournant s’opère il faut un alignement important des protagonistes, ce qui suppose que les États membres dégagent des compromis précis et sincères et que la Commission soit en phase, qu’elle agisse comme aiguillon ou metteur en musique.
De ce point de vue, une Commission moins nettement orientée sur le plan partisan, et comme on va le voir moins « politique », fait qu’elle est paradoxalement plus apte à représenter un point d’équilibre, et pourquoi pas un centre de force, selon la célèbre métaphore du jeu de la corde de N. Elias (la force la plus déterminante est celle située au centre des tensions qui s’exercent sur la corde). Reste à savoir en quoi cette Commission représente un collectif et comment il s’insère plus largement dans le champ.
Une classe politique fédérale ?
Si l’on en vient à l’analyse des hommes et des femmes qui vont gouverner l’Europe, le tableau donne à voir un paradoxe typiquement européen. Si révolution il y a, celle-ci réside surtout… dans la forte permanence d’un personnel politique fortement initié à la machine de l’UE. Sociologiquement, l’une des lignes de partage du champ de l’eurocratie réside, au-delà des clivages partisans, dans l’opposition entre un pôle d’insiders et un autre qui sans être toujours totalement outsider entretien un rapport très intermittent ou occasionnel à l’UE. La ressource des premiers tient dans la maîtrise les arcanes, la sociabilité et les réseaux utiles dans le champ, et dans leur reconnaissance par les milieux européens, pour autant qu’ils sont perçus comme des travailleurs assidus et des facilitateurs de compromis et d’avancées européennes. Les seconds disposent de ressources plus ancrées dans l’économie et les sociétés, mais moins dans le champ, et sont investis plus ponctuellement et rarement corps et âme dans ce dernier. Les seconds avaient, ces dernières années, bénéficié d’un processus croissant de politisation des commissions depuis Delors et qui s’était accéléré dans le contexte de crises multiples. Les premiers semblent avoir repris la main.
C’est tout d’abord le cas au Parlement européen. On a beaucoup dit que le nouveau parlement était cette fois tout particulièrement marqué par un fort renouvellement. C’est vrai, un peu plus de 60% (au lieu des 50 % habituels) des députés sont nouveaux. Mais, comme l’ont remarqué depuis longtemps les meilleurs spécialistes (cf le libre qu’il a coordonné sur le parlement européen au travail au PUS ou cette video du GRUE), le Parlement est gouverné par une avant-garde stable et souvent durablement engagée dans la politique européenne à différents postes. De ce point de vue, le nouveau président David Sassoli ne vient pas de nulle part, mais en est à son troisième mandat de parlementaire européen. Les huit présidents de groupes ont dans leur majorité trois mandats ou plus. Les premiers mandats comme Marion Aubry (GUE- France insoumise) ou D. Ciolos (Renew Europe) sont l’exception, sachant que l’ancien premier ministre roumain (et, pour 6 mois, de la présidence tournante) avait été commissaire européen 5 ans.
Quant au bureau du PE, s’il y a bien cinq nouveaux venus sur 14 vice-présidents et quatre questeurs, la moyenne de leur expérience de l’hémicycle de Strasbourg approche les 8 ans, soit près de deux mandats avec plusieurs poids lourds à 15 et même 22 ans de mandats. La distribution des présidences de commissions parlementaires permanentes montre une tendance similaire et dans ce cas la dimension d’insiders joue aussi pour les groupes plus aux marges du parlement, à l’exception de l’extrême droite. La gauche de la gauche possède ainsi un vice-président et Y. Ormajee (FI), investi depuis 7 ans dans l’institution, préside désormais la commission de la politique régionale, une politique importante sur différents plans (budget, capacité de redistribution, etc.), et d’autant plus qu’elle est sur la sellette des discussions budgétaires.
Seulement légèrement différente sur le plan politique, la Commission présente sociologiquement une rupture relative avec la Commission Junker : la tendance à la politisation incarnée par un personnel politique de premier plan est battue en brèche. On ne refera pas ici l’analyse détaillée de la liste présentée ce lundi 9 septembre, et surtout cette liste n’est que provisoire en attendant les batailles qui se déroulement au parlement lors les auditions (elles sont souvent l’occasion de tractations entre les groupes et la commission). Simplement on peut rapidement souligner quelques aspects clefs. La présidente n’est ni une personnalité politique de premier plan ni une habituée de la politique européenne, mais on peut dire qu’elle est l’héritière d’un capital européen : son père fut notamment l’un pionnier de la construction européenne et elle a élevée à Bruxelles et fortement socialisée à l’Europe).
Mais son équipe est plus encore révélatrice d’un profil nouveau. D’abord, il y a peu de haute personnalité politique (2 anciens premiers ministres qui ne sont pas sortants et pour Gentiloni ne l’a été que transitoirement 1 an et demi). Pour mémoire la précédente commission en contenait cinq. Le point notable est au contraire dans la forte intégration des commissaires dans le champ. Huit commissaires l’étaient ainsi déjà dans la Commission Junker ce qui est sans précédent. On a plusieurs troisièmes mandats, ce qui était devenu très rare depuis la démission de la Commission Santer en 1999 et plusieurs des poids lourds de la dernière commission. Quatre autres ont déjà eu des fonctions importantes dans l’UE comme l’ancien président Borell, ou des postes dans l’administration de la Commission. Trois commissaires ont été ambassadeurs représentants permanents de leur pays au Conseil. Enfin nombreux sont ceux qui ont été parlementaires européens, souvent avec plusieurs mandats. C’est un point important. Contrairement à la classe politique nationale où, sauf exception, la plupart des ministres ont été préalablement parlementaires, les commissaires l’étaient peu. Si certains commissaires tiennent à se faire élire, cela n’a longtemps pas été un passage obligé ou un gage de crédit.
Il se pourrait bien que le changement principal tienne dans l’apparition certes très progressive d’une sorte de classe politique fédérale qui circule davantage entre les postes de l’UE. C’est une transformation importante. Alors qu’il arrive fréquemment que les commissaires se trouvent dans un isolement relatif face à l’administration de la Commission et mettent du temps à se faire aux règles informelles des jeux européens, on a désormais affaire à des connaisseurs des arcanes, avec leur réseau, mais aussi une reconnaissance dans et du milieu, qui est une ressource qui ne s’accumule que dans le temps et est précieuse quand il faut précisément dégager et orienter des compromis. Comme tout collectif, il y aura sans doute des personnalités plus ou moins faciles à intégrer, mais sociologiquement on peut attendre une plus grande cohérence du collège et ainsi qu’une plus grande pente vers un agenda intégrateur.
Surtout, cette classe fédérale dont le capital est à la fois plus spécifique et moins fort (et bien moins incarnant) que celui des chefs d’État et de gouvernement donne à voir une nouvelle division du travail politique. Cette nouveauté est relative (au sens où il s’agit surtout d’un retour à l’origine), mais elle tranche avec la confusion des genres (voire la compétition symbolique) qui caractérisait la commission Junker, dont de nombreux membres à commencer par lui-même étaient politiquement plus gradés que les chefs d’État et de gouvernement sans en avoir l’ombre du pouvoir. Pour faire une image (en l’espèce sous la forme d’un négatif), on n’imagine dans l’immédiat pas complètement Ursula Von der Leyen tirer la cravate de ceux qui, du reste, ne sont pas complètement ses homologues lors des Conseils européens. Ceux qui continuent à prendre l’UE pour une démocratie représentative pourront le regretter, d’autres peuvent penser que ceci réalise sociopolitiquement le partage des tâches institutionnelles qui s’est dessiné informellement ses dernières années.
Quel changement en attendre ?
La configuration est nouvelle, mais suffira-t-elle à créer une dynamique conforme aux attentes qui ont pu être suscitées lors des élections. Il y a d’abord un fort caveat sur le sens de cette dynamique. Le Green Deal est toutes les bouches et la commission a produit des rapports de prospective intéressants, mais en l’état la feuille de route du Conseil européen de mai dernier a beau contenir des éléments de prise de conscience sur le climat, les inégalités sociales, la liste des priorités demeure proche de l’arbre de noël et il faudra suivre de près la façon dont le discours d’investiture de la présidente de la Commission se transformera en programme d’activité. Mais il y a, du point de vue même de la dynamique, deux autres conditions compliquées à réunir.
Pour autant que cette émergente classe politique fédérale continue d’être soutenue par les chefs d’États et de gouvernement, il faut encore qu’elle soit en phase avec les administrations qui jouent un rôle quotidien et central, à la fois dans la fabrication de l’agenda et des décisions et la mise en œuvre des politiques, dans ce champ bureaucratique qu’est l’UE. On notera de ce point de vue que les administrations nationales restent les mêmes. Or et c’est un aspect bien connu en France ou la politique économique est dite souvent plus impulsée par Bercy que par les changements de majorités politiques, l’inertie de 30 ans de néolibéralisme fait douter d’un suivi enthousiaste par les administrations économiques nationales des pays qui ont le moins souffert de la crise d’un éventuel tournant européen (s’il avait vraiment lieu politiquement).
Plus généralement, les administrations nationales ne sont pas toujours pleinement investies dans l’Europe, qui est pour elle une source de complexité et pour beaucoup de fonctionnaires (et notamment beaucoup de diplomates) rien de plus qu’un passage obligé de la carrière. À quelques exceptions (la directrice du Trésor est par exemple une ancienne de la Commission), il existe peu de passages et donc les relais de l’un vers l’autre ne sont pas toujours évidents. Si les chefs d’État et de gouvernement veulent des évolutions, il leur faudra ainsi mobiliser l’ensemble de leur administration, et dans le contexte peu favorable de l’usure produite par les réformes administratives qui pressent et souvent découragent leur appareil d’État.
Sur le plan de l’administration européenne, on peut évidemment penser que sa convergence sociologique avec cette nouvelle classe politique est prometteuse. Certes, mais elle arrive à contre temps. Pour faire très vite (cf. mon dernier livre), l’époque des grands commis de l’Europe a plutôt cessé de représenter le modèle de référence au profit d’un modèle de management international indifférencié et proche du privé pour la Commission (l’administration du parlement et du conseil présente des caractéristiques un peu différentes, plus politique pour l’une, plus classique pour l’autre). La politique de la com’ et des slogans et le new public management souvent très décontextualisé et promu à tous les étages a porté préjudice aux qualités de fond jadis prêtées à l’administration de la Commission et divisé le personnel dont on peut dire qu’il vit une crise de reproduction. C’est évidemment une source de fragilité au cœur du système.
Cette tendance n’est pas irréversible tant de nombreux fonctionnaires ne demandent qu’à retrouver le sens d’un projet, mais les effets d’inertie idéologiques, comme plus haut pour les administrations nationales, auquel s’ajoute ici l’effet mécanique d’un recrutement qui porte au plus haut la caricature du management font que le nécessaire rebond d’administration européenne a tout d’une course contre la montre dont le chronomètre court déjà depuis quelques temps. Cette dimension sera l’un des dossiers et l’une des incertitudes de cette nouvelle commission, comme le sera la succession de Martin Selmayr, le très influent directeur de cabinet du président puis secrétaire général de la précédente Commission (pour certain son départ est l’occasion de tourner un page politique de rompre avec ses priorités sur le commerce notamment, pour d’autres c’est le risque d’une organisation moins tenue).
Seconde condition encore plus difficile, pour qu’un changement économique ait lieu, il faut évidemment qu’il soit accompagné par les milieux économiques. Ceux-ci avaient été déterminants dans la promotion de l’idée d’une relance par le marché dans les années 70 et 80. Le seront-ils dans un autre sens ? Contre l’optimisme qui donnerait à croire qu’ils y ont intérêt pour garantir la stabilité et construire une prospérité durable (dans tous les sens du terme), chacun sait que les forces du marché se sont toujours accommodées de tous les « populismes » (pour dire le moins) quand elles ne les ont pas précédés et qu’il a fallu un désastre planétaire pour que des politiques réduisant les inégalités se mettent en place à la libération. Il faudra aussi beaucoup de conviction, et surtout rompre avec la compétition économique et fiscale interne qui mine tout développement sincèrement collectif pour que change la donne, même si les turbulences qui s’annoncent devraient inciter à chercher d’autres solutions que celles qui se sont épuisées. De ce point de vue, l’alignement relatif des Cours européennes, de la banque centrale, et plus indirectement des autres organisations internationales pèsera également…
Rien ne permet d’exclure un changement, donc, et notamment vers plus d’intégration. Mais tout indique que celui-ci n’aura rien d’un acte magique. Ainsi en va-t-il de la construction européenne. On peut le nier ou le déplorer en privilégiant d’autres grilles de lecture. On peut au contraire prendre acte de la pente et de l’étroitesse des chemins possibles. On conviendra dans ce cas qu’un éclairage franc sur les orientations et une honnête pression citoyenne sont de l’intérêt de tous, à commencer pour cette nouvelle classe (si elle ne veut pas paraître suspendue) et les chefs d’État et de gouvernement s’ils veulent empêcher le retour de flamme de l’opposition progressisme/ nationalisme allumée au printemps dernier.
Toutes les études montrent que les citoyens sont tout sauf idiots, même s’ils se sentent très différentiellement autorisés à parler d’Europe. Plutôt que de les assommer de communication et de ressortir le sempiternelle argument que cette dernière ferait défaut, une pédagogie loin des habituels fétiches politiques et la mise en œuvre de politiques justes pourraient probablement aider à ouvrir un nouveau cycle. On n’en sera que plus vigilant sur ce qui va être annoncé tout à l’heure et dans les prochaines semaines.