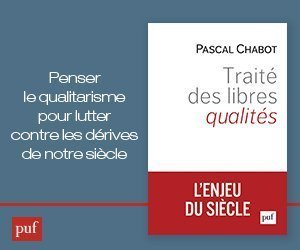Le retour de l’afrocentrisme
Les mots, et la lutte autour de leur signification, sont importants. Le terme d’« Afrocentrisme » par exemple est un hétéronyme jugé dépréciatif par ceux qui se nomment « Afropéens » (Léonora Miano), « Afropolitains » (Achille Mbembe) ou bien encore « Afro-descendants », et qui lui préfèrent celui d’« Afrocentricité ». La notion d’Afrocentrisme ou d’Afrocentricité est un moyen de tordre le bâton dans l’autre sens et de faire de l’Afrique – pas du continent dans son ensemble, en y incluant le Maghreb, mais essentiellement de sa partie « noire », subsaharienne – non pas l’objet passif d’une histoire, de l’histoire, mais un véritable sujet capable d’autonomie et ayant apporté sa contribution à l’évolution de l’humanité. L’Égypte, au sens de la civilisation pharaonique, occupant de ce point de vue une place à part.
C’est en effet au nom du penseur et militant politique sénégalais Cheikh Anta Diop (1923-1986) qu’il faut rattacher principalement la doctrine afrocentriste. Auteur d’une thèse soutenue en Sorbonne en 1960, C. A. Diop s’est employé à démontrer son idée de l’« Antériorité des civilisations nègres » et l’influence déterminante des cultures africaines sur la civilisation égyptienne pharaonique. Selon Diop, les Égyptiens anciens étaient des Noirs. Bien qu’il se soit opposé à Léopold Sédar Senghor, son compatriote et rival politique victorieux, ses idées sont en réalité très proches de celles de l’un des pères, avec Aimé Césaire, de la notion de « négritude » et il est d’ailleurs presque unanimement célébré aujourd’hui au Sénégal où l’université la plus importante porte son nom et où le projet monumental d’histoire de ce pays en vingt-cinq volumes est placé sous son égide.
Combattu de son vivant par certains égyptologues occidentaux sur la nature du peuplement de l’Égypte ancienne, mais revendiqué comme un prophète par un petit groupe d’adeptes, sa pensée a été reprise par d’autres penseurs africains comme le Congolais Théophile Obenga et elle a en outre essaimé aux États-Unis où des penseurs africains-américains comme Molefi Kete Asante ou blancs comme Martin Bernal se sont emparés de ses idées en leur donnant une touche particulière[1].
À la fin des années 1990 et au début des années 2000, une salve de critiques dirigées contre les idées afrocentristes a émané des milieux universitaires blancs, précisément en réaction à l’essor de ces idées dans les départements de « Black Studies » des universités nord-américaines. Font partie de ce courant le livre de Stephen Howe, « Afrocentrism. Mythical Pasts and Imagined Homes » (1998) et l’ouvrage collectif dirigé par François-Xavier Fauvelle, Jean-Pierre Chrétien et Claude-Hélène Perrot, « Afrocentrismes : L’histoire des Africains entre Égypte et Amérique » (2000)[2]. Ces analyses et ces critiques, pour fondées qu’elles soient, n’ont pourtant pas mis fin aux discussions autour de la question de l’afrocentrisme, notamment parce que cette notion revêt des aspects notoirement politiques et identitaires, et donc échappe en partie à un débat proprement scientifique.
Bref, on pourrait résumer l’équation afrocentriste en postulant qu’il s’agit d’un racisme colonial inversé au sens où pour le racisme colonial, l’Afrique n’a rien inventé et n’est qu’un pur réceptacle d’idées et de produits venant de l’extérieur tandis qu’à l’inverse pour les afrocentristes, tout procède de ce continent, l’homme au premier chef mais aussi, comme on le verra, un certain nombre de valeurs et d’institutions dont l’Occident se targue d’avoir le monopole.
Le renouveau de l’afrocentrisme
Le renouveau de l’afrocentrisme et la remise au goût du jour des idées de Cheikh Anta Diop, penseur que l’on croyait définitivement oublié, s’inscrit à l’intérieur du phénomène récent de l’apparition au sein de l’université française d’une nouvelle génération d’enseignants et de chercheurs afropéens, afropolitains ou afro-descendants, c’est-à-dire revendiquant à un titre quelconque des racines africaines, qu’ils soient Français ou non, ainsi que de certains de leurs collègues « blancs » ayant adopté des positions afrocentristes. Ces jeunes enseignants et chercheurs, voire simplement étudiants, qu’ils soient noirs ou blancs, Français ou non, témoignent ainsi, à la différence de leurs aînés, d’une empathie à l’égard de l’Afrique et des Africains qui les conduit à accorder un crédit intellectuel à des thèses que les africanistes des générations antérieures étaient sans doute davantage enclins à rejeter.
Ce phénomène s’inscrit également dans le cadre d’un basculement de l’universel qui les poussent à contester la suprématie intellectuelle de l’Occident et à accorder aux autres continents de la pensée un préjugé favorable. C’est donc à l’intérieur de ce qui a été nommé un « pluriversalisme décolonial » qu’il faut sans doute apprécier ce renouveau de l’afrocentrisme, renouveau qui se manifeste dans plusieurs domaines du savoir et de la politique (Zahra Ali et Sonia Dayan-Herzbrun, Pluriversalisme décolonial).
1. L’aporie de l’oralité
Même s’il a existé des régions d’Afrique qui connaissaient l’écriture ou tout du moins une « littérarité restreinte » (Jack Goody) avant la colonisation, il reste que dans son ensemble ce continent se caractérisait essentiellement par la domination massive de l’oralité. Ce qui a été perçu comme un manque par certains Africains face aux cultures lettrées occidentale ou musulmane les a fait se reporter sur les quelques rares civilisations africaines anciennes qui connaissaient l’écriture comme l’Égypte pharaonique ou l’Éthiopie, alimentant ainsi le discours afrocentriste dans sa version diopienne ou rastafarie.
Un autre moyen de combler ce manque était de considérer que des modes différents de transmission de l’information comme les langages tambourinés ou les signes des sociétés secrètes pouvaient suppléer à l’écriture proprement dite, mais la stratégie de retournement du stigmate la plus communément adoptée fut l’invention, sous la colonisation, de divers systèmes graphiques (pictographiques, alphabétiques) combinant parfois l’alphabet arabe et l’alphabet latin comme dans le cas du N’ko mandingue.
L’absence d’écriture sur la plus grande partie du continent a conduit à se poser la question de l’existence d’une ou de philosophies proprement africaines. Cette question est devenue centrale, dans le sillage du postmodernisme, lorsque des philosophes africains formés à l’occidentale ont commencé à enseigner dans les universités européennes ou américaines et qu’ils ou elles se sont demandés quels pouvaient être les philosophes africains correspondant aux auteurs canoniques de la philosophie occidentale comme Descartes, Kant ou Hegel.
Ils les ont trouvés pour certains dans les ouvrages de l’ethnologie coloniale tels « Dieu d’eau » de Marcel Griaule ou « La Philosophie bantoue » de Placide Tempels. Pour d’autres, il faut chercher dans les mots mêmes de certaines langues africaines – le terme « ubuntu » (humanité) par exemple dans les langues bantoues – censés pouvoir servir de concepts philosophiques. Pour d’autres enfin dans l’art africain « premier » considéré comme recelant en lui-même une philosophie proprement africaine (Souleymane Bachir Diagne). Étaient donc posées les conditions de possibilité d’une ou de philosophies existant à l’état « natif », s’opposant ainsi à l’idée que la philosophie procède de l’élaboration individuelle de concepts opérée par un ou une philosophe.
2. Les droits humains
Ce transfert et ce déplacement du manque est une caractéristique de l’afrocentrisme dans son ensemble et il se retrouve dans d’autres domaines comme ceux qui font l’objet de la fierté de l’Occident et qui sont considérés, à bon droit d’ailleurs par les décoloniaux, comme lui ayant permis pendant une longue période d’assurer son hégémonie sur le reste du monde.
Tel est le cas des droits humains (nouvelle appellation des droits de l’Homme) que les puissances occidentales et particulièrement les ONG brandissent un peu partout dans le monde et notamment en Afrique pour fustiger et combattre entre autres l’excision, l’homophobie ou les mariages précoces. À cette imposition de valeurs au reste de la planète par ces donneurs de leçon que sont l’Europe et l’Amérique du nord, certains intellectuels et militants africains entendent faire valoir que l’Occident n’a pas le monopole du cœur et que l’Afrique a formulé par le passé des principes et énoncé des chartes orales qui montrent son humanité première, une humanité ayant précédé le long parcours de la philosophie politique occidentale allant de l’habeas corpus aux philosophies contractualistes du XVIIIe siècle.
Tel est le cas des chartes du Mandé sous leurs différents avatars, qu’il s’agisse de la Charte de Kurugan Fuga ou du Serment des chasseurs. Procédant du recueil et de la publication par l’historien Djibril Tamsir Niane de l’épopée de Soundjata Keita fondateur de l’empire médiéval du Mali, la charte de Kurugan fuga, qui dresse toute une série de pactes politiques entre les différents clans de cet empire, est présentée par le narrateur de cette épopée, le griot Mamadou Kouyaté, comme une véritable « Constitution ». Cette idée est ensuite reprise par d’autres penseurs comme le marabout guinéen Souleymane Kanté qui considère que cette charte anticipe sur le « Bill of Rights » américain et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Allant encore plus loin, le chercheur malien Youssouf Tata Cissé recueille auprès d’un chasseur « traditionnel » un texte oral qu’il intitule « Le Serment des chasseurs » et qu’il estime avoir été énoncé à une époque antérieure à celle de la « Magna Carta » anglaise. Dans ce texte oral, dont on ignore précisément toutes des conditions d’énonciation, il est notamment dit que « toute vie en vaut une autre ». Par là, est clairement affirmée à la fois l’existence de droits humains africains précédant les Droits de l’Homme occidentaux et celle de la notion d’individualité souvent déniée aux cultures africaines précoloniales.
La synthèse de ces deux chartes africaines des droits humains a été inscrite en 2009 dans la liste du Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco et elle figure également dans la Constitution du Mali. Encensée par des nombreux intellectuels africains comme Cheikh Hamidou Kane ou Souleymane Bachir Diagne, il n’est pas exclu qu’elle figure un jour dans la charte de l’Union africaine, donnant ainsi un lustre supplémentaire au phénomène de la « Renaissance africaine » cher à l’ancien Président sud-africain Thabo Mbeki et magnifié par la statue gigantesque que l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade a fait ériger en son honneur à Dakar.
3. La racialisation des notions de diaspora et d’« Atlantique noir »
Le renouveau de l’afrocentrisme s’inscrit aussi dans le cadre des circulations de tous ordres intervenues depuis des siècles entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques. Sans remonter à l’expédition transatlantique commanditée par le souverain malien médiéval Aboubakar II ou au caractère supposément négroïde des statues olmèques du Mexique, hypothèse énoncée par Ivan van Sertima (Ils y étaient avant Christophe Collomb), l’idée d’une communauté culturelle de l’« Atlantique noir » telle qu’elle s’est notamment construite à travers la traite esclavagiste fonde l’hypothèse de l’existence d’une « diaspora noire » dont les surgeons existeraient des deux côtés de cet océan.
La notion de diaspora, qui a été utilisée pour rendre compte de la dispersion d’un supposé « peuple juif », est ainsi reprise pour exprimer l’unité d’un peuplement racial noir sur les deux rives de l’Atlantique, de même qu’elle est utilisée par l’Union africaine, sous la forme de la « VIe région de l’Afrique » pour désigner les Africains noirs résidant hors d’Afrique. Or si les Antillais, les Africains-Américains ou les Afropéens sont tout à fait fondés à revendiquer une origine africaine, il est délicat d’appliquer à cet ensemble la notion de « diaspora » dans la mesure où celle-ci postule une unité raciale.
En effet, les Africains de l’extérieur ou ceux qui se considèrent comme tels, surtout ceux appartenant aux générations ultérieures aux premiers arrivants sur les sols européen ou américain ont, par définition, du fait des brassages de populations, des origines multiples. Et c’est là tout le problème des identités étatsuniennes à tiret (hyphenated identities) et toute l’ambiguïté des associations qui entendent regrouper des effectifs humains « noirs » sur la base d’une mono-origine. La notion de diaspora appliquée à un « peuple noir » présent sur différents continents et se perpétuant comme tel à travers l’histoire est donc tout aussi contestable que celle d’un « peuple juif » dont le caractère « inventé » a été magistralement démontré par l’historien israélien Schlomo Sand dans Comment le peuple juif fut inventé.
4. L’appropriation culturelle et la restitution
Les organisations prétendant représenter les Afropéens se sont particulièrement manifesté à l’occasion d’expositions ou de représentations théâtrales occultant, selon elles, la « noircitude » des objets ou des personnages représentés. Tel est le cas de la pièce d’Eschyle « Les Suppliantes », mise en scène récemment à la Sorbonne (25 mars 2019) par Philippe Brunet. Dans cette pièce figurent les « Danaïdes » personnages féminins simplement décrits dans cette tragédie comme venus d’Égypte et dotés d’une peau « brunie par le soleil » mais qui ont été représentés dans la version théâtrale donnée par Philippe Brunet par des acteurs blancs maquillés en noir et portant des masques de couleur sombre, s’attirant ainsi les foudres de plusieurs organisations décoloniales – le Cran et la Brigade anti-négrophobie, entre autres –, qui en ont bloqué la représentation.
Cette controverse est symptomatique du malentendu qui règne de nos jours entre auteurs, artistes ou comédiens de « bonne foi » et représentants de la mouvance décoloniale. Ces derniers accusent en effet ce metteur en scène d’avoir, en maquillant ses comédiens en noir, reproduit le phénomène du « black face » ou du « barbouillage »[3], c’est-à-dire cette mise en scène de comédiens blancs grimés en Noirs, destinée, selon eux, dans l’Amérique des années 1920-30, à les ridiculiser. Brunet a beau arguer qu’il voulait simplement mettre en avant les origines en partie africaines de la civilisation grecque classique, qu’il a travaillé avec Jean Rouch, fait interpréter des rôles de la tragédie grecque par des Africains, ou bien encore qu’il est un amoureux de l’Afrique, rien n’y fait parce que face à lui se trouvent des organisations qui s’expriment au nom du « ressenti ».
L’artiste plasticien Hervé di Rosa a beau dire, pour sa part, qu’il utilise des codes pictographiques identiques pour représenter les Noirs et les Blancs dans la fresque consacrée à l’abolition de l’esclavage et exposée au Sénat, rien n’y fait parce qu’il heurte la « sensibilité » de ceux qui parlent au nom des « premiers concernés », les Africains et les Afro-descendants. Des enseignants d’archéologie ont beau affirmer que le symbolisme de la couleur « noire » dans l’Égypte antique n’était pas forcément identique à celui qu’elle a aujourd’hui, que les « nez cassés » des statues égyptiennes ne sont pas l’œuvre d’archéologues européens désireux de dissimuler leur caractère platyrhinien, c’est-à-dire « noir », rien n’y fait parce qu’ils sont confrontés à des afrocentristes disciples de Cheikh Anta Diop qui prétendent que les commissaires de l’exposition « Toutankhamon » ont voulu occulter les origines africaines de la civilisation égyptienne, tout comme d’autres ont voulu dissimuler le fait que les Carthaginois ou les Etrusques étaient en réalité des Noirs.
Mais la question n’est pas tant de savoir si le peuplement de l’Égypte, voire de l’Europe, était « noir » avant d’être « blanc » ou si les Britons, ancêtres des Britanniques actuels, avaient la peau foncée que de se demander si cette coloration avait un impact quelconque sur la ou les culture(s) européenne(s), pour autant que cette interrogation ait un sens[7]. Que l’homme au sens générique soit sorti d’Afrique, qu’il soit ensuite devenu blanc ne veut pas dire pour autant que les cultures européennes soient d’origine africaine, puisque ni l’Europe, ni l’Afrique, en tant que continents, n’existaient à ces époques reculées.
En réalité, l’afrocentrisme ne fait que reproduire, tout en s’en inspirant explicitement parfois, l’anthropologie physique et la raciologie du XIXe siècle, celle de Gobineau notamment, qui divisait l’humanité en races étanches (noire, jaune, blanche) et faisait correspondre à chaque race une culture spécifique[4]. Mais de façon plus significative, l’afrocentrisme actuel s’appuie également sur la génétique qui va chercher dans les crânes fossiles ou les momies des gènes qui attestent la pigmentation colorée des corps conservés et est ainsi utilisée pour prouver leur origine africaine, à la fois sur le plan physiologique et culturel.
C’est donc contre ce phénomène d’appropriation culturelle ou de « blanchiment » opéré par des acteurs « blancs » au détriment des cultures « noires », que se dressent les afrocentristes qui étendent leur revendication à la question de la restitution. Ce phénomène peut être conçu selon plusieurs points vue, c’est-à-dire celui de la restitution d’un sens noir ou africain à des œuvres ou à des personnages considérés comme dénaturés, c’est-à-dire indûment débarrassés de leur « noircitude », mais aussi s’appliquer à des objets matériels, les fameuses statuettes et masques dérobés en Afrique au cours de la période esclavagiste et coloniale et qui figurent en bonne place dans les musées de société occidentaux.
Ces objets sont désormais vus, par certains, comme des êtres vivants exilés loin de leur continent d’origine, et donc destinés à être rapatriés dans leurs « communautés mères »[5]. Acquis frauduleusement comme des « fétiches » par des conquérants, des administrateurs coloniaux ou des ethnologues, ces pièces ont acquis désormais le statut d’œuvre d’art sans que soit aucunement analysée leur biographie culturelle, c’est-à-dire les différentes instances d’artification par lesquels ils sont passés (Cabinets de curiosité, musées ethnographiques, galeries, expositions, etc.).
À ce titre, nombre de ces objets ne pourront pas réintégrer les « communautés » où ils ont été anciennement produits puisque les descendants de ceux qui les ont fabriqués se sont dans de nombreux cas convertis au christianisme ou à l’islam et ne sauraient donc accepter ou héberger des artefacts qu’ils considèrent désormais eux-aussi comme des « fétiches » témoignant de l’ère honnie du paganisme. Ces objets vont donc pour la plupart trouver refuge dans les musées de société qui commencent à être créés en Afrique, à l’instar du « Musée des civilisations noires » récemment inauguré à Dakar et qui reproduit paradoxalement la division coloniale, mais aussi inspirée de Léopold Sédar Senghor, entre une Afrique « blanche » maghrébine et une Afrique « noire » subsaharienne.
Au-delà de ces artefacts volés par les Européens pendant la période coloniale et de l’actualité brûlante de leur restitution, symbolisée par le peu de précipitation du Musée du Quai Branly à rendre au Bénin les objets royaux de l’ancien royaume du Dahomey, est posée en filigrane la question des réparations que les organisations décoloniales estiment être fondées à réclamer à la France en raison des fortunes qui ont pu être accumulées par certaines villes portuaires comme Nantes, Bordeaux, Le Havre ou la Rochelle grâce au commerce transatlantique des esclaves.
En effet, l’afrocentrisme fait partie intégrante d’un changement de paradigme qui fait démarrer l’histoire du capitalisme, non pas à partir de la Révolution industrielle du XVIIIe siècle mais à la date charnière de 1492, qui a vu la découverte ou l’invasion (c’est selon) de l’Amérique et le début de l’exportation des esclaves entreprise par les Européens à destination des plantations de ce continent. Il en résulte que l’histoire de l’Europe et des Amériques, voir leur devenir, est vu par certains comme indissolublement « nègre » au risque d’essentialiser ce concept et d’oublier les rapports sociaux qui le sous-tendent aux différentes périodes de l’histoire (A. Mbembe, Critique de la raison nègre). S’exprime de la sorte un prophétisme proche du Fanon des Damnés de la terre qui est le symétrique et inverse des difficultés que connaissent un grand nombre de pays du continent.
Le renouveau de l’afrocentrisme : obscurantisme ou post-vérité ?
Le renouveau de l’afrocentrisme s’inscrit ainsi dans une perspective historique longue dont on peut faire remonter les premiers signes à Michel Foucault qui voyait dans les pensées non européennes l’avenir de la philosophie et de façon générale à tous les hyper-relativismes, qu’ils soient formulés par le « tout se vaut » de Paul Feyerabend ou par le principe de la « charité épistémique » défendu par Bruno Latour. Si la sorcellerie azandé vaut bien la physique nucléaire, ainsi que l’affirmait Feyerabend, alors le cogito cartésien peut apparaître comme le signe de l’outrecuidance occidentale tandis que s’évanouit pareillement l’idée de ce philosophe selon laquelle l’homme (occidental) serait le « maître et possesseur de la nature », c’est-à-dire de la totalité du monde.
Dès lors, l’homme blanc occidental se doit, de vérifier lorsqu’il énonce une proposition, par exemple celle d’une possible ressemblance entre cultures éloignées, qu’il ne profite pas indûment d’un privilège en occupant une position de surplomb et, ce faisant, qu’il ne prive les acteurs sociaux « subalternes » de possibilités d’expression auxquels ils ont d’autant plus droit qu’ils en ont pendant longtemps été privés. Autrement dit, plus que la justesse d’une analyse, c’est désormais le lieu d’où elle procède qui prime. Pour paraphraser Pirandello, on pourrait dire que non seulement chaque groupe détient la vérité mais que certains la détiennent plus que d’autres, ce qui donne une prime à des doctrines comme l’afrocentrisme avec le risque de backlash que cette posture comporte, à savoir celle de conforter en retour des idées comme l’eurocentrisme, dont peut voir s’exercer les ravages avec l’accent mis à l’heure actuelle sur les origines chrétiennes de l’Europe.