Minuit à l’heure de l’universalisme
Dans Les choses, publié en 1965, Georges Perec méditant sur la bascule qui faisait chavirer son époque écrivait : « La vie moderne excitait [le] malheur […] La tension était trop forte en ce monde qui promettait tant, qui ne donnait rien ». Perec parlait alors des « Trente glorieuses », de la société de consommation naissante et de ses chimères mais il aurait tout aussi pu parler de la modernité au sens historico-philosophique et d’un de ses corollaires majeurs : l’universalisme. Lui aussi promettait tant. Tant qu’il a déçu.
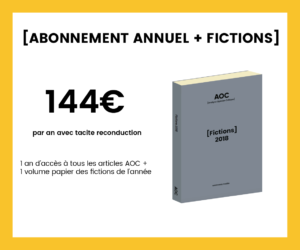
Après avoir été une des valeurs « locomotive » de l’histoire occidentale pendant plusieurs siècles, l’universalisme est à présent en crise. Depuis une trentaine d’année, il appartient même à la catégorie des sujets les plus âprement débattus, traçant une ligne de fracture saillante entre les pro et les anti jusqu’à devenir un totem pour certains et la figure typique du mot repoussoir pour d’autres. Derrière cette opposition, on trouve deux traditions politiques. Pour la première, héritière d’une philosophie de l’Histoire qui s’étend de la Révolution française au marxisme, l’universalisme constitue un élément non-négociable de la théorie politique car il est inscrit dans « l’eschatologie » révolutionnaire visant à l’avènement d’un monde commun peuplé d’égaux et de semblables.
Pour la seconde, lassée des promesses non-tenues de l’universalisme, ce dernier est perçu comme un bandeau recouvrant les yeux de toute la tradition philosophique occidentale. Sous prétexte d’une affirmation d’indifférence à la couleur (color blind), il rendrait en vérité aveugle aux réalités des discriminations actuelles : néo-impérialisme, continuum colonial, domination par l’occident des « pays du sud », invisibilisation des femmes, marginalisation des « minorités », « gestion » répressive des quartiers populaires… Accessoire d’un gigantesque « déni » permettant de ne pas regarder « les problèmes en face », l’universalisme n’aurait par ailleurs guère de valeur historique, les grands hérauts de l’universel (l’Europe, les États-Unis) présentant un passé grevé de contradictions entre les déclarations et les faits (guerres, colonisation, impérialisme).
Mais ce n’est pas tout. Dans sa prétention même à nier le particulier au nom du grand tout, l’universalisme serait également un danger pour l’« Autre », pour le « différent » ; un moule unique et uniformisant taillé par et pour l’Occident. La France est particulièrement visée par cet examen critique car son modèle républicain s’est construit consubstantiellement avec l’idée d’universalisme. Comme le note en effet Jeremy Jenning dans le Dictionnaire critique de la République : « L’un des aspects les plus frappants de la Révolution de 1789 est que, dès le début, ses participants croyaient que leurs actions avaient une signification mondiale, et que l’enjeu renfermait des valeurs universelles ».
Au premier abord, ces deux positions semblent inconciliables. C’est en effet le cas si l’on se contente de rechercher une simple synthèse. Mais il peut en être autrement si l’on utilise plutôt la méthode dialectique. Dans notre cas d’espèce, cela signifie penser un universalisme à la lumière de sa critique. Essayons à cette fin de confronter les deux théories. Après tout, James Baldwin nous a appris que « rien ne peut changer tant qu’on ne l’affronte pas ».
Aux origines de l’universalisme
Pour saisir pleinement les enjeux de ce conflit intellectuel majeur, il convient d’abord de revenir aux origines de l’universalisme. Car l’universalisme est vieux de plus de vingt siècles. Du latin « unus » et « versus » (littéralement « tourné en un »), il désigne durant l’Antiquité sous le nom d’universalis la notion de totalité, d’entièreté et d’unité. L’universalis recouvre donc à la fois l’univers (universus), le général, ce qui s’étend à tous, à tout et partout. Dans les faits, il apparaît pour la première fois avec le christianisme « paulinien » et la phrase célèbre de Saint-Paul expliquant ce qu’être chrétien signifie : « Il n’y a plus ni Juif, ni Grec, il n’y a plus esclave ni homme libre, il n’y a plus ni homme ni femme : vous êtes tous un en Jésus Christ » (Lettre aux Galates, 3. 28).
Cette affirmation est alors une rupture majeure avec la conception anthropologique dominante, puisque pour la pensée antique il n’existe que des hommes libres ou esclaves désignés comme tels par la Cité ou l’Empire auxquels ils sont rattachés. Mais cet universalis existe-t-il réellement ? N’est-il pas une simple perception de l’esprit ? Entre le XIIe et le XIVe siècle, les savants médiévistes s’affrontent sur le bienfondé de ce concept.
Puis, avec la modernité, l’universalisme passe des choses aux hommes. Les grandes découvertes du XVe et XVIe siècle qui entraînent la rencontre avec de nouvelles civilisations plongent l’Europe dans un tourbillon métaphysique dont la plus célèbre bourrasque est la « Controverse de Valladolid » (1550-1551). L’humanité des « Indiens » est débattue. Sont-ils des hommes ? Ont-ils une âme ? Peuvent-ils se prévaloir d’un droit et si oui, lequel ? On le sait, au cours de ce débat fondamental, Las Casas l’emporte sur Sepúlveda en s’appuyant notamment sur les principes du théologien Francesco de Vitoria.
L’École du droit naturel peut alors prendre son essor. Des grands juristes comme Grotius, Althusius, Pufendorf défendent l’idée d’un droit commun (jus commune) à tous les hommes. Locke, Rousseau et les Lumières s’en font les héritiers. La conception ancienne du droit rattaché à une cité ou à un empire est pourfendue. Il existe des droits de l’Homme, affirment les Lumières. Des révolutions éclatent pour les faire reconnaître : en Hollande, en Angleterre, aux États-Unis, en France.
Universalisme et droits de l’homme s’épousent. Dans l’hexagone, on l’a dit en introduction, la République pousse sur ces deux rameaux. Elle les exalte, elle en tire le sens profond de son projet révolutionnaire : une émancipation pour toutes et tous. Là où sur terre règnent la tyrannie, l’esclavage et l’arbitraire, il y a un combat à mener. Robespierre déclare à ce titre : « Que la France, jadis illustre parmi les pays esclaves […] devienne le modèle des nations, l’effroi des oppresseurs, la consolation des opprimés, l’ornement de l’Univers, et qu’en scellant notre ouvrage de notre sang, nous puissions voir au moins briller l’aurore de la félicité universelle ».
Le socialisme naissant du XIXe siècle lui emboîte le pas. Il parle d’internationalisme, il évoque la « République universelle » reprenant l’expression du révolutionnaire Anacharsis Cloots. Parce qu’il n’existe pas de races, dit le socialisme républicain, parce qu’il n’y a qu’un « genre humain ». Le marxisme se fait le légataire de cette vocation universelle de l’émancipation révolutionnaire. C’est aux prolétaires de tous les pays qu’il lance son appel au soulèvement général.
Le mot sera entendu par les combattants marxistes, socialistes, ouvriéristes mais aussi par les anticolonialistes qui se libéreront du joug colonial au nom du désir d’autonomie, d’émancipation et d’égalité portés par l’universalisme. Au XXe siècle, Léopold Sédar Senghor, passeur de témoin et premier président de la République du Sénégal (1960-1980) après avoir été ministre en France, défendra dans son œuvre littéraire et politique une « civilisation de l’universel ». Et Hô Chi Minh, Che Guevara, Thomas Sankara, Nelson Mandela conjugueront la langue de leurs combats à l’impératif universaliste.
L’universalisme en accusation
Mais, nous l’avons dit en introduction, le nouage révolution-république-universalisme, parce qu’il est un produit d’une certaine philosophie de l’Histoire, ne fonctionne que s’il peut s’appuyer sur l’idée de « progrès » ; en d’autres termes, que s’il peut garantir que demain sera mieux qu’hier. Et cela, désormais, l’universalisme le peut de plus en plus difficilement. Car le train de l’Histoire occidentale a déraillé. Au XIXe siècle, la justification du colonialisme de la IIIe République au nom d’une mission dite « civilisatrice » a souillé du sang des colonisés le corpus du républicanisme. Puis les catastrophes du XXe siècle ont plongé le monde occidental dans une crise de conscience sans précédent en questionnant la teneur même de son mouvement historique.
Entre le XVIIe et le XXe siècle, à la suite des écrits de Fontenelle, des Lumières ou de Condorcet, l’Occident s’enorgueillissait d’avancer en suivant la « boussole du progrès ». Mais peut-on toujours dire après « 14-18 » que les armes chimiques sont un progrès, après 1944 que la bombe nucléaire est un progrès ? Peut-on même continuer à se prévaloir de cette idée de progrès quand on sait le rôle joué par la « rationalisation », le machinisme et la science dans la colonisation et la Shoah ? Au cours des dernières décennies, le surgissement de la « question écologique » (réchauffement climatique, destruction de l’écosystème planétaire) a achevé de discréditer cette « foi », fragilisant un peu plus encore le nœud universalisme-progrès. Depuis, un grand voile de discrédit s’abat sur l’Occident entraînant la remise en cause de sa science et de sa méthodologie sur lesquelles reposait tout en partie le prestige de l’universalisme.
Fort de ce coup d’arrêt, de nouvelles disciplines ont émergé tout au long du XXe siècle appelant à un regard « décentré ». Souleymane Bachir Diagne et Jean-Loup Amselle dans une discussion croisée ont tracé la généalogie de ce nouveau regard : il y eut au commencement les « non alignés » de la conférence de Bandung (1955), puis le mouvement de la « négritude » (1956), l’«orientalisme » (1978) d’Edward Saïd, la « bibliothèque coloniale » mise à l’index par Valentin Mudimbe (1988). Tous ont appelé à une résistance contre ce qu’ils considéraient comme une forma mentis unique et unidimensionnelle de l’Occident.
Cette contestation s’est poursuivie en empruntant les chemins de la philosophie déconstructiviste et a gagné en virulence à partir des années 1980 du fait de l’émergence des Subaltern studies (du nom d’une revue indienne), des Post-colonial studies et des études décoloniales[1]. Une offensive théorique de grande ampleur a alors vu le jour, venant d’Asie mais aussi d’Amérique latine (avec le philosophe Enrique Dussel, l’anthropologue Arturo Escobar, les sociologues Ramón Grosfoguel et Anibal Quijano ou le sémiologue Walter Mignolo), avant d’être relayée dans les universités américaines puis européennes[2].
Trois critiques principales ressortent de ces différents champs d’étude :
1- L’universalisme ne serait que le faux nez d’un eurocentrisme impérialiste. Né en Europe, il constituerait un concept pour l’Europe, une sorte de cheval de Troie servant à répandre ses valeurs et de sa vision du monde. Un universalisme hypocrite en somme.
2- Cet universalisme serait d’autant plus difficile à remettre en cause qu’il aurait construit un « récit autoréférentiel de la modernité », « eurocentrique » et l’aurait injecté de façon hégémonique dans l’ensemble des savoirs.
3- Cet universalisme serait uniformisant et donc dangereux pour l’ensemble des cultures non-occidentales qu’il asphyxierait et empêcherait de croître. Fort de cette dimension dite « totalisante » (Gayatri C. Spivak), l’universalisme occidental créerait ainsi une géopolitique mondiale déséquilibrée au sein de laquelle il placerait l’Occident au centre et le reste à la marge, relégué au rang de subalternes. Figure de proue de ce courant critique, Dipesh Chakrabarty instruit depuis quelque temps pareil procès au marxisme accusé par son « analyse globalisante » d’étouffer les « hétérogénéités et incommensurabilités » du local.
La continuelle querelle des universaux
En réalité, la négation de l’universalisme est aussi ancienne que le concept même. Dès le Moyen-Âge, l’opposition médiévale entre nominalistes et réalistes entraîne une disputatio qu’on nommera « la querelle des universaux »[3]. Mais ce débat relève surtout du questionnement philosophique et théologique. C’est à la Révolution française qu’éclate la grande polémique moderne sur l’universalisme. D’une part, jaillissent les premières critiques sur l’inefficience de cet universalisme révolutionnaire que traversent de trop nombreux manques (au sujet des femmes, des esclaves, des pauvres).
D’autre part, dans le sillage de ce qu’on nommera la « contre-révolution » (Burke, de Maistre et Bonald), survient une contestation radicale de l’existence même l’universalisme. Une citation célèbre de Joseph de Maistre résume alors l’opposition de vue : « J’ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, etc ; je sais même, grâce à Montesquieu, qu’on peut être Persan, mais quant à l’homme je déclare ne l’avoir rencontré de ma vie » [4]. La contre-révolution refuse l’idée qu’il existe « l’Homme » en tant que catégorie abstraite. La justification est d’ordre religieuse et conservatrice. Penser l’Homme et ses droits en soi comme émanation de sa nature, c’est d’une part rompre avec l’idée des hommes conçus comme créatures divines et soumis aux lois de Dieu. D’autre part, envisager cet Homme in abstracto, détaché des lieux et du temps, c’est l’affranchir du continuum temporel qui divise depuis les siècles les hommes et les femmes en catégories bien étanches (ethnies, civilisations, ordres). C’est mettre tout l’ordre social de l’Ancien Régime sens dessus-dessous.
Cette peur de l’universalisme comme souffle révolutionnaire remettant en cause la tradition se retrouve chez certains adversaires actuels de l’universalisme [5]. Comme chez De Maistre ou plus tard chez Barrès (« la terre et les morts »), l’universalité est en effet contestée au nom d’un « désir d’appartenance » régional, tribal ou génétique, désir que l’universalité dans sa généralité abstraite ne peut combler. Ce n’est ainsi pas un hasard de voir que la poursuite de l’opposition contre-révolutionnaire à l’universalisme va s’approfondir en Allemagne, après la Révolution, entre les écrits de Fichte et ceux de Gentz, puis plus tard, de Carl Schmitt. Désignée par Blandine Kriegel[6] comme une « révolution conservatrice », cette ligne d’opposition allemande se voudra en effet aussi révolutionnaire et volontariste que le rousseauisme ou le jacobinisme mais elle considèrera que cette révolution ne peut s’inscrire dans un autre cadre que celui d’une nation fermée et par un autre acteur qu’un peuple bien défini.
On constate ainsi que les critiques actuels de l’universalisme sont déjà toute en partie en place dès la fin du XIXe siècle : sous la forme d’abord de la dénonciation d’un universalisme sécularisé susceptible de blesser l’universalisme catholique (l’adjectif « catholique » vient du grec καθολικός (katholikos) qui signifie « universel ») [7]. Par le refus, ensuite, de penser l’individu sous une forme philosophique et hors de ses racines géographiques et/ou ethniques. Le 3e point – le reproche de l’hypocrisie – est également déjà formulé, mais il émane d’une culture politique rivale : le marxisme. S’appuyant sur la conception dialectique et matérielle de l’histoire, le marxisme questionne les origines et les effets de l’universalisme à travers un examen serré des droits de l’Homme. Ces derniers ne sont-ils pas les expressions iconiques d’un moment historique « bourgeois » et donc particulier ? L’énonciation de libertés formelles et non réelles ?
Au XXe siècle, cette prétention « universelle » des Droits de l’Homme issue du bloc libéral, notamment dans la Déclaration de 1948, sera de ce fait contesté par le bloc soviétique, et spécifiquement en ce qui concerne « le droit naturel de propriété ». Mais le marxisme ne nie pas l’idée d’universalisme, il fustige son utilisation trompeuse par ceux qu’il considère comme de faux universalistes mus par des intérêts de classe. La critique marxiste offre une piste de réflexion d’autant plus intéressante que les études sociologiques de terrain donnent à entendre un sentiment similaire du côté des concernés[8] : les valeurs du triptyque républicain ou l’universalisme ne sont que très rarement rejetées. Ce qui anime le ressentiment contre elles – à raison –, c’est l’inapplication de ces principes et de ces valeurs au quotidien[9].
Les grandes manifestations antiracistes récentes ne scandent pas « à bas l’universalisme », elles demandent un universalisme concret à travers un traitement égalitaire et une citoyenneté qui ne soit pas « à deux vitesses », elles demandent l’expression la plus emblématique de l’idéal universel comme l’illustre le mot d’ordre du collectif « La vérité pour Adama » : la justice.
Combattre à l’intérieur de l’universalisme
Au fond, au lieu de poursuivre cette opposition qui par ailleurs, comme l’a bien indiqué le sociologue américain Vivek Chibber, affaiblit la lutte contre le capitalisme en désarmant l’appareil critique républicano-marxiste, il est peut-être temps de revenir au minuit de l’idée d’universalisme. Car c’est à cette heure que l’on peut s’accorder sur les aiguilles. Dénonçons avec les Subaltern studies et les Post-colonial studies cet universalisme d’apparat qui s’est servi du masque de la philanthropie pour mener à bien ses projets impérialistes et coloniaux au XIXe siècle et poursuivons-le encore et toujours lorsqu’il sert à justifier les ingérences des dits-civilisés dans les zones des « non-civilisés » pour raisons économiques (I. Wallerstein) [10].
Étudions la confusion possible et critiquable ayant eu lieu entre « l’universalisme abstrait et la mondialité concrète résultant de l’hégémonie de l’Europe comme centre » (Enrique Dussel [11]). Reconnaissons également avec ces études les « angles morts » (Norman Ajari) de l’universalisme historique et ses manquements aussi bien passés (le suffrage dit universel en 1848 alors qu’il excluait les femmes ; la mission dite « civilisatrice » de la colonisation, le code de l’indigénat de 1881 appliqué aux « départements » algériens ; les banlieues et les quartiers populaires laissés à l’abandon) que présents (les statistiques relatives à l’embauche, à l’accès au logement, aux contrôles policiers témoignent de discriminations lourdes).
Mais sachons dire dans le même temps que la dénonciation de cet « universalisme dévoyé » (Alain Policar) ne doit en aucun cas mener à l’ethno-différencialisme qui, comme l’a montré Nedjib Sidi Moussa est parjure au projet révolutionnaire. Sachons dire aussi qu’une racialisation et une ethnicisation à outrance des débats ne peut que renforcer la « fièvre identitaire » qui anime les xénophobes d’extrême-droite. Sachons dire enfin qu’il est temps de mettre fin au processus de décomposition de l’idée d’égalité qui frappe nos sociétés depuis trop longtemps et que l’universalisme peut-être une « arme pour la gauche » (Vivek Chibber) dans cette bataille.
L’exemple oublié de la lutte du républicanisme révolutionnaire contre le républicanisme conservateur
Pour ce faire, il faut d’abord se départir d’une conception unidimensionnelle et monolithique de l’universalisme et de son support, la République. L’avènement de la République en France n’a rien d’irénique, d’apaisé et de linéaire. Elle est le fruit d’une lutte interne au sein de ce qu’on appelait au XIXe siècle « le Parti républicain »[12], le résultat d’un conflit mettant en tension différentes sensibilités (libérale, conservatrice, jacobine, plébéienne) en prise pour le contrôle et l’orientation de l’idée républicaine, ainsi que nous l’avons montré dans nos travaux avec Jacques de Saint-Victor.
La question sociale, celle de la souveraineté, celle de la violence et de l’insurrection, celle de l’égalité, du rapport à la propriété, aux institutions : tout a été le fruit d’âpres débats. Et il en fut de même concernant l’universalisme. Il n’y a rien de plus faux que de croire que l’idée d’universel fut dans la praxis républicaine une facilité oratoire ou un propos de salon. Son énonciation et l’extension de son domaine se sont payées au prix du sang. Le républicanisme révolutionnaire s’est en effet battu constamment pour aiguiller le sens de l’universalisme vers un « universalisme intensif », pour reprendre la distinction d’Étienne Balibar, c’est-à-dire un universalisme de libération et d’émancipation, contre l’ « universalisme extensif » (i.e. l’universalisme d’expansion et de colonisation).
À ce titre, entre le XVIIIe et le XXe siècle, des républicains révolutionnaires, puis des socialistes ou des marxistes, se sont opposés à d’autres républicains, conservateurs pour dénoncer les entorses faites à la promesse révolutionnaire de l’universel. Dès le commencement de la Révolution, Condorcet et Olympe de Gouge plaident pour le droit de vote des femmes, injustement écartées de la citoyenneté. Au même moment, Robespierre fustige tout ce qui blesse le droit naturel. Il se prononce contre la loi martiale, contre la peine de mort, contre la distinction citoyen passif/citoyen actif. La représentation nationale s’honore à donner la citoyenneté aux comédiens, aux protestants, aux juifs, aux « hommes libres de couleur » mais rechigne à abolir l’esclavage du fait de la richesse que rapportent les colonies à certains Constituants. Robespierre s’en fait le pourfendeur et déclare « périssent nos colonies plutôt que nos principes »[13].
La République advenue, ces combats de Robespierre, de l’Abbé Grégoire et de la « Société des amis des noirs » associés aux luttes des esclaves dans les colonies, l’esclavage peut alors être aboli (4 février 1794). Et il en sera de même de chacune des promesses de l’universalisme. Bon nombre de ces promesses seront en effet trahies. Mais aucune de ces trahisons ne manquera d’être dénoncée par le camp républicain révolutionnaire. Les néojacobins combattront Napoléon pour avoir jugulé la démocratie ; les résistants de la « République souterraine » seront exécutés sous la Restauration (Les 4 sergents de la Rochelle), jetés en prison ou mourront lors des insurrections réprimées sous la Monarchie de Juillet pour avoir rappelé à Louis-Philippe et à l’extrême-centre leur « mensonge tricolore » ; les républicains « rouges » périront sous la mitraille de Cavaignac en juin 1848 et sous les décrets d’exil de Napoléon III après le 2 décembre 1851 ; tout comme les Communards en 1871 tombés pour « la république de la justice et du travail » (Jean-Baptiste Clément).
Et ils seront secondés par Marx puis Lénine qui flétriront les républiques toutes les fois où elles seront bourgeoises et non « démocratiques et sociales ». Lorsque la République, aux mains des conservateurs, prendra un tournant racial et colonisateur sous la IIIe, des voix comme celle du grand sociologue Marcel Mauss dénonceront l’erreur et l’horreur d’une telle bascule. Et le « premier » Clemenceau s’opposera farouchement à Jules Ferry pour contester son discours sur les « races inférieures ». Dans le même temps, sous l’égide de Jaurès, le républicanisme se fera tout aussi accusateur contre ses usurpateurs affairistes et tous ceux l’empêchant de parvenir à son terme. Et Jaurès dira que ce terme, c’est le socialisme. Jeanne Deroin, Louise Michel, les suffragettes et Rosa Luxembourg vitupéreront le virilisme, le préjugé masculiniste et l’égalité bafouée. De Marat à Aimé Césaire, on anathémisera les « chaînes de l’esclavage ». Et beaucoup de neg marrons entre 1794 et 1848 s’insurgeront, comme l’a relevé Silyane Larcher, en criant « Vive la liberté ! Vive la République ».
Est-ce à dire pour autant que la République est pure et immaculée ? Une telle essentialisation positive serait aussi inepte qu’une essentialisation totalement négative. Peut-on considérer que la République est immunisée contre toute tentation impérialiste et oppressive ? Aucunement, mais son idéal offre les armes pour combattre contre sa propre corruption.
Pour un universalisme latéral
Dans Histoire et conscience de classe (1923), Georg Lukacs affirme qu’en tout état de cause ce que la théorie critique devra toujours garder du marxisme, c’est sa méthode dialectique. Cette dernière s’oppose à la méthode traditionnelle « thèse/antithèse/synthèse ». Dans le cas de la dialectique, le mouvement est thèse/critique de cette thèse/dépassement (aufhebung) de la première thèse grâce à sa critique. Voilà ce que signifie penser un universalisme à la lumière de sa critique. Est-ce possible ou le mot est-il définitivement perdu à force de dévoiement ?
On peut le croire en s’appuyant, comme l’invite Souleymane Bachir Diagne, sur les travaux de Maurice Merleau-Ponty[14]. Il existe, écrit Merleau-Ponty, un universalisme qu’il faut combattre, c’est « l’universalisme de surplomb », c’est celui de la colonisation et de l’impérialisme. Puis il en est un autre, non-hiérarchisé, qui appelle à lui l’ensemble des hommes dans leurs origines diverses pour tisser un universalisme de rencontre provocant ainsi une « incessante mise à l’épreuve de soi par l’autre et de l’autre par soi » : c’est « l’universalisme latéral ». C’est celui qu’il convient de construire[15]. Car comme l’écrivait Henri Bergson dans Les deux sources de la morale et de la religion (1932), l’universel n’est jamais donné. Et, c’est ce sur quoi il faut conclure.
L’universalisme, pas plus que la République, le socialisme ou le marxisme, n’est une notion performative qui saurait se suffire à elle-même du simple fait de son énoncé. Sans les hommes et les femmes – de Spinoza à Edouard Glissant en passant par Robespierre, Clara Zetkin, Gisèle Halimi et mille autres – qui veulent en porter l’étendard, il est une voile de navire sans attache. Mais il est justement dans le pouvoir – et le devoir – des hommes et des femmes de lui donner son effectivité, de lutter pour accroitre son périmètre, de mettre en demeure en son nom tous ceux qui s’en réclament mais le trahisse constamment, d’intégrer le particulier dans l’universel avec ce que cela implique de « conflits »[16] ; de combattre pour que le calque de l’idée épouse enfin les faits.
La misère, les exclusions et les discriminations qui perdurent ne sont pas les accusateurs de l’universalisme, ils sont la mauvaise conscience des universalistes. Ce qui compte comme disait Karl Korsch au sujet du rapport du marxisme à la philosophie[17], ce n’est pas de dépasser l’universalisme, c’est de le réaliser.
