Peste et covid-19 : même combat ?
La question peut sembler provocante, pour ne pas dire déplacée. Ni la nature de l’épidémie actuelle causée par un virus là où la peste est provoquée par une bactérie ; ni sa létalité qui, même si elle reste incertaine du fait des doutes sur le nombre de cas recensés, n’en est pas moins très faible au regard de la mortalité due au yersinia pestis dans sa forme bubonique et plus encore pulmonaire, ne rendent a priori ces deux infections comparables. Face à une situation sanitaire exceptionnelle et à la mise en quarantaine de populations à l’échelle de pays entiers, nombre d’historiens, dans les journaux ou sur les ondes, ont toutefois été appelés à donner de la voix pour évoquer l’épidémie de peste, apparue au milieu du XIVe siècle.
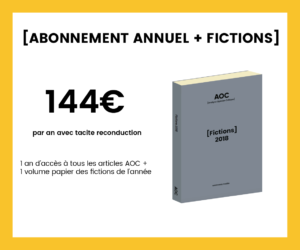
De 1347 à 1353, entre le tiers et plus de la moitié de la population européenne a péri : une crise démographique sans précédent, bien supérieure en pourcentage de population, au nombre de morts causés par les épidémies ultérieures de choléra au XIXe siècle, ou de grippe espagnole à partir de l’automne 1918, et dont on parle actuellement tout autant. Considérée alors comme nouvelle et hors norme (on avait en effet oublié une première pandémie, dite « peste de Justinien », survenue dans les années 541-ca 760), la peste est devenue endémique. Compagne de longue durée des sociétés occidentales, elle n’a disparu qu’au XVIIIe siècle, avec un dernier épisode meurtrier à Marseille, en 1720, mais sévit encore au XIXe dans l’Empire ottoman. Une troisième pandémie resurgit en Asie à la fin du siècle et, faut-il le rappeler, la peste reste présente jusqu’à aujourd’hui dans certaines parties du monde, comme à Madagascar, où elle revient périodiquement.
Si la peste et le Covid-19 ne se ressemblent guère, puisque leur nosologie, leur étiologie ou encore leur létalité divergent fortement, on ne peut s’empêcher de lire ici ou là des évocations de la pandémie médiévale, pour en faire, sans solution de continuité, aussi bien un miroir de nos peurs qu’un précurseur de certaines mesures de santé. Évoquer la peste est certes possible, à condition non pas d’y chercher des similitudes mais tout au plus des analogies, susceptibles de nous aider à penser la singularité du présent.
Plusieurs facteurs peuvent en effet expliquer ces associations d’idées, à commencer bien sûr par le caractère pandémique de l’épidémie actuelle, exacerbé par la mondialisation, qui n’est pas sans rappeler, à une toute autre échelle toutefois et à une autre vitesse, la peste médiévale. L’avancée inexorable du Covid-19 depuis la Chine jusqu’aux États-Unis et à l’Afrique fait écho à celle de la peste du XIVe siècle : apparue en 1346 dans le comptoir de Caffa, en Crimée, elle chemine le long des circuits commerciaux méditerranéens pour atteindre Messine en septembre 1347 puis Marseille en novembre ainsi que les principaux ports de Méditerranée occidentale. Puis, par voie terrestre, elle poursuit sa route jusqu’aux contrées plus éloignées, Pologne et Russie, touchée en 1352.
Si l’on a pu suivre depuis janvier 2020 la propagation rapide de l’épidémie, les sociétés médiévales étaient également informées d’un mal nouveau apparu en Méditerranée, suscitant une terrible mortalité. Installé à Reims (alors non encore infectée), le médecin Pierre de Damouzy († 1371), auteur d’un régime de temps de peste achevé en août 1348, dit écrire « par peur de la corruption en raison de la proximité des Parisiens », une ville où la peste fait rage. Son traité distingue déjà des situations qu’on pourrait qualifier de pré-épidémique, épidémique et post-épidémique. Il propose différents conseils selon que les individus sont malades dans des régions où l’air est sain, selon qu’ils vivent dans des lieux sains mais menacés par la proximité de zones contaminées, selon qu’ils sont en bonne santé tout en étant dans un environnement pestilentiel, ou qu’ils sont malades dans des territoires infectés.
Un autre facteur de rapprochement découle du fait que pour la première fois, depuis un siècle (et l’épidémie de grippe espagnole), l’Europe a été à un moment l’épicentre de l’infection, comme c’était le cas de la peste médiévale et moderne.
Ce qui constitue un lien plus frappant encore entre la peste et le temps présent, ce sont des mesures que l’on croirait d’un autre temps.
On évoquera enfin le caractère anxiogène d’une maladie nouvelle, le Covid-19, sur laquelle la science se penche dans l’urgence, une peur que renforcent sans doute les mesures édictées par les gouvernements italien, espagnol et français, à savoir le confinement de toute la population du territoire, et l’impression d’une gestion au jour le jour. Des départs précipités de citadins, préférant la ruralité à la promiscuité urbaine, jusqu’à la théorie du complot (Donald Trump et les autorités chinoises, chacun accusant l’autre d’avoir inventé le virus), en passant par la rhétorique de guerre contre un « ennemi invisible » (titre d’un ouvrage célèbre de Carlo Maria Cipolla sur la peste et les structures sanitaires) employée par certains gouvernants, ce sont autant de manifestations qui, toutes proportions gardées, renvoient à certaines réalités médiévales. On pense aussi aux cités abandonnées par leurs habitants les plus riches, à l’image des jeunes gens et jeunes filles du Décaméron de Boccace, réfugiés à Fiesole pour s’y raconter des histoires et fuir l’épidémie sévissant à Florence, jusqu’aux accusations proférées en leur temps contre les Juifs, soupçonnés en certains lieux d’avoir propagé l’épidémie, et victimes de pogroms.
Mais ce qui constitue un lien plus frappant encore entre la peste et le temps présent, ce sont des mesures que l’on croirait d’un autre temps. Plus que le nettoyage des rues auquel se prêtent certaines municipalités et dont l’efficacité est au mieux questionnée (rappelant les fumigations de l’époque médiévale pour chasser les odeurs putrides chargées d’air corrompu), ou la gestion des cadavres et des sépultures, c’est la décision du confinement qui évoque la peste. Expérimentée pour la première fois à Raguse (Dubrovnik) en 1377, puis à Venise, Vérone et à Milan au tournant du siècle, elle a été utilisée tout au long de l’époque moderne pour être abandonnée peu après l’arrivée du choléra en 1831 : une mesure « de terreur », considérée au XIXe siècle non seulement comme inopérante mais aussi « comme violente » et « digne des siècles de barbarie » pour reprendre les mots du médecin et homme politique socialiste, Ange Guépin, en 1836.
Ce dispositif qui remonte aux derniers siècles du Moyen Âge rend compte d’une intervention de l’État dans la gestion de la santé. C’est en effet au nom du « bien commun et de la santé des hommes », de « la conservation de la santé » ou de la « conservation de la cité » que les gouvernements urbains prennent ce type de mesures radicales et se dotent de magistratures de santé : les premières sont nées à Florence et Venise en 1348. Devenues permanentes à Milan au milieu du XVe siècle, elles se généralisent à l’époque moderne.
Certes, l’intervention des autorités communales dans les questions de santé des populations et d’hygiène n’est pas nouvelle au XIVe siècle : que ce soit par le biais de la mise en place de législations et d’officiers chargés de réglementer la gestion et l’évacuation des déchets, ou encore d’un contrôle sanitaire des marchés de denrées, sans oublier, principalement dans les péninsules Italienne et Ibérique, le recrutement de praticiens salariés au service des citadins. L’épidémie a aussi renforcé l’intervention politique. Face à une pathologie dont on pense l’air responsable (en vertu de l’étiologie classique des maladies épidémiques remontant à Galien), mais dont on comprend qu’elle est aussi propagée par la contagion, sous formes de contacts multiples qui embrassent une conception plus large que la seule transmission inter-humaine, de nouvelles mesures sont prises.
Alors que se multiplient les processions, celles des flagellants parcourant l’Europe, ou celles qu’organisent les paroisses pour demander l’intercession de saints réputés efficaces contre les épidémies, les autorités préconisent l’interdiction des foires ou la constitution de « zones franches » permettant l’échange de marchandises sans contact direct, et la fermeture des villes, notamment aux habitants de cités contaminées, sous forme de cordons sanitaires : en 1348, Ferrare et Modène sont interdites d’accès pour ceux venus de Padoue et Venise. Pour autant, ces décisions n’ont été ni uniformes, ni, il faut le rappeler, toujours immédiates.
C’est en effet à l’orée des années 1370, soit plus de vingt ans après l’apparition de la peste, que des mesures de confinement plus radicales ont été prises, fruit de l’expérience éprouvée. Elles visent avant tout à isoler les malades et à protéger la ville. En Lombardie, le pouvoir ducal impose un contrôle de la mobilité des personnes par délivrance d’un laisser-passer de bonne santé dont il est toutefois difficile de connaître les modalités d’établissement. Dès 1374, le comte Bernabò Visconti fait chasser les pestiférés de Milan, les obligeant à se réfugier à la campagne, et instaure un cordon sanitaire. Puis de véritables quarantaines sont mises en place en 1399-1400 lors d’un retour meurtrier de l’épidémie : les malades sont soit enfermés chez eux, soit déplacés hors de la ville (dans des lieux ravitaillés en nourriture, en médicaments et en personnel d’assistance). Ceux soupçonnés de l’être, sans que se manifestent pour autant les signes de l’infection, sont conduits dans un autre site. Ce n’est qu’au XVe siècle qu’apparaîtront, à Raguse et en Italie, les premiers hôpitaux dédiés aux pestiférés.
De nombreux traités de temps de peste rédigés par des médecins sont adressés aux gouvernants ou écrits à leur demande.
Enfin un dernier point retiendra notre attention : l’importance accordée à la parole médicale dans la gestion de la crise, qui pousse les gouvernements à s’entourer d’un cabinet d’experts. Il peut ici paraître surprenant d’évoquer un tel parallèle entre l’époque contemporaine et la période médiévale, plutôt citée, ce qu’on répète comme une antienne, pour l’inanité des soins médicaux prodigués ou pour la fuite des praticiens qui conseillaient, du reste, à leurs riches patients de « partir loin, longtemps et de revenir tardivement ». Si leur implication dans l’organisation sanitaire est loin d’être partout attestée, on ne peut toutefois passer sous silence les efforts des municipalités pour s’attacher les services de médecins bien rémunérés et assignés à résidence ou les autopsies qu’elles sollicitent pour définir les origines de la maladie.
Ainsi, de nombreux traités de temps de peste rédigés par des médecins sont adressés aux gouvernants ou écrits à leur demande, à l’image du conseil composé par la faculté de Paris sur requête du roi Philippe VI en 1348. Un cas, bien documenté, témoigne d’une forte participation sollicitée par le pouvoir : la Lombardie. Au début du XVe siècle, les mesures exceptionnelles prises par le commissaire à la santé, sur impulsion ducale, mobilisent le corps médical : qu’il s’agisse de déclarer les patients dont ils ont la charge, d’inspecter les malades ou d’identifier leur pathologie par l’urine, ou encore de diagnostiquer les causes de la mort, ils sont au cœur de l’enquête sanitaire, qui vise à dépister les malades et à les isoler, à définir les quartiers contaminés et à retracer le chemin de la contagion.
Ces mesures suscitent aujourd’hui comme hier des réactions contradictoires. Les critiques qu’essuient les gouvernements européens dans la gestion de la crise, en termes de négligence et de retard, érigent en modèle les choix politiques et sanitaires de certains pays d’Asie – mise en quarantaine de la ville de Wuhan en Chine et de sa région, dépistage systématique et contrôle de la mobilité des populations via les téléphones portables en Corée du Sud et à Taïwan. On rappellera toutefois que ces décisions sont, comme pour la peste, le fruit de l’expérience de crises sanitaires antérieures, à commencer par l’épidémie de SRAS en 2003. Ces politiques coercitives, réclamées par les uns, sont perçues par d’autres comme une menace pesant sur nos libertés individuelles et suscitent l’inquiétude pour leur coût et leurs conséquences économiques. Au Moyen Âge, c’est surtout la difficulté de leur application et leur prix qui étaient décriés, notamment par ceux censés les mettre en œuvre.
Du rapport du politique au rôle des experts, de la gestion de l’épidémie à l’interrogation sur ses causes et sur ses effets, des réactions de peur et de superstition à la volonté d’une appréhension rationnelle du phénomène, le Moyen Âge est certes loin mais offre aussi un miroir troublant aux questionnements du présent.
