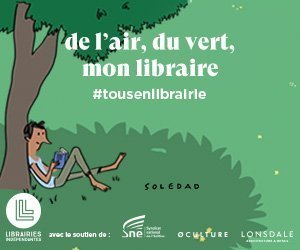Les liens faibles au secours de la cohésion sociale
Avec la fin des grandes actions et théories politiques, la relative désuétude des modalités traditionnelles de mobilisation, des actions d’éclat et proclamations, on peut essayer de penser le commun à partir de concepts négligés et de ressources oubliées. Liens faibles : c’est l’expression qui s’impose, à bas bruit – pour reprendre une expression d’un registre proche, depuis quelque temps pour rendre compte à la fois de nouvelles réalités et de la place qu’elles tiennent dans les existences humaines ordinaires. Visages, objets, musiques, personnages, lieux et situations ordinaires mais irremplaçables dans leurs singularités déterminent notre relation aux autres, nos engagements quotidiens comme le flux de nos identités et les inflexions de nos vies – et ce tout autant que les passions de l’âme, les situations figées, les identifications directes et les affects massifs.
L’article désormais classique de Mark Granovetter, « La force des liens faibles » a introduit la notion à partir de la sociologie en 1973 et si le concept semble lui-même évanescent dans son extension, il nous parle pourtant d’un ensemble de phénomènes aussi divers et hétérogènes que des rencontres d’un jour qui s’inscrivent en nous, l’attachement à tel personnage de fiction, la reconnaissance à l’inconnue qui nous donne une information précieuse via internet, ou au soignant anonyme… On évoquera également les relations au long cours mais lacunaires (ces « amis » qu’on voit tous les dix ans), le souci de victimes inconnues de désastres, de la personne qui a fabriqué le vêtement qu’on porte ; ou encore la solidarité créée par l’occupation d’une place ou d’un rond-point pour quelques semaines, par l’amour partagé d’une équipe sportive, d’un genre musical ou d’une série télévisée.
Wittgenstein parle ainsi d’ « air de famille » pour évoquer ces concepts qui ne renvoient pas à des définitions, « traits » ou « propriétés partagées » mais à des situations liées par des ressemblances, des significations communes, des aspects. Parler de « concept » de lien faible revient ainsi à accepter que nos concepts (qui nous permettent de penser le réel) soient suscités, nourris et également transformés par des expériences : qu’un concept, autrement dit notre capacité concrète, effective, à penser quelque chose, requiert de cultiver un certain nombre de liens de fait, multiples et enchevêtrés, avec le réel même. Le concept de lien faible est bien ancré dans des « types » de situation et d’expérience.
En démontrant que des liens étrangers aux solidarités familiales, professionnelles et amicales immédiates jouent un rôle déterminant dans nos socialités et que les liens indirects entre individus se connaissant mal sont « des instruments indispensables aux individus pour saisir certaines opportunités » et participent pleinement de « leur intégration au sein de la communauté », alors qu’au contraire, les liens forts peuvent isoler les individus dans des cliques encastrées et incapables de communiquer entre elles (pensons aujourd’hui aux véritables silos idéologiques produits par les réseaux sociaux numériques), Granovetter a profondément marqué la sociologie moderne : ouvrant la porte à une approche structurale des socialités, refusant l’individualisme sociologique et l’utilitarisme économique, la théorie des liens faibles nous conduit à regarder la cohésion sociale dans des termes inédits.
Plus largement, le concept de lien faible offre des outils nouveaux pour analyser notre relation de projection ou d’affection pour des modèles originaux, et permet de décrire bien des aspects et rapports de notre vie numérique contemporaine. Le concept est opératoire du côté de la politique lorsqu’elle s’intéresse aux liens sociaux dans l’espace public ou au souci des autres lointains, du côté de l’écologie si l’on essaie de penser notre lien à l’environnement ou aux animaux, du côté des arts et de la fiction, notamment télévisée, si l’on pense à l’attachement aux objets et personnages : il n’y a pas d’existence sans résonance, d’identité sans solidarité, de coprésence sans interférence.
Les liens faibles disent la richesse et la pluralité des attachements, leur dimension affective et émotive.
Nous ne sommes pas éloignés de plus de 4,74 « liens faibles » de n’importe quel autre individu sur Terre, comme l’ont montré de récentes expériences de sociométrie menées sur Facebook : la faiblesse des liens préside à l’accessibilité du monde, sa petitesse au regard des liens numériques permet de le rêver comme une communauté en dehors de systèmes de contraintes normatifs imposés. Gouvernée et organisée par ces signaux faibles que sont les interactions sur les réseaux sociaux, les communautés nées du numérique, nourries d’innombrables échanges de basse intensité, sont capables de puissantes mobilisations.
Fait social autant que culturel, massif et diversifié, l’émergence de ces communautés sur les réseaux sociaux et les forums illustre bien les modalités contemporaines d’organisation de formes de vie démocratiques à partir des liens faibles. Ainsi des amateurs qui évaluent, discutent, et produisent des débats critiques et une réflexion collective, des mobilisations politiques nées d’internet produisant des formes relationnelles originales ou encore des contributeurs de Wikipédia qui bâtissent une intelligence collective à partir d’interactions faibles.
L’analyse de ces interactions qui produisent un nombre considérable de données est de nature à changer la donne de l’innovation et de la décision sociale et scientifique, par la prise en compte de données négligées, d’indicateurs reconfigurés ou de signaux faibles. Les big data permettent ainsi d’accorder un rôle autant à l’examen des tendances lourdes qu’à des faits mineurs émergeant des silos de données dans lesquels les plateformes veulent les enfermer, offrant comme opportunité aux sciences humaines et sociales de nouveaux outils de compréhension du monde.
Offrant une meilleure prise en compte du mineur, de l’invisible et de l’émergent à l’heure du numérique, les liens faibles disent la richesse et la pluralité des attachements, leur dimension affective et émotive, telle que l’ethnométhodologie peut les observer et la théorie des acteurs réseaux les décrire : comme le note Antoine Hennion, la notion d’attachement « ne préjuge pas de la qualité ni de l’importance de ces liens : [elle] a le mérite d’oser rester dans un certain flou, une indétermination première » et permet de remplacer une perception rigide des structures de pouvoir par un désir de s’intéresser au mouvement concret des choses et des êtres.
Le développement de l’éthique du care a également permis de mettre en évidence l’importance, pour la perpétuation d’une forme de vie, de liens créés par des gestes minuscules et quotidiens dont la pertinence morale et politique est sinon contestée, du moins régulièrement dévalorisée en comparaison des actions morales typiques de tonalité virile.
Le motif anthropologique chez le second Wittgenstein a aussi conduit à replacer le locuteur dans l’ensemble des liens pratiques et ténus qui le relient au monde, qui sont intégrés au mode d’existence d’un être qui parle ; l’humain ordinaire est en « conversation » et constamment en lien avec autrui, même (ou surtout, comme l’a montré Goffman) dans l’échange « formel », consacré au maintien des apparences normales et des relations rassurantes. C’est cette conception de l’accord et de la convention en termes de « lien » qui est sous-jacente au passage des Recherches philosophiques qui résume l’anthropologie de Wittgenstein.
La texture de la vie humaine est celle de liens constamment menacés de rupture mais qui tirent leur résistance de leur recoupement.
« C’est ce que les êtres humains « disent » qui est vrai et faux ; et ils s’accordent dans le « langage » qu’ils utilisent. Ce n’est pas un accord dans les opinions mais dans la forme de vie. Pour que le langage soit moyen de communication, il doit y avoir non seulement accord dans les définitions, mais (aussi étrange que cela puisse paraître) accord dans les jugements. Cela semble abolir la logique, mais ce n’est pas le cas. »
Wittgenstein dit que nous nous accordons « dans » et pas « sur » le langage – ce qui signifie que nous ne sommes pas acteurs de l’accord, que le langage précède autant cet accord qu’il est produit par lui et qu’il ne s’agit pas du lien fort de la convention, de l’intégration ou du contrat, mais du lien faible de l’harmonie en place dans les pratiques : à aucun moment nous ne sommes « tombés » d’accord. S’accorder « dans » le langage veut dire que le langage comme lien produit notre entente autant qu’il est le produit d’un accord. Stanley Cavell ajoute, dans son ouvrage classique Dire et vouloir dire, que Wittgenstein désire ainsi indiquer à quel point le lien est premier par rapport à l’appel aux règles ou aux principes :
« Que ce soit ce qui arrive est affaire de ce que nous avons en commun des voies d’intérêt et de sentiment, des modes de réaction, des sens de l’humour, de l’importance et de l’accomplissement, le sens de ce qui est scandaleux, de quelle chose est semblable à telle autre chose, de ce qu’est un reproche, de ce qu’est le pardon, des cas où tel énoncé est une affirmation, où c’est un appel, et où c’est une explication – tout ce tourbillon de l’organisme que Wittgenstein appelle des « formes de vie ». La parole et l’activité humaines, leur santé mentale et leur communauté ne reposent sur rien de plus que cela, mais sur rien de moins non plus. »
Rien de plus, rien de moins : il s’agit bien des liens faibles comme fils de ce qui constitue la texture sensible – langagière, éthique, sociale, affective – de l’ordinaire. La texture de la vie humaine est celle du grouillement des formes de vie, des connexions multiples des actions et des personnes, de liens constamment menacés de rupture, mais qui, comme les liens qui constituent un câble, tirent leur résistance de leur recoupement.
Car s’il est trop facile de renverser l’équation terme à terme, de parler de « force » des liens faibles, il est clair que ces liens sont une nouvelle source de « résistance » contre l’individualisme néolibéral et la violence des désolidarisations qu’il impose : c’est ce que montrent aujourd’hui autant les attentions discrètes qui réparent nos vies ordinaires et étoffent nos imaginaires que les techniques plus spectaculaires de rébellion et de mobilisation.
NDLR: Alexandre Gefen et Sandra Laugier ont publié Le Pouvoir des liens faibles, en janvier 2020 aux éditions du CNRS. Leur a été publié pour la première fois le 21 février 2020, dans le journal AOC.