Qui sont les Taliban ?
Le retrait occidental d’Afghanistan met les Taliban en position de prendre le pouvoir dans les prochains mois ou, à défaut, d’être le principal acteur politico-militaire d’une nouvelle phase de la guerre civile. Le moment est donc bien choisi pour rappeler ce que l’on sait – et ne sait pas – d’un mouvement qui, depuis sa formation en 1994, a souvent été mal compris, ce qui a grandement contribué à la défaite de l’OTAN. La nature du mouvement n’a pas d’ailleurs pas qu’un intérêt historique dans la mesure où les Taliban sont aujourd’hui un interlocuteur incontournable et que leur retour au pouvoir aurait des implications importantes pour la sécurité occidentale. Nous présenterons successivement quelques fausses idées sur le mouvement, son projet politique et, enfin, ses possibles évolutions.
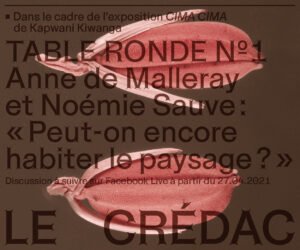
Comme l’ont montré les conflits contre le régime baasiste et l’État islamique, il est habituel pour les militaires occidentaux de surévaluer les forces adverses. Il est d’autant plus surprenant que la coalition, malgré une situation sécuritaire de plus en plus difficile, a continué pratiquement jusqu’à la décision de retrait de sous-estimer son ennemi. Le discours dominant – des experts jusqu’aux généraux otaniens en passant par les médias – a présenté le mouvement comme « chaotique », « inorganisé », « moyenâgeux ». En réalité – ce qui montre l’épaisseur du filtre idéologique – tous les éléments empiriques étaient là pour attester du contraire, notamment un système judiciaire bien organisé, un appareil de propagande efficace et une discipline interne raisonnablement respectée.
Ces faits reflètent la nature centralisée du mouvement et, en particulier, l’existence d’une direction soudée par une socialisation commune. En effet, les leaders talibans à l’origine de la formation du mouvement sont des religieux passés par les mêmes madrassas, en premier lieu la madrassa Haqqaniyya (située au Pakistan). La solidarité de ce groupe a permis la continuation du mouvement, même après la sévère défaite militaire de 2001, et des successions sans heurts entre les différents leaders.
Signe de la discipline interne du mouvement, les équipes de négociateurs talibans sont bien organisées comme l’ont montré les négociations à Doha avec les États-Unis qui ont conduit à l’accord de retrait en février 2020. Malgré les tentatives de la coalition pour faire éclater le mouvement, les dissidences ont été rares, et les seules d’importance sont quelques groupes passés à l’État islamique au Khorassan, que les Taliban combattent sans pitié.
Les Taliban ont développé une stratégie d’ouverture aux autres ethnies qui explique leurs succès dans le nord du pays.
Un autre contre-sens sur le mouvement Taliban a été de le présenter comme une expression ethno-nationaliste des Pachtounes (le premier groupe ethnique en nombre, sans être majoritaire). Une majorité de combattants sont effectivement des Pachtounes. Le mouvement est né dans le sud de l’Afghanistan et s’est déployé sans beaucoup de combats dans les régions pachtounes. Pour autant, dans les années 2000, les Taliban ont développé une stratégie d’ouverture aux autres ethnies qui explique leurs succès dans le nord du pays.
Cette transformation du mouvement n’était pas assurée de réussir du fait que la conquête du nord de l’Afghanistan par les Taliban dans les années 1990 avait été particulièrement brutale, mais elle semble avoir payé puisque, dans certaines provinces du nord, une proportion importante des combattants sont aujourd’hui des Ouzbeks et des Tadjiks. En dehors des chiites, les Taliban sont représentés dans pratiquement tous les groupes et peuvent revendiquer une assise nationale, alors que les partis légaux sont de plus en plus régionalisés/ethnicisés.
Quel est le projet politique des Taliban ? Pour autant qu’on puisse le savoir, il est resté essentiellement le même : un émirat islamique d’Afghanistan reposant sur la charia. Jusque-là, le mouvement n’est pas très différent de la plupart des mouvements politiques depuis les années 1980. L’originalité des Taliban est d’avoir imposé un modèle gouvernement théocratique totalement inconnu dans l’histoire afghane : la légitimité vient de Dieu par l’intermédiaire de mollah Omar, les élections sont interdites, la législation repose essentiellement sur des décrets du leader, etc.
Pour autant, il s’agit d’un charisme étroitement encadré par le système judiciaire chariatique (l’interprétation des Taliban est de ce point de vue fondamentaliste, mais pas innovante). Par rapport à d’autres mouvements afghans, les Taliban se caractérisent par leur volonté de rétablir un État centralisé, assez prégnant dans la tradition afghane, d’où leur succès auprès d’une partie de la population, lassée de la corruption et de l’inefficacité du régime.
Quelles évolutions ont traversé le mouvement, depuis vingt ans de guerre acharnés ? D’une part, la disparition du leader charismatique du mouvement, mollah Omar, a produit des changements sur la structure interne de l’organisation qui est devenue par nature plus collective. De plus, la disparition de mollah Omar ouvre à des évolutions : les élections comme principe de légitimation ne sont plus exclues (avec un contrôle à l’iranienne sur les candidatures).
Sur un plan constitutionnel, l’écart semble s’être réduit entre les positions des Taliban et celles des principaux partis afghans légaux, car tous ont un centre de gravité fondamentaliste. Le conflit porte d’abord sur le contrôle des institutions, notamment sécuritaires, et des ressources économiques. D’autre part, le mouvement s’est ouvert à la modernité technologique (on voyait déjà des signes dans ce sens en 2000) ; leur propagande utilise les réseaux sociaux et les films (alors que la TV était interdite), leur attitude s’est assouplie par rapport à la musique. Cette transformation générationnelle est là pour perdurer, même si les Taliban prennent le pouvoir.
Les Taliban restent en premier lieu un mouvement essentiellement nationaliste, à l’opposé de la vision internationaliste d’al-Qaïda ou de l’État islamique.
Par ailleurs, les Taliban restent fondamentalistes, leurs rapports avec la bourgeoisie urbaine qui s’est développée depuis 2001 restent profondément conflictuels. Par exemple, la place des femmes dans le travail salarié, déjà remise en cause depuis le retrait de l’essentiel des forces occidentales en 2014, est maintenant frontalement menacée (en dehors probablement du secteur médical).
Inutile de dire qu’un exode généralisé de ce groupe social, plusieurs centaines de milliers de personnes, porterait un coup sévère à tous les projets de développement. Par ailleurs, les libertés religieuses pour les chiites sont directement menacées, même si les Taliban sont à l’antipode du projet génocidaire qui anime l’État islamique au Khorassan.
Enfin, et c’est ce qui préoccupe le plus les gouvernements occidentaux, les relations entre al-Qaïda et les Taliban ne se sont pas interrompues ces deux dernières décennies. Rappelons que les Taliban n’étaient pas impliqués dans l’organisation du 11 septembre (comme l’ont admis les États-Unis), mais qu’ils n’ont pas expulsé Ben Laden, ce qui provoqué l’invasion américaine.
Malgré ce qui pourrait apparaître comme une trahison, les Taliban ont gardé des relations avec al-Qaïda, qui ne manque jamais de rappeler sa pleine allégeance au mouvement. Les Taliban ont cependant déclaré de façon répétée que le territoire afghan ne servirait pas de base arrière pour préparer un attentat, ce qui reflète une nécessité tactique dans le cadre des négociations ou un engagement réel. Les Taliban semblent ici pris entre deux logiques.
Ils restent en premier lieu un mouvement essentiellement nationaliste, à l’opposé de la vision internationaliste d’al-Qaïda ou de l’État islamique. En particulier, aucun attentat à l’étranger n’a été revendiqué par les Taliban et leur priorité est bien la reconnaissance internationale avec, peut-être, une aide économique en échange d’une éradication de l’opium. Ils ont désormais un statut d’interlocuteur dans les capitales régionales, notamment en Russie et (prudemment) en Iran (qui soutient par ailleurs al-Qaïda).
En second lieu, les liens avec al-Qaïda n’ont pas été rompus. Or, l’implantation d’al-Qaïda en Afghanistan n’a jamais été aussi forte avec des centaines de militants actifs et le retrait définitif des forces occidentales se traduira par une difficulté croissante à obtenir de l’information pour opérer des frappes (la dégradation du renseignement, déjà sensible depuis quelques années, explique la multiplication des pertes civiles).
Au mieux, l’Afghanistan deviendra un sanctuaire pratiquement inexpugnable pour les militants d’al-Qaïda, au pire une base arrière opérationnelle. L’espoir des États-Unis est que la volonté des Taliban de s’intégrer à l’ordre international prévaudra finalement sur les solidarités combattantes. À l’évidence, rien ne garantit l’efficacité de cette option mais, après vingt ans à multiplier les fautes stratégiques, les États-Unis se trouvent cruellement dépourvus de choix.
NDLR : Gilles Dorronsoro a récemment publié Le gouvernement transnational de l’Afghanistan. Une si prévisible défaite. aux éditions Karthala.
