Les multiples défis de nos planétarités
La notion de « planétarité » a le double avantage de « faire image » dans notre tête et de nous ouvrir l’esprit à une pluralité de visions du monde, du globe, de la Terre, de Gaïa. Quel que soit le terme utilisé pour dénommer notre planète, tenter d’en figurer la forme et l’à-venir, avec ses animaux et ses éléments physico-chimiques, ses êtres et ses agents, ses plantes et ses phénomènes cosmologiques nous incite à la pensée et, peut-être, à l’action. Face aux incendies, aux inondations et aux pandémies qui nous attendent sans aucun doute au coin de la rue comme de la forêt, nos devenirs planétaires dépendent des façons dont nous nous serons imprégnés, orientés par nos rêves et nos cauchemars, nos peurs et nos espoirs, nos sciences et ces mythologies que nous ne cessons de réinventer…
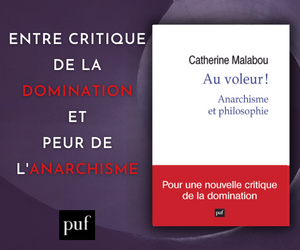
Monde, globe, géopolitique, Terre, Gaïa
Commençons par poser et éclairer les différences de vocabulaire. Le monde est ce qui fait sens du point de vue autocentré d’une certaine culture : les individus et les collectifs humains se construisent des mondes pluriels à l’intérieur d’un même environnement, selon les systèmes symboliques qu’ils ont développés pour s’y orienter. Le défi du multiculturalisme tient à reconnaître qu’entre voisin·es au sein d’une même ville, nous vivons souvent dans des mondes différents.
Ce que nos usages actuels désignent par le terme de globe reste centré sur les valeurs humaines, et plus particulièrement sur des modes de valorisations économiques et financières qui s’appliquent maintenant à travers les cultures et tous les continents. Comme le dit Dipesh Chakrabarty, « l’histoire de la globalisation place les humains en son centre et raconte comment les humains ont forgé historiquement un sens humain du globe[1] ». La globalisation poursuit (et parfois renverse) une expansion coloniale qui se mène à coup de conquêtes financières et de dépendances logistiques.
Ce qu’il est convenu d’appeler la géopolitique se propose depuis plus d’un siècle de traduire en accords intergouvernementaux les idéaux cosmopolites formulés de façon insistante, à l’échelle européenne, depuis le XVIIIe siècle. Héritière du système des États-nations, et grevée par leurs indécrottables myopies souverainistes, elle a permis d’indéniables avancées – comme le protocole de Montréal de 1989 sur la protection de la couche d’ozone. Mais les impuissances voire les hypocrisies des COP récentes démontrent l’insuffisance dramatique d’un cosmopolitisme qui n’est souvent que de façade.
La Terre reste quant à elle « notre Terre », encore positionnée (dans notre imaginaire quotidien pré-copernicien) au centre de « notre » système solaire : « Vous ne pouvez pas séparer ce qu’on a appelé “la Terre” de l’expansion européenne et du commerce, avec leurs effets sur la cartographie et sur le développement des instruments de navigation[2] ». Sauf qu’à l’inverse, une fois jetés aux oubliettes les rêves obscènes de quelques milliardaires jouissant insolemment de leur tourisme orbital, nous n’avons d’autre choix à court terme que de « garder les pieds sur terre » – au sein de territoires dont les enclosures souvent illusoires et jamais totales sont nécessairement hantées par les extériorités qui leur sont mitoyennes.
Les références faites à Gaïa par Lynn Margulis, James Lovelock ou Bruno Latour peuvent également être considérées comme des premiers pivots de déplacement de l’intériorité mondiale-globale-terrestre vers l’extériorité planétaire. Avec son héritage controversé de figure divine, Gaïa conserve une face rassurante en tant que système d’autorégulation qui tend à corriger lui-même ses déséquilibres dans certaines limites, laissant espérer quelque pérennité de notre monde terrestre.
Appréhendé comme une entité « vivante » à sa façon multipolaire et sans le moindre pilote, le « Système-Terre » de Gaïa fait miroiter l’espoir (mystique ?) d’un vitalisme capable de resurgir par ses forces propres, au-delà des destructions auxquelles il peut être soumis. Lorsque Isabelle Stengers met les catastrophes déchaînées par le capitalisme sous l’égide d’une « irruption de Gaïa[3] », elle révèle toutefois la face planétaire d’une puissance bien moins rassurante, dont les évolutions peuvent aussi bien être compatibles qu’incompatibles avec la survie de nos mondes humains. Lorsque la planète éternue, que deviennent les êtres de Gaïa ?
Planète et planétarité
La référence à la planète constitue le terme le plus décentré – et le plus déhumanisé en apparence – de cette série. Au moment même où nous commencions à parler d’Anthropocène pour mettre les industries humaines au cœur des dynamiques géophysiques, les approches relevant des Earth System Sciences (ESS) sont devenues un pivot majeur entre la Terre, Gaïa et la planète : elles décrivent un univers de forces physico-biologiques parfaitement indifférent aux intérêts humains, à peine plus concerné par la faune et la flore. Un univers qui, contrairement à celui de la globalisation, semble échapper complètement à notre contrôle, à nos valeurs comme à nos échelles d’intervention, du moins à court ou moyen terme.
Comme le souligne Lukáš Likavčan dans son Introduction to Comparative Planetology, la planète introduit une extériorité radicale dans la façon dont nous devons ré-envisager nos environnements[4]. Nous étions au cœur de notre monde, les pieds posés sur notre Terre, commerçant sur notre globe en croyant plus ou moins aux gesticulations d’une géopolitique a priori pacificatrice. Nous nous découvrons embarqué·es sur une planète orbitant parmi des milliards d’autres objets astronomiques, une planète certes unique mais dont rien ne dit qu’elle pourra continuer à accueillir nos êtres si fragiles.
Souvenons-nous de classiques des salles obscures, de Planète interdite[5] à Planète hurlante[6], de la désormais mythique Planète des singes[7] au merveilleux dessin animé La Planète sauvage[8]. Qu’il s’agisse de la nôtre ou de l’une de ses sœurs dorénavant baptisées exoplanètes, la planète nous invite à une prise de recul dans le temps et dans l’espace. Elle nous éclaire du passé vers le futur, de notre fine biosphère qui pourrait être la seule du genre jusqu’aux possibilités théoriques et imaginaires de vie ailleurs qu’explorent depuis peu nos télescopes et depuis la nuit des temps nos esprits en quête de mondes alternatifs.
Nous nous situons là dans la perspective de la planétarité, telle que la circonscrit William E. Connolly : « En parlant du planétaire, je désigne une série de champs de forces temporels tels que les systèmes climatiques, les zones de sécheresse, les courants océaniques, l’évolution des espèces, les reflux des glaciers et les ouragans, qui manifestent des capacités d’auto-organisation à divers degrés, et qui conditionnent la vie humaine en se conditionnant les uns les autres de multiples façons[9] ».
Le tournant copernicien auquel nous appelle la planétarité consiste donc à réenvisager nos vies, nos villes, nos dynamiques économiques et nos systèmes politiques en considérant « notre » planète comme « une » planète parmi d’autres – une planète que rien ne prédestine à rester habitable pour nos formes de vie si vulnérables.
Ce tournant planétariste réveille et rebat les cartes de nos imaginaires cosmologiques, interpellant nos subjectivités individuelles et nos cultures communes. Il interroge à nouveaux frais nos devenirs individuels ou collectifs, à la lumière d’un triple décentrement : d’abord via les échelles spatiales, depuis nos politicailleries nationales vers des problèmes transcontinentaux, conditionnés par notre distance au soleil ; ensuite aux échelles temporelles, les hydrocarbures ayant pris des millions d’années pour se former, alors que les déchets nucléaires menaceront nos santés pendant plus de 100 000 ans ; et enfin au filtre de nos modalités d’actions intentionnelles collectives, nos « agentivités » devant se coordonner grâce à des dispositifs de consultation et de décision parfaitement inédits à nos dimensions multiculturelles.
Le planétaire n’est pas le global
À travers ce triple décentrement qui nous fait considérer les formes de vie terrestres dans leur bizarrerie astronomique du point de vue de leurs conditionnements géophysiques, la planétarité nous met d’abord au défi de dés-humaniser nos perceptions et nos conceptions, avec tous les risques que charrie « l’inhumain » – celui auquel nous faisons face à l’extérieur, comme celui qui nous hante depuis l’intérieur.
Ce défi de prise de distance vis-à-vis de « l’humain » se voulant seul et au centre de tout s’articule en au moins sept contrastes entre le global et le planétaire, dont chacun mérite à la fois d’être pris en compte et d’être contesté.
1° La planétarité nous impose de réfléchir et d’agir à des échelles incommensurables, à des années-lumière de nos conceptions de la globalisation. Le global est généralement promu ou incriminé en termes de prix de marchandises, de facilités d’approvisionnement ou de taux de chômage, avec des fourchettes temporelles allant de l’année à la décennie, et des rayons d’opérations coextensifs aux bassins d’emplois. Le planétaire nous engage sur des siècles et des millénaires, affecte les capacités de survie de sous-continents entiers. La disproportion est criante entre les échelles des décisions politiques (dont les objets sont municipaux, nationaux ou au mieux fédéraux, selon des rythmes au mieux quadriennaux ou quinquennaux) et les échelles de pertinence planétaire (dont les « hyperobjets[10] » excèdent nos capacités sensibles et cognitives héritées des temps modernes).
2° Le planétaire invalide la distinction même que nous faisons entre le local et le global. Les coupes de bois en Amazonie posent un problème planétaire qui est à la fois strictement local (quel régime de propriété, quels crimes contre les populations autochtones, quelle corruption gouvernementale à Brazilia) et éminemment global (quel prix du soja, quels cheptels de bétail à nourrir en Europe), sans se réduire à aucun des deux. Le destin du planétaire se joue aussi bien, simultanément et indissociablement, à l’échelle nano de la multiplication de nos visages sur écrans qu’à l’échelle macro des gigatonnes de gaz à effet de serre envoyés dans l’atmosphère. Le planétaire opère selon des dynamiques d’inséparation, d’essaim, de fractalité, de contagion virale, au sein desquelles les relevés statistiques émanent toujours de dimensions locales tout en entraînant des effets d’agrégation supra-locaux.
3° Alors que les problèmes écologiques de la globalisation se posent en termes de modes de vie, les problèmes de planétarité se posent en termes d’habitabilité. Dans un cas, on calcule des ressources pour gérer des flux dans des perspectives (contradictoires) de prospérité ; dans l’autre, on calcule des seuils de température et d’humidité, de radioactivité ou d’extinction, au-delà desquels les corps ne peuvent survivre.
4° Alors qu’on croit pouvoir « manager » le global par des systèmes logistiques coordonnant en temps réel des chaînes d’approvisionnement de plus en plus complexes, le planétaire nous confronte à des enchevêtrements dont les intrications s’avèrent ingérables par nos mécanismes et dispositifs même les plus sophistiqués. Le basculement du global au planétaire n’est pas seulement une affaire d’échelle, d’expansion ou de connexion (spatiale ou temporelle) : c’est tout autant une affaire d’intensités, de résurgences, de nœuds et de conjonctions imprévisibles ou du moins irréductibles à la multiplication des connexions. Les environnements ne sont pas plus des systèmes que les tissus vivants ne sont des réseaux[11].
5° Le planétaire requiert une multiplication d’approches totalisantes, mais en échappant à toute saisie globale comme à toute réduction schématique. Nos attentions sont habituées à se focaliser sur des figures érigées en objets alors que, comme le suggère Dipesh Chakrabarty, la planète « demeure à l’arrière-plan. […] C’est la condition informelle des formes. Et c’est aussi pourquoi elle résiste à la politisation. Rien dans l’histoire de la planète ne permet de fonder nos impératifs politiques[12] ». Nous devons apprendre à regarder au-delà des « figures » (les chiffres, les visages, les Gestalts humaines) pour prêter attention aux « fonds » (atmosphères, environnements, milieux).
6° La planétarité induit la potentialité d’autres planètes, habitables ou non, du moins par d’autres formes de vie, même très primaires. Là où la vision globale de l’humanité incite à penser le « hors-Terre » de notre galaxie et de notre système solaire en termes d’expansion, voire de colonisation humaine, une réflexion à partir de nos « devenirs planétaires » oriente nos réflexions et nos explorations sous le regard d’un ailleurs de l’existence, que celle-ci soit la nôtre ou celle d’autres êtres. Elle nous pousse à imaginer l’immense variété des possibles du vivant mais aussi, tout à l’inverse, à expérimenter (et à critiquer) « l’existence capsulaire » de ces astres artificiels et minimaux que sont nos actuelles stations orbitales, ou que seraient demain des arches spatiales ou des terrariums, à la façon de ceux du long métrage Interstellar (2014) de Christopher Nolan ou du roman 2312 (2012) de Kim Stanley Robinson.
7° Le global a ses avocats et ses pourfendeurs, qui ont appris à relayer leurs convictions par les mobilisations politiques pour menotter les interventions étatiques ou pour renverser le capitalisme. Car comme le suggère la citation de Chakrabarty, le planétaire défie notre définition même de ce qu’est et de ce que fait la politique. Pour certains, garantir l’habitabilité de la planète nécessiterait de faire appel à des géo-technologies de pouvoir, qui remettent profondément en question la centralité de nos politiques libérales et démocratiques basées sur l’individualisation des choix[13]. Pour d’autres, le « géopouvoir » qui s’ébauche sous couvert de planétarité est la simple poursuite des politiques libérales et néo-libérales qui défendent certains intérêts dominants sous couvert de « laisser la nature régner[14] ». Il serait pourtant sans doute trop rassurant de croire que cette opposition caricaturale suffit à tracer des lignes de front autour desquelles pourraient se reconstituer les conflits politiques de la planétarité. Nul ne peut vraiment dire avec confiance si une autre (conception ou pratique de la) politique est possible – une politique proprement planétaire – mais il est certain qu’elle est nécessaire.
Planétarités = Désoxydentalisation
De tels contrastes entre le global (à l’intérieur duquel nous continuons à raisonner, pour ou contre lui) et le planétaire (que nous peinons à imaginer) font émerger au moins trois défis majeurs pour les mois et les années à venir.
Le premier défi de la planétarité nous appelle à inventer – dans l’urgence – une autre définition de l’être-humain-comme-praxis, porteuse d’une autre terraformation de notre planète. Le philosophe-écrivain camerounais Lionel Manga nous apprend à renommer « oxydentales » les visions du monde, de la Terre et du globe qui continuent à entraver nos devenirs planétaires, pour ne jamais oublier le rôle central que l’Occident joue dans l’Oxydation de notre planète – les émissions de dioxyde de carbone qui surchauffent nos milieux de vie ayant déjà commencé à occire d’innombrables humains et non-humains[15].
Les politiques subalternes de Gyatri Spivak, la philosophie décoloniale de Sylvia Wynter et l’analyse des grammaires de racialisation de Denise Ferreira da Silva peuvent nous aider à détricoter la définition encore dominante de l’Homme (riche, blanc, mâle, hétéro, individualiste possessif), en vérité une simple façon parmi d’autres d’être-humain-comme-praxis. Car l’enjeu est d’éviter de perpétuer le modèle (raciste, patriarcal, extractiviste) de l’homo œconomicus au sein d’une « globalisation » qui s’avance trop souvent masquée d’un visage se voulant postcolonial, portant ainsi son mensonge conscient ou inconscient jusqu’au sein de certaines définitions du terrestre[16].
Une planétarité désirable pour l’ensemble des vivant·es ne pourra se décoller de la globalisation capitaliste qu’en se mettant à l’écoute des pensées décoloniales, en particulier de celles qui adoptent la perspective des Afriques diasporiques entrées dans le traumatisme de la modernité plantationnaire en sortant de la cale esclavagiste[17]. Nos planétarités devront impérativement passer par une « désoxydentalisation ». L’avenir de la planète ne peut nous apparaître que comme extra-terrestre (extra-européen, afro-futuriste peut-être[18]), dès lors que nous avons jusqu’ici identifié l’humain et la vie sur Terre à l’individualisme possessif conquérant de l’homo œconomicus et du settler globalisés.
Cela se traduit en termes immédiatement politiques, à l’échelle des prochaines élections françaises, par le besoin de resituer dans une approche planétaire les phénomènes migratoires qui piègent actuellement nos politiques national(ist)es. Il s’agit sous ce regard de « mouvements sociaux » dont les échelles et les enjeux sont largement inédits, par lesquels notre avenir commun nous appelle à décentrer nos perspectives, sous peine d’une déshumanisation suicidaire.
Les réfugié·es que l’Europe, le Royaume-Uni et les États-Unis font périr à leurs frontières ne sont que l’avant-garde de ce qui ne sera ni une « invasion » ni un « grand remplacement », mais un redimensionnement de nos existences inéluctablement planétarisées. On peut martyriser quelques personnes en détresse – au prix d’une terrible myopie et d’une criminelle déshumanisation – mais l’Occident ne pourra pas repousser infiniment une planétarité nécessairement désoxydentalisante.
Planétarités = Propriétés > Usages > Hospitalités
À la logique extractiviste de l’homo œconomicus oxydental qui ravage nos milieux de vie, fondée sur la propriété individualiste, Lukáš Likavčan propose de substituer des approches centrées sur les modalités d’usage, nouant l’écologie à la redécouverte des communs : « Nous pouvons abandonner le cadre de la propriété (ownership) pour évoluer vers un nouveau cadre d’usages partagés (usership), au sein duquel l’utilisation (ou la délégation d’utilisation) d’une certaine ressource n’est pas conditionnée par la possession de cette ressource, mais par l’appartenance à un collectif d’utilisateurs, qui gère et entretient en commun la distribution de cette ressource ou son accessibilité[19] ».
L’un des principaux défis de nos planétarités à venir tient au besoin de compléter nos conceptions de « la politique », actuellement centrées sur des questions d’institutions (propriété, citoyenneté, République, parlements), par des approches qui la situent tout autant, voire bien davantage, au niveau des infrastructures (usages, modes de fonctionnement, besoins, impacts).
Comme le dit encore Likavčan, « nous devons renverser les rapports entre la figure et le fond, et reconnaître les infrastructures comme porteuses d’une des principales puissances d’agir planétaires à notre disposition, puisqu’elles peuvent intervenir là où les États-nations livrés à eux-mêmes échouent à agir. […] Cette reconnaissance de l’agentivité non-humaine des infrastructures planétaires conduit toutefois à une situation où nous ne pouvons plus savoir avec certitude dans quelle mesure nous sommes les opérateurs des technologies, ou dans quelle mesure ce sont les technologies qui nous opèrent[20] ».
Mettre les questions d’infrastructures et d’habitabilité planétaire au cœur de nos délibérations politiques invite à poser toute une série de questions très inconfortables, qui désorientent considérablement nos clivages hérités (droite/gauche, libéraux/socialistes, industrialistes/écologistes). Trois exemples parmi bien d’autres :
1° Dans quelle mesure les besoins d’habitabilité sur notre planète appellent-ils un retour explicite et volontariste d’une planification que l’idéologie néolibérale prétendait reléguer aux oubliettes du socialisme réel (tout en l’implémentant dans des entreprises globalisées comme Walmart ou Amazon[21]) ?
2° Malgré les peurs (souvent justifiées) suscitées par « la surveillance » numérique, ne faut-il pas miser sur la multiplication ubiquitaire des capteurs et sur l’intensification de la « computation à l’échelle planétaire » pour subjuguer les dérives consuméristes et les offuscations industrielles qui ruinent nos milieux de vie[22] ?
3° En même temps que des pratiques relocalisées s’efforcent d’ajuster nos formes de vie à l’habitabilité de bio-régions, ne faut-il pas faire sauter le tabou qui condamne a priori toute forme de géo-ingénierie, pour reconnaître que certaines pratiques de capture et de séquestration du carbone sont un moindre mal, étant donné notre incapacité avérée à réduire (assez rapidement) nos émissions de gaz à effet de serre par des baisses de consommation[23] ?
Quelles que soient les difficultés de tels problèmes, ils demandent peut-être non seulement de passer des questions de propriété (ownership) à des questions d’usages partagés (usership), mais ils appellent surtout à se méfier des attitudes d’utilisateurs (usership), intrinsèquement extractivistes, pour développer des pratiques d’hospitalité (hostship), qui nous apprennent à respecter simultanément ce qui nous accueille et celleux que nous accueillons. L’optique planétaire nous invite simultanément à nous considérer comme des hôtes (guests) au sein de milieux de vie (« naturels »), dont nous devons reconnaître et sanctuariser les conditions de reproduction, et comme des hôtes (hosts) au sein d’infrastructures (« artificielles »), qu’il nous appartient de rendre accueillantes envers les multiples formes de vie dont nous participons.
Planétarités = Infrastructures de soustraction
Dans un très important ouvrage récent intitulé Héritage et fermeture, Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et Alexandre Monnin esquissent la nécessité de développer une écologie du démantèlement pour faire face à la multiplication de ce qui devrait être reconnu comme des « communs négatifs »[24].
Alors que nous avons pris l’habitude trop confortable de ne parler de « communs » que pour des ressources désirables (eau potable, air respirable, terres cultivables, forêts, mais aussi langue commune ou savoirs vernaculaires), nous nous trouvons confrontés à des communs d’un nouveau type, qui ne constituent pas des ressources mais des nuisances ou des dangers. C’est le cas des déchets nucléaires, du continent de plastique ou des gigatonnes de méthane et de dioxyde de carbone envoyés dans notre atmosphère, qui constituent tous des problèmes inéluctablement communs à une échelle directement planétaire.
Dès lors, la tâche d’une écologie du démantèlement ne consiste pas seulement à « gérer » ces déchets : la difficulté consiste à devoir démanteler les infrastructures de production qui engendrent ces nuisances mais dont dépendent encore largement nos subsistances. Ces infrastructures sont autant à entendre au sens de hardware (mines polluées, centrales nucléaires) qu’à celui de software (comptabilités, business modèles, produits financiers). Comment scier la branche sur laquelle nous sommes assis, dès lors que cette branche est toxique et nous pourrit la vie ?
La réponse par la « décroissance » doit certainement être prise en compte, mais elle ne saurait ni s’appliquer uniformément en tous points de la planète ni donner le dernier mot de cette écologie du démantèlement. Les facilités et les séductions qu’exerce un certain confort de vie oxydental envers celleux qui en bénéficient comme envers celleux qui en rêvent de loin exigent d’implémenter une transformation radicale (plutôt qu’une simple abolition) de nos infrastructures industrielles. Comment procéder à cette transformation sans succomber ni aux diktats d’expertises surplombantes détachées des terrains sociaux, ni aux vœux pieux d’une sobriété volontairement choisie par une humanité enfin écologiquement « conscientisée » ?
Le démantèlement pourrait bien devoir prendre la forme d’infrastructures de soustraction – qui constituent en ceci l’un des défis majeurs de nos planétarités. Les renoncements individuels, les petits gestes domestiques, les choix de frugalité sont certes bienvenus et nécessaires, mais terriblement insuffisants. Nous avons besoin d’un certain type d’infrastructures pour peu à peu démanteler ces infrastructures qui nourrissent nos systèmes d’approvisionnement globalisés tout en pourrissant nos milieux de vie planétarisés. Gare aux routes trop belles pour ne pas être des leurres d’un capitalisme en quête de bonne conscience : ces nouveaux dispositifs doivent être fermement orientés vers la soustraction des communs négatifs plutôt que vers la production de nouveaux gadgets plus ou moins consuméristes.
Les chemins à creuser sont nombreux. Il y a les circuits courts, évidemment, qui aident à démanteler certaines chaînes d’approvisionnement absurdement étendues et qui requièrent la mise en place de vraies infrastructures (locales). Sont également envisageables dès aujourd’hui des plans de capture et séquestration du carbone à grande échelle, ainsi que des dispositifs organisationnels qui ancrent la sobriété au cœur de nos infrastructures vitales et donc de nos obligations institutionnelles au lieu d’en faire uniquement l’objet d’une préférence personnelle[25]. Mais l’enjeu est aussi d’inventer des trucs et des bricolages (autant que des méthodes ou systèmes) pouvant contribuer à neutraliser nos dépenses et consommations excessives avant qu’elles n’aient lieu.
De ce point de vue, l’instauration d’un revenu universel mériterait d’apparaître au premier plan de ces infrastructures de soustraction : là où le salariat contraint les individus à remplir des emplois nuisibles (publicité, télémarketing, R&D de gadgets à pure finalité consumériste), la garantie d’un revenu de base devrait permettre de choisir des formes d’activités (aujourd’hui peu ou pas rémunérées) qui vont dans le sens du soin de nos milieux de vie, sociaux et écologiques.
Il y a sûrement de foules considérables de maquettistes, designers, cinéastes, écrivain·es qui trouvent du plaisir dans le travail créatif qu’illes réalisent pour des instituts publicitaires, mais à quel coût humain, éthique voire écologique ? L’instauration d’un revenu universel leur donnerait de quoi subvenir à leurs besoins les plus basiques sans besoin de « se vendre », leur permettant ainsi de se livrer librement à la partie leurs activités créatives qui ne demandent pas d’investissement trop considérable.
Certain·es s’en satisferaient peut-être – troquant une baisse de revenu pour un gain de liberté. Ce serait déjà tout cela de soustrait à l’industrie publicitaire – sans violence ni douleur insurmontable. La même dynamique peut être anticipée du côté d’une partie de la main d’œuvre des abattoirs, par exemple, comme plus généralement de la part (apparemment énorme) de celles et ceux qui se trouvent rivé·es par pur besoin alimentaire à ce que David Graeber a appelé les « jobs à la con » (bullshit jobs[26]). Le chantier des infrastructures de soustraction est à peine ouvert : les exigences de nos planétarités rendent urgente sa réelle sortie de terre.
Planétarités = Pluralismes
Le choix fait ici de parler de planétarités au pluriel peut surprendre. N’avons-nous pas qu’une seule planète, la Terre, que nous devons justement apprendre à partager dans son unicité ? Le choix du pluriel témoigne de la nécessité de concevoir notre Terre comme devant impérativement accueillir la coexistence de plusieurs mondes, de plusieurs cultures, parfois mutuellement contradictoires mais en rapports d’enrichissement réciproque. Édouard Glissant invitait à conjuguer « les humanités » au pluriel, soulignant que seule la diversité des cultures humaines nous rend véritablement humains[27]. À l’heure où les dispositifs mis en place par le capitalisme de plateformes menacent de nous segmenter dans un ségrégationnisme algorithmique[28], c’est précisément parce qu’il n’y a pas de planète B à disposition que nous devrons apprendre à conjuguer au pluriel nos planétarités.
Les décentrements constitutifs des optiques planétaires nous poussent à adopter non seulement un regard extérieur sur notre condition terrestre, mais une multiplicité de vues venant d’une multiplicité de Dehors. Des vues non-oxydentales, des vues autres-qu’humaines aussi, mais pas seulement. Des vues qui déstabilisent les binarismes simplistes opposant le « naturel » (forcément salvateur) à l’« artificiel » (forcément pollueur). Les animaux et les plantes « artificialisent » et « terraforment » notre planète aussi bien (et parfois presque aussi mal) que les humains. Apprendre à considérer la Terre depuis une multiplicité d’extériorités planétaires décentre la notion même d’habitabilité suivant le type d’entité à partir de laquelle on oriente sa perspective.
Les planétarités ont ainsi parties liées avec des imaginaires extra-terrestres. Le paradoxe n’est qu’apparent, et se situe bien loin du tourisme indécent des milliardaires orbitaux. La nécessité d’agir ici et maintenant de façon urgente sur la seule planète pour nous habitable en l’état de nos technologies et de nos connaissances, c’est-à-dire la nôtre, nous invite à regarder au-delà de nos horizons coutumiers… Jusqu’à explorer les autres planètes par quelque grâce télescopique, même et surtout sans y aller nous-mêmes, afin de mieux saisir la singularité de la Terre, de son histoire et de ses possibles.
Ces « terrestres » que Bruno Latour aimerait que nous devenions contre les « modernes » d’hier ont besoin des perspectives de migrants ultimes : les « extra-terrestres ». Car nous sommes appelé·es à devenir nous-mêmes des êtres (re)venus d’ailleurs afin de reconsidérer les humains et les non-humains, les choses et les multiples vivants des environnements que nous traitions auparavant comme des objets ou des ressources à exploiter. Mais ce devenir extra-terrestre n’est-il pas tout aussi indispensable pour extraire nos terraformations à venir de leur gangue extractiviste[29] ?
Ce texte est adapté de l’introduction d’un numéro spécial (n° 85) consacré par la revue Multitudes aux questions de planétarités, qui paraîtra courant janvier 2022 et sera disponible en librairie.
