Le juge et le citoyen
La majorité des Français trouve la justice laxiste. C’est du moins ce que mesurent les sondages récurrents publiés sur la question. En mars 2013 on pouvait par exemple lire dans le Figaro que « 76 % des sondés estiment que les peines devraient être plus sévères » et que « 66 % souhaitent que la justice des mineurs soit plus ferme »[1].
Ces résultats faisaient écho à ceux publiés quelques mois plus tôt – par exemple dans le sondage publié par le même journal en 2011 – et préfiguraient ceux qui le serait quelques mois plus tard – par exemple dans les chiffres donnés en août 2013.
La relative stabilité des enquêtes sur la punitivité amène deux questions. La première porte sur l’origine du sentiment de laxisme exprimé par la population. Pourquoi les Français considèrent-ils les sanctions comme n’étant pas assez sévères ? Quels sont les déterminants, et éventuellement les biais conduisant à cette perception ?
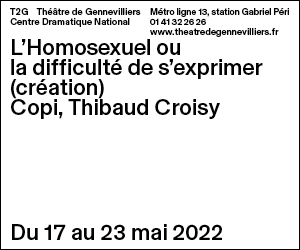
La seconde question porte sur l’éventuel écart que ces sondages révèlent entre l’échelle de gravité des magistrats et celle des citoyens au nom desquels ils sont censés rendre justice. Elle pose la question de la prise en compte des préférences de la population dans les jugements ou, pour le dire autrement, la question de savoir si des juges tirés au sort prendraient des décisions différentes de celles des professionnels.
Aveu d’ignorance et références trompeuses
Commençons donc par nous pencher sur l’origine du sentiment de laxisme. En théorie, pour émettre ce type de critique, et plus généralement pour avoir une opinion, il faut deux choses : avoir un avis sur ce que devrait être les sanctions et savoir ce qu’elles sont. En réalité, il est probable que ces deux éléments fassent défaut parmi l’écrasante majorité des personnes interrogées. Tout d’abord la connaissance du niveau réel des peines semble relativement faible.
Une enquête[2] menée en 2009 par le ministère de la Justice révélait ainsi que près de la moitié des personnes sondées avouaient ne pas connaître le nombre de personnes incarcérées en France. À ceux-ci s’ajoutaient 30% de personnes proposant des chiffres au moins une fois et demi supérieurs à la réalité et 10 % donnant des estimations au moins deux fois inférieures. Au final, seuls 16 % des Français interrogés répondait qu’il y avait entre 50 000 et 100 000 personnes détenues en France, ce qui était effectivement le cas.
Par ailleurs, il est peu probable que la plupart d’entre nous aient un avis très clair sur ce que devraient être les peines pour tel ou tel délit. Si la hiérarchie de gravité est sans doute assez commune – un vol avec violence est plus grave qu’un vol simple, un cambriolage qu’un défaut d’assurance etc – le niveau de chaque sanction semble beaucoup plus difficile à penser. Un recel de vol relativement simple mérite-t-il en moyenne 2 mois, 6 mois, 2 ans ? de prison ferme, de sursis ?
En pratique, la perception de la justice est probablement largement nourrie par l’information que nous obtenons sur quelques cas – médiatisés ou survenus dans notre entourage – et la comparaison des peines prononcées avec le référentiel que constitue le code pénal. On comprend alors l’origine du sentiment de laxisme.
Pour prendre quelques exemples : 90 % des détentions de stupéfiant sont punies de moins de 2 ans alors que la peine maximale est de 10 ans, 90 % des dégradations ou des vols en réunion sont punis de moins d’un an pour un maximum de 5 ans dans le code… Ce ne sont pas des cas isolés : en moyenne, les peines pour délits représentent, en France, environ 8 % des peines maximales possibles (4 % du maximum pour la seule part de prison ferme). Confronté à un tel hiatus, il n’est pas réellement surprenant que la justice soit alors perçue comme laxiste.
Pourtant, si l’écart entre peines prononcées et maximums théoriques peut être vu comme la preuve du trop faible niveau des sanctions, il peut aussi se lire comme le signe d’un excès des textes. La façon la plus simple de s’en convaincre est de faire l’exercice de pensée de les prendre au pied de la lettre. Que se passerait -il si les peines fermes étaient en moyenne égales à, par exemple, la moitié des maximums autorisés par le code ? Le taux d’incarcération serait alors multiplié par près de dix, la France deviendrait, de loin, le pays ayant le plus haut taux d’incarcération du monde[3], et le budget de l’administration pénitentiaire exploserait pour devenir supérieur à celui des armées.
Il s’agirait alors d’une modification complète de la façon dont notre société fonctionne, tant en termes de priorité d’action publique – il faudrait bien trouver l’argent quelque part – qu’en termes d’organisation sociale – un grand nombre de familles serait affectées par l’incarcération d’un proche, il faudrait réinsérer dans la société et dans le monde du travail un nombre considérable d’ancien détenus ayant effectué des longues peines, etc.
Un sentiment entretenu
Si le sentiment de laxisme a probablement pour origine la référence à des peines maximales extrêmement élevées, celui-ci fluctue au gré de l’actualité et se renforce lorsque le climat se fait plus anxiogène sur la sécurité. Comme le rappelait le sondeur Jean Daniel Levy (Harris Interactive) à l’occasion de la conférence de consensus sur la récidive[4], la plupart des enquêtes sur la perception de la justice par les Français ont été commandées à la suite de faits divers. Ce contexte joue évidemment sur les réponses obtenues.
Afin de mesurer le lien entre climat médiatique et réponses aux enquêtes, Aurélie Ouss (université de Pennsylvanie) et moi avons croisé le contenu des journaux télévisés de TF1 et France 2 de 2004 à 2010 avec les réponses à l’enquête « cadre de vie et sécurité » (l’INSEE[5]) portant sur la victimation – le nombre de délits dont les personnes ont été victimes – et le sentiment d’insécurité – les craintes pour soi ou pour les proches. Dans ces enquêtes, on observe que les sondés sont plus nombreux à dire avoir peur le lendemain de la diffusion de reportages sur des faits divers criminels.
De manière symétrique, d’autres chercheurs ont pu mesurer l’effet de la diminution du nombre de reportages sur la délinquance et la criminalité en Italie[6]. Dans ce pays, entre 2008 et 2012, les 7 chaînes de télévisions traditionnelles, couvrant massivement les faits divers, se sont vues concurrencées par l’arrivée d’un grand nombre d’autres médias à l’occasion du passage du signal analogique au signal digital. Cette transition s’est faite à des moments différents dans les régions italiennes et s’est accompagnée d’une chute de la part d’audience des principales chaînes de 85 % à 60 %.
Cette diminution du nombre de personnes exposées à un grand nombre de reportages sur les faits divers s’est accompagnée d’une diminution du sentiment d’insécurité. Les chercheurs ont ainsi pu observer, dans les différentes régions, une moins grande inquiétude rapportée dans les enquêtes précisément au moment où le signal passait d’analogique à digital dans l’endroit où vivaient les sondés.
Ces résultats portent sur le sentiment d’insécurité et non sur la perception de la justice. Cependant, dans notre étude sur l’effet des faits divers sur les réponses des enquêtés nous avons également mesuré l’effet des médias sur les verdicts rendus par les cours d’assises françaises ou siègent des jurés. Les résultats obtenus sont cohérents avec les précédents : le lendemain de la médiatisation de faits divers criminels les peines prononcées s’avèrent plus sévère que les autres jours. De manière intéressante on observe également que les sanctions sont moins sévères, le lendemain de reportages sur les erreurs judiciaires.
La médiatisation des faits divers délictueux ou criminels semble donc augmenter le sentiment d’insécurité et la demande de sévérité. Ce mécanisme a vraisemblablement été un peu moins à l’œuvre au cours des dernières années à mesure que la crise sanitaire occupait le devant de l’actualité. Cependant, avant cela, la tendance était plutôt à une augmentation de la place des faits divers dans les médias, notamment aux journaux télévisés où elle était passée de 3,6 % du volume d’information en 2003 à 6,1 % en 2012[7].
Soyez le juge
Biaisés par des peines maximales exagérément élevées et entretenus par la médiatisation massive des faits divers, les sondages sur la justice indiquent néanmoins un mécontentement vis-à-vis des décisions prises par les magistrats qui pose problème. En effet, dans la mesure où les décisions de justice sont théoriquement rendues « au nom du peuple français », ces enquêtes soulèvent la question de savoir si les verdicts des magistrats reflètent les préoccupations de la population ou seulement celles du groupe professionnel auxquels ils appartiennent.
Il est important ici de rappeler que les résultats des sondages n’indiquent pas nécessairement que les peines prononcées par des jurés seraient différentes de celles décidées par des professionnels. Dans une situation réelle, des citoyens tirés au sort auraient une connaissance plus précise de la réalité de la justice – qui leur fait largement défaut comme on l’a vu – et toute la symbolique du procès – robes, statues allégoriques, rituels, etc. – viendrait leur rappeler l’importance de la décision. Dans ces conditions, on peut aisément imaginer que les personnes enclines à souhaiter une justice inflexible verraient leur main trembler à l’heure d’envoyer réellement quelqu’un passer un an derrière les barreaux.
Une première approche visant à mesurer les différences entre les magistrats et le reste de la population consiste à dépasser la simple question générale pour présenter des cas précis. Une étude de grande ampleur a par exemple été menée au Royaume Uni[8]. 74 000 internautes ont répondu à quelques questions sur la justice avant de se voir présenter un cas réel, illustré par des vidéos et des documents d’archives, puis de devoir proposer une sanction.
Si 41 % des participants trouvaient la justice britannique trop peu sévère au départ 84 % d’entre eux proposaient une peine inférieure ou égale à celle qui avait été prononcée en réalité et seuls 13 % considéraient encore les tribunaux comme laxistes à la fin. Cette expérience indique qu’une simple mise en contexte un peu plus poussée et une amélioration de la connaissance peut considérablement diminuer les critiques à l’encontre du niveau des peines.
Cependant ces résultats ont été obtenus dans des circonstances « fictives » et on ignore toujours si les peines réelles sont différentes. Une réforme votée en 2011 permet d’y voir un peu plus claire. À partir du 1er janvier 2012 et jusqu’à mai 2013, dans quelques tribunaux français (ceux du ressort des cours d’appel de Dijon et de Toulouse), deux citoyens tirés au sort sont venus s’associer avec des magistrats professionnels dans le jugement de certains délits. Ce contexte est très proche d’une expérience classique (on parle d’expérience « naturelle » car les chercheurs n’y sont pour rien).
On a bien un groupe contrôle : les juridictions où il ne s’est rien passé ; et un groupe traitement : celles qui ont été affectées par la réforme ; que l’on peut observer avant, pendant et après la réforme. Si la demande de sévérité mesurée par sondage reflète réellement une perception différente de la gravité des délits on devrait observer une augmentation des peines lorsque des non-professionnels participent à la décision, c’est-à-dire dans les régions de Toulouse et Dijon en 2012 et début 2013.
En réalité, l’étude de ce dispositif révèle que l’ajout de deux « citoyens assesseurs » dans un ensemble de tribunaux correctionnels n’a eu absolument aucun effet. Les peines prononcées dans ces juridictions sont restées parfaitement identiques à ce qu’elles étaient avant et après l’expérimentation et leur évolution a été exactement identique à celle observée dans les tribunaux ou rien n’a changé au cours de la période.
Bien sûr il est possible que les jurés aient été très fortement influencés par les professionnels. Mais dans ce cas il est peu probable qu’ils aient eu des avis extrêmement affirmés et différents de ceux des magistrats. Il est également possible que les citoyens assesseurs (au nombre de 2) aient été mis en minorité par les professionnels (au nombre de 3). Mais cela suppose que les 3 magistrats ont toujours été parfaitement d’accord entre eux.
En l’absence de consensus, des jurés plus sévères auraient fait pencher la balance vers des peines plus lourdes. Face à ces deux hypothèses peu crédibles, une autre, plus simple, semble s’imposer : les jurés n’avaient pas des opinions fondamentalement différentes de celles des professionnels.
En définitive, si les sondages révèlent une forte demande de sévérité de la part des Français cela semble avant tout révéler un manque de connaissances sur la justice et un biais dans les perceptions plutôt qu’un réel divorce entre le peuple et ses juges. Paradoxalement, une réponse efficace à cette préoccupation serait sans doute de diminuer les peines maximales autorisées par le code pénal dont les niveaux excessifs nourrissent incompréhension et ressentiment.
