Contre « le pouvoir d’achat »
« Les mots peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelque temps l’effet toxique se fait sentir. »
Victor Klemperer, LTI. La langue du IIIe Reich, 1947
Au cours de la dernière élection présidentielle, les instituts de sondage, les journalistes, les politiques et les syndicats semblent s’être accordés sur un point crucial : le pouvoir d’achat serait la préoccupation majeure des Français. De manière pour le moins surprenante, les disputes statistiques et les discussions expertes sur l’inflation, la TVA, l’évolution des prix et le seuil de pauvreté ont laissé de côté les conséquences délétères de cette mise en agenda.
À un moment où le dérèglement climatique nous imposerait un nouveau rapport au monde, fait de sobriété énergétique, de décroissance matérielle et de réconciliation avec le vivant, « l’augmentation du pouvoir d’achat » est un sinistre anachronisme. En effet, la notion de pouvoir d’achat réduit l’action à la consommation et le pouvoir d’« agir à plusieurs » qui anime en principe la vie démocratique à un pouvoir individuel.
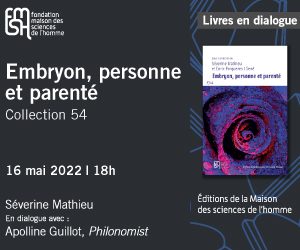
Cette double réduction, de l’action à l’achat, du citoyen au consommateur, individualise et dépolitise les souffrances et les revendications qui auraient pu prendre une tout autre voie, bien plus collective et émancipatrice : celle de la justice sociale.
La mise en berne du pouvoir
On le sait bien, le langage, même lorsqu’il est prétendument utilisé pour décrire de façon transparente un état de choses ou pour échanger des informations, est toujours une façon de faire les choses. En délimitant l’éventail de ce qui est possible ou impossible, dicible ou indicible, sensé ou insensé, il assigne des places et affecte le cours des événements. Les « éléments de langage » préfigurent les émotions qu’ils sont susceptibles de déclencher, proposent des programmes d’action et dessinent les contours des collectifs qu’ils affectent et concernent.
Le moins que l’on puisse dire est que le programme d’action associé au pouvoir d’achat a le mérite de la clarté : c’est celui d’acheter plus. Ainsi quantifiée, la notion même de « pouvoir » est ici à prendre au sens faible, très faible même – un sens qui détonne avec celui, politique, du pouvoir démocratique. Lorsqu’il ne se confond pas avec la domination, le pouvoir n’est pas une chose que l’on détient ou que l’on perd mais une relation qui implique des conflits, des contestations, des luttes, des résistances et des émancipations potentielles.
Dans un espace public démocratique, le pouvoir est tout à la fois une autorisation, une capacité et une possibilité d’agir à plusieurs dans un monde commun qui, loin d’être d’ores et déjà défini, est l’objet d’une enquête collective. De l’ordre de l’agir en commun, le pouvoir doit nécessairement composer avec les autres verbes de modalité que sont le savoir, le vouloir et le devoir. Pour pouvoir agir au sens fort, encore faut-il le vouloir de manière suffisamment intense, respecter les devoirs qui nous obligent et savoir quels sont les moyens susceptibles de mener l’action à bien.
Or, c’est bien la consistance proprement politique du pouvoir que résorbe le mantra économiciste du pouvoir d’achat. Le pouvoir d’achat est a-relationnel : il ne renvoie pas, tout au moins a priori, à une relation à autrui mais à une propriété, une possession, un capital, bref un « avoir » dont la valeur est régie par une logique de marché. Délaissant le pouvoir d’agir avec autrui, il se débarrasse des dimensions contraignantes et objectives du savoir et du devoir pour mieux hypertrophier le vouloir dont il serait l’expression la plus pure.
En assimilant les moyens et les fins, le pouvoir d’achat promeut l’agir instrumental d’un homo oeconomicus dont l’affect essentiel est celui de l’intérêt matériel. Pris dans l’imaginaire très peu imaginatif de l’actuel et de l’actualisé, le pouvoir d’achat réalise la prouesse d’être à la fois le moyen et la finalité, le problème et la solution.
Cet « écrasement instrumental » ne laisse aucune place à l’imagination, à la concertation sur les finalités et bien entendu à la constitution d’un public citoyen. Au prisme du pouvoir d’achat, moyens et fins, problèmes et solutions forment une totalité indistincte qui ne laisse aucune brèche à l’action, aucune prise à la faculté de penser, aucun espace pour la critique.
L’expérience de l’attente
La notion de pouvoir d’achat se distingue ainsi d’autres concepts sociopolitiques (par exemple : liberté, égalité, fraternité, solidarité, justice, démocratie) par la manière dont elle articule l’actuel et le possible, l’expérience et l’attente. En principe, l’attente, dans la mesure où elle permet l’anticipation de différents possibles, ne se réduit pas à l’expérience ; au contraire, elle se libère de l’expérience passée ou présente pour imaginer un avenir autre, pour entretenir des représentations détachées de l’environnement immédiat, pour nouer des liens de coopération autour d’objectifs futurs encore indéterminés.
Le pouvoir d’achat, lui, est enfermé dans la trame d’une expérience qui détermine de part en part l’horizon d’attente qui lui est lié : c’est un pouvoir de détention et de réitération, un pouvoir rétréci, sans possible autre que celui d’être désespérément identique à lui-même.
Quelle est la forme sociale, le type de collectif que fait miroiter le pouvoir d’achat ? La forme qu’il préfigure est celle de la file d’attente. Dans la mesure où elle organise l’accès à des ressources limitées, la file d’attente instaure par définition des rapports de compétition entre les individus qui la composent. Si l’on suit Arlie Hochschild dans Strangers in their own land (2016), c’est cette forme sociale qui explique que les « petits blancs » aient soutenu l’accession au pouvoir de D.Trump[1].
Attendant patiemment depuis des décennies, sinon des générations, dans la file d’attente qui est censée les conduire au rêve américain, ils craignent par-dessus tout que des nouveaux venus, notamment les femmes, les Noirs et les migrants, prennent la place à laquelle ils pensent avoir droit. Hantée par la peur des tricheurs, des « coupe-fils », des assistés et des profiteurs qui ne jouent pas le jeu, leur « histoire profonde », dit Hochschild, se vit sous le mode de la concurrence économique mais aussi de l’ardeur au travail et de la bienséance morale.
« Vous faites la queue patiemment, dans une file d’attente qui monte à l’assaut d’une colline (…) Derrière la crête de la colline se trouve le Rêve américain : c’est pour lui que tout le monde fait la queue. La file n’avance pas. Soudain vous remarquez que d’autres – “les Noirs, les femmes, les immigrés, les réfugiés” – trichent et vous passent devant » (Hochschild, 2016, p.136).
De nature métaphorique ou symbolique, la file d’attente du rêve américain ou du pouvoir d’achat qui lui est corrélatif permet peu, contrairement aux files d’attentes physiques qui s’éternisent, la création éphémère de liens d’entraide et de solidarité. Son ordre est essentiellement sériel : elle est composée d’individus alignés les uns à la suite des autres, qui attendent leur tour dans un ordre prédéfini qu’ils reconduisent avec docilité tout en étant pris par la peur de « se faire doubler ».
Comme le souligne Étienne Ollion (2021) à propos des élus parlementaires, les files d’attente « socialisent » les individus : elles leur apprennent le sens des limites et la succession des étapes à franchir pour arriver à leurs fins dans un climat de compétition potentiellement agressif[2].
C’est une forme sociale de disciplinarisation, de mise en conformité de celles et ceux qui sont obligés d’attendre patiemment leur tour – quitte, face au temps qui passe, à réviser leurs espérances à la baisse. Mais, dit Ollion, les files d’attente procèdent également à l’« individualisation » des « clients » ou des « patients » qui les composent, l’accès sélectif à des ressources rares déclenchant des guerres d’influence, des tentatives de passe-droit, et des relents d’hostilité à l’égard des contrevenants potentiels.
Surtout, pourrait-on rajouter, la forme sociale élémentaire que constitue la file d’attente est tout sauf politique. Au contraire, en faisant primer l’intérêt individuel sur la solidarité collective, elles dépolitisent les solitudes anonymes et silencieuses qui la composent. Conformément à sa conceptualisation sartrienne, la file d’attente se prête rarement à une réappropriation en nous : la série ou l’agrégat produit des « non-sujets », bloqués au seuil de la mise en commun et de la concertation collective qui leur permettraient d’entrer dans un processus de subjectivation politique.
Le programme d’action du pouvoir d’achat est donc celui, tautologique, de l’achat. En définissant « le même par le même », dit Barthes (1957), la tautologie est « aphasique » : elle « fonde un monde mort, un monde immobile »[3]. Quant à la forme sociale élémentaire qui sous-tend le pouvoir d’achat, en l’occurrence la file d’attente, c’est celle de la ligne, de l’alignement, un alignement tout à fois moral et affectif aux valeurs et aux biens en jeu.
Mais quelles sont les tonalités émotionnelles qui pourraient lui être associées ? Lorsque les ressources se font rares, lorsque l’attente se fait longue, c’est sans doute le ressentiment à l’égard des tricheurs et l’envie par rapport à celles et ceux qui sont parvenus à leurs fins qui prédominent. Ce sont en tout cas ces tonalités émotionnelles qui ressortent dans la célèbre affirmation d’Emmanuel Macron, énoncée en octobre 2017 : « Il y a des hommes et des femmes qui réussissent parce qu’ils ont des talents, je veux qu’on les célèbre […] il ne faut pas être jaloux d’eux. Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c’est toute la cordée qui dégringole […]. Je n’aime pas la jalousie qui consiste à dire ceux qui réussissent, on va les taxer, on va les massacrer »[4].
Dans l’axiologie gouvernementale des « premiers de cordée », la métaphore de la ligne et de l’alignement propre à la file d’attente s’enrichit de la valeur supposée indiscutable du mérite. Alors que les attentistes et autres « patients » espèrent voir augmenter leur pouvoir d’achat, les méritants sont récompensés de leur volonté, de leurs talents et de leur esprit d’entreprise. L’alliage de la file d’attente et de la cordée réinscrit la série des perdants, des « encordés » dans l’ordre fondamentalement juste du mérite.
Un tel alliage légitime sa contrepartie affective, le mépris à l’égard des « premiers de corvée », un mépris qui, à force d’humiliation, les fait rentrer dans le rang et garder la ligne. Comme le rappelle la métaphore cynique de la cordée, la survie requiert une forme de déférence aveugle aux chefs de file. En attendant le ruissellement providentiel des bienfaits venus d’en-haut, il faut à tout prix remonter la pente et éviter de décrocher.
Un opérateur de dépolitisation
En traduisant mais aussi en trahissant la souffrance sociale dont elle est censée être l’expression, la revendication du pouvoir d’achat scelle la victoire d’une vision économiciste du monde. Pourtant, il n’est pas inutile de rappeler que les mouvements populaires, y compris les émeutes de la faim qui ont précédé la Révolution française, ne se sont pas construits autour du pouvoir d’achat mais du droit à la subsistance[5]. De tels mouvements tentaient de soustraire les biens de première nécessité à la spéculation économique et de rappeler au monarque l’obligation, propre au pacte social fondamental qui le reliait à son peuple, d’assurer à tout un chacun une vie digne.
À la croisée du devoir et du droit, l’économie morale de la subsistance est bien loin du pouvoir d’achat dont la connotation amorale tend même à devenir, dans un environnement exsangue qui ne peut plus endurer l’expropriation et la prédation, proprement immoral. En véhiculant une vision atomisée du monde social, le pouvoir d’achat étouffe l’expression, bien plus menaçante pour l’ordre établi, d’un droit à la subsistance, éminemment moral et politique. Il obscurcit les affects et les expériences en les agrafant à des redescriptions qui les « déforcent » et les éloignent d’une réflexion en termes d’écologie politique, de forme de vie et de revenu universel.
On l’aura compris, le pouvoir d’achat relève d’une idéologie du statu quo. C’est un pouvoir de réaction à des stimuli immédiats, à des biens désirés ou désirables qui meublent un monde préfabriqué. Tout comme, pour Adorno et Horkheimer[6], se divertir revient à donner son assentiment – « s’amuser, c’est dire oui », disent-ils – rêver d’augmenter son pouvoir d’achat revient à « être d’accord » et à « acclamer l’ordre existant ». Cet accord tacite, ce plébiscite larvé fait du pouvoir d’achat un opérateur de dépolitisation massive.
L’horizon de la justice sociale
Au sens normatif du terme, la seule vraie politique est celle de l’imagination : elle rouvre l’éventail des possibles et exige de tout un chacun qu’il se décentre pour réfléchir en termes d’intérêt général et endosser le point de vue de la collectivité. C’est exactement cette ressaisie imaginative, cette ouverture prospective que permet le concept de justice sociale. Il pose la question de la redistribution des biens et de la cohabitation dans un monde commun.
Il s’oppose à l’inéquité structurelle et à la surexploitation des « ressources » humaines et naturelles qui sont au cœur du néolibéralisme et du capitalisme financier qui lui est corrélatif. Il rappelle que, dans une société démocratique qui est par définition une société de semblables, la différence des conditions doit être une différence de degré et non pas une différence de nature. Enfin, la justice sociale trouve son extension naturelle dans la justice climatique, qui lutte contre les inégalités socioéconomiques, territoriales, sanitaires, raciales et générationnelles que renforce le dérèglement climatique.
À l’opposé du réalisme ou du fatalisme, l’idéal de justice sociale permet d’imaginer le monde autre qu’il n’est, de le représenter comme il devrait être. Et surtout il s’adresse non seulement aux membres actuels de la communauté mais à l’ensemble des personnes susceptibles d’être affectées par les conséquences directes ou indirectes des actions et des décisions du présent.
La dynamique émotionnelle qui sous-tend la justice sociale et climatique est aux antipodes des affectés sclérosés et du préférable immédiat qui sous-tendent le pouvoir d’achat. Sa dynamique est celle de l’indignation et de l’espoir – des affects qui semblent avoir quasiment disparu de la politique.
Il y a une dizaine d’années, pourtant, l’indignation était devenue un signe de ralliement et un mot d’ordre, notamment au moment des mouvements des Indignés. Actuellement, elle est étrangement absente du lexique médiatique et politique, obnubilé, depuis les Gilets Jaunes, par la colère, les ressentiments, les « passions tristes », la fatigue ou l’anxiété qui coloniseraient les affects contemporains. Et pourtant c’est bien l’indignation qui est susceptible de constituer un collectif autour des enjeux de justice sociale et climatique.
Contrairement au ressentiment, qui renvoie à une réaction personnelle et égocentrée au mépris ou à l’indifférence d’autrui, l’indignation est une colère généreuse : elle répond à l’évaluation désintéressée de l’offense et de l’injustice. Le sujet qui s’indigne se réclame en arrière-fond d’une communauté de valeurs potentiellement universelle qui est susceptible de soutenir son émotion et d’étayer ses revendications. Alors que le ressentiment se ressasse et se tait, que la peur « prend aux tripes » et prédispose à obéir, et que le dégoût laisse écœuré et sans voix, l’indignation est au contraire aisément partageable, sinon inflammable.
Elle est également sans limites puisqu’elle est à même de faire comparaître n’importe qui, y compris les personnes de haut rang, devant le tribunal des valeurs qu’elle a pour mission de soutenir. Dans ce sens, l’indignation est une alliée naturelle de l’espoir. Comme le disait Walter Benjamin, l’espoir émerge du lien paradoxal entre les opprimés et les rêveurs[7]. C’est cet espoir mâtiné d’indignation qui peut nourrir l’aspiration à la justice sociale et climatique et inspirer les mobilisations collectives.
Une « OPA » sémantique et politique
Le pouvoir d’achat est une OPA sémantique et politique qui désamorce le potentiel disruptif et subversif des sentiments diffus d’injustice et de découragement que suscite un monde devenu de plus en plus inhospitalier. En phase avec les dispositifs de sérialisation et de désagrégation que constituent le sondage et l’isoloir, il promeut une vision sérielle et atomisée d’un univers social dont l’individu, réduit à son intérêt immédiat, est le centre de gravité affectif et narratif.
En annihilant la dimension prospective, imaginative et relationnelle de la justice sociale et climatique, le pouvoir d’achat passe du collectif à l’individuel, du relationnel à l’attribut, du citoyen au consommateur. A cet égard, il n’est guère surprenant que les revendications du pouvoir d’achat se marient fort bien avec les préoccupations identitaires : les unes et les autres font appel à des egos, individuels et collectifs, qui savent qui ils sont et ce qu’ils veulent. Les rhétoriques d’extrême-droite, comme d’ailleurs les positions supposées centristes du gouvernement actuel, l’ont fort bien compris.
Il est relativement aisé de dévier l’attention des défavorisés, de les détourner des causes structurelles de leur misère, en l’occurrence les rapports de production et les connivences politiques, pour les orienter vers des « cibles » bien plus préhensibles : les étrangers, migrants, délinquants ou « assistés » qui les priveraient de leur pouvoir d’achat. Ainsi pris en tenaille entre les avoirs individuels que promet le pouvoir d’achat et l’être collectif, fidèle à lui-même, que fait miroiter l’obsession identitaire, l’espace public citoyen s’étiole et se rétrécit jusqu’à l’asphyxie.
Version appauvrie et politicienne de la souffrance sociale, le pouvoir d’achat réduit les affects, qui pourraient s’épanouir dans un horizon de justice sociale et climatique en un programme d’action figé. Votre pouvoir ? C’est celui d’acheter, un peu, beaucoup, énormément ou… pas du tout. Ce pouvoir a une portée disjonctive et désagrégative : il contribue avec diligence à la destruction méthodique des collectifs qui caractérise le néolibéralisme.
Comme le disait Hannah Arendt, seuls les êtres isolés peuvent être dominés. C’est cet isolement mortifère que doit combattre, au nom de la justice et de l’intérêt général, la mise en œuvre, plurielle et pluraliste, d’une véritable écologie politique.
