Quand la Cour suprême menace de nombreuses libertés
La récente décision de la Cour suprême, Dobbs v. Jackson, annule Roe v. Wade (1973), l’affaire qui avait fait du droit à l’avortement un droit fédéral aux États-Unis. Il n’y a toujours pas d’interdiction fédérale de l’avortement, mais la décision du droit à l’avortement incombe désormais à chaque État. Si une interdiction fédérale doit être adoptée, ce serait via le Congrès américain et, à l’heure actuelle, il ne semble pas y avoir de majorité dans les deux chambres pour franchir cette étape.
Au moment où nous écrivons ces lignes, on s’attend à ce qu’une douzaine d’États interdisent effectivement l’avortement dans les semaines à venir, et que les personnes de ces États qui cherchent à se faire avorter soient obligées de se rendre dans d’autres États (alors même que les voyages à cette fin seront très probablement interdits par certains de ces États, ce qui fait planer le spectre d’une nouvelle forme de contrôle des frontières).
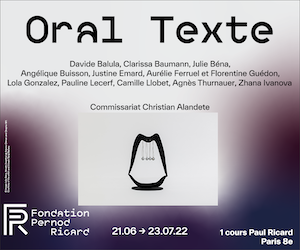
Les personnes aisées trouveront sans doute un moyen de recourir à la procédure, en faisant appel à des médecins privés dans le cadre d’accords confidentiels, ou en se rendant dans des États où l’avortement demeure légal. En particulier pour les pauvres, les avortements redeviendront des opérations clandestines, menées dans des environnements peu sûrs, avec des conséquences désastreuses pour les personnes contraintes d’emprunter cette voie.
La suppression du droit à l’avortement tel qu’il était garanti par le gouvernement fédéral non seulement restreint la liberté des femmes mais accentue l’inégalité entre les sexes, en renforçant le contrôle de l’État sur leur corps. Mais est-il possible que cela affecte d’autres groupes, y compris certains mouvements sociaux dont les victoires juridiques reposaient sur un raisonnement similaire et une jurisprudence commune ?
Le slogan qui circule actuellement sur les médias sociaux : « They are coming for you next ! », « Vous êtes les prochains sur la liste ! »
La décision de la Cour suprême révèle que la majorité, bien que d’accord sur l’annulation de Roe, est composée de points de vue divergents s’agissant des motivations du vote des différents juges. Ceux qui ont voté contre le droit à l’avortement ne sont manifestement pas entièrement d’accord entre eux sur tous les points, notamment sur les conséquences de la décision pour d’autres droits constitutionnels.
L’une des affirmations les plus controversées prononcées à l’occasion de cet arrêt a été émise par le juge Clarence Thomas, lequel a prévenu que l’annulation de Roe v. Wade n’était que le premier de tels arrêts, et que les décisions clés de la Cour suprême fondées sur la doctrine de la vie privée introduite par Griswold v. Connecticut (1965) seraient désormais vulnérables à l’abrogation – des décisions qui garantissent le mariage entre personnes de même sexe, le droit d’accès à la contraception et le fait de fournir des conseils médicaux à ce sujet, et la suppression des sanctions pénales pour ceux qui pratiquent ce que la loi appelle la « sodomie ».
Le slogan qui circule actuellement sur les médias sociaux, et qui a été récemment repris par le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, met en garde contre le plan de Thomas : « They are coming for you next ! », « Vous êtes les prochains sur la liste ! »
Sam Alito, le juge qui a rédigé le récent arrêt contre Roe, a insisté sur le fait que cette décision ne concerne que l’avortement, et aucun autre droit garanti par la Constitution. Aucun autre juge de la Cour suprême n’a fait écho à l’appel de Thomas à « reconsidérer » ces autres droits, mais peut-être ont-ils tout simplement préféré rester silencieux. C’est assez dans leurs habitudes, jusqu’au moment où ils décident de passer à l’action.
En effet, avant de l’annuler, de nombreux juges avaient affirmé leur soutien à Roe. Cavanaugh, lors de réunions avec des sénateurs avant sa nomination, avait affirmé que Roe était un précédent établi, la « loi du pays », et que des décisions judiciaires avisées ne devaient pas venir troubler ces eaux. De fait, la plupart des juges conservateurs, y compris Gorsuch qui a rejoint la majorité, condamnaient « l’activisme » passé de la Cour suprême : comprendre les actions excessives injustifiées des juges de gauche et progressistes et d’eux seuls. À maintes reprises, les conservateurs du pouvoir judiciaire ont affirmé que les juges devaient s’en tenir à la lettre de la loi, y compris à la force contraignante des précédents.
Ils ont rompu avec ce raisonnement en statuant contre le droit à l’avortement en vigueur depuis cinquante ans, marquant ainsi le fait qu’ils s’opposent à la majorité du peuple, et sont entrés dans la mêlée politique. Sous l’impulsion d’Amy Coney Barrett, nommée par Trump et dont les engagements religieux sont nets et clairs, la Cour a rendu une décision qui étend et intensifie « l’intérêt de l’État » pour le fœtus, outrepassant tout droit d’une personne enceinte à obtenir un avortement par choix ou pour des raisons d’intégrité corporelle (y compris le préjudice potentiel pour son bien-être). Il est clair que le pouvoir de l’État sur les femmes, leur sexualité et leur liberté, leur droit à la santé, est à présent devenu franchement effrayant et grotesque. Mais ce n’est pas le seul danger auquel nous sommes désormais confrontés.
Dans l’affaire Planned Parenthood v. Casey (1992), la précédente Cour suprême a clairement indiqué qu’elle pensait que Roe v. Wade avait été décidée sur des bases illégitimes. La majorité a écrit que « Roe a déterminé que la décision d’une femme d’interrompre sa grossesse est une “liberté” protégée contre l’ingérence de l’État par la Due Process Clause du quatorzième amendement. Ni le Bill of Rights ni les pratiques spécifiques des États au moment de l’adoption du quatorzième amendement ne marquent les limites extérieures de la sphère substantielle de cette “liberté”. Au contraire, l’adjudication des demandes de procédure régulière au fond peut exiger de cette Cour qu’elle exerce son jugement raisonné pour déterminer les limites entre la liberté de l’individu et les exigences de la société organisée. »
Alito se fait l’écho de ce point de vue lorsqu’il insiste sur le fait qu’il n’y a pas de droit à l’avortement dans la Constitution et qu’il n’y a pas de moyen légitime de déduire ce droit de son énoncé. Dans l’affaire Dobbs, la Cour suprême n’a pas annulé l’arrêt Griswold contre Connecticut, mais Thomas a indiqué de manière inquiétante que ce précédent constituait une prochaine cible possible. Il a déclaré que la Cour « devrait reconsidérer tous les précédents de cette Cour relevant de l’application régulière de la loi, y compris Griswold, Lawrence et Obergefell. »
Qu’est-ce que le principe de « due process » – le principe d’application régulière de la loi – a-t-il à voir avec cet arrêt contre le droit à l’avortement ? Ou avec les arrêts qui ont interdit la criminalisation de l’utilisation de la contraception ou de la dispense de conseils à ce sujet (Griswold), qui ont interdit d’interdire les actes de sodomie (Lawrence), ou qui ont affirmé le droit au mariage homosexuel (Obergefell). Les droits substantiels à une application régulière de la loi sont établis par les 5e et 14e amendements de la Constitution américaine et font référence aux libertés qui ne devraient pas être restreintes par une quelconque autorité au niveau local, c’est-à-dire les États.
Ces droits sont généralement considérés comme étant de nature privée ou personnelle, ou comme relevant de la liberté des individus. Bien que la sodomie, l’avortement et la contraception ne soient pas mentionnés dans la Constitution, ils sont considérés comme des activités protégées par les tribunaux qui ont appliqué ces principes à ces cas, précisément parce qu’ils sont personnels et privés et relèvent de la liberté individuelle. Le fait qu’Alito affirme ne pas trouver le terme « avortement » dans la Constitution, ou que Thomas prétende qu’aucun de ces droits ne s’y trouve, revient pour eux à refuser l’application de droits abstraits à des questions sociales concrètes que la Constitution n’a pas prévues et ne pouvait prévoir dans leurs formes actuelles. D’un côté, les conservateurs sont devenus des activistes. De l’autre, ils poursuivent leur programme au moyen d’un littéralisme ahurissant.
Si Thomas parvient à ses fins, un certain nombre de mouvements sociaux verront certains de leurs droits les plus durement acquis et les plus indispensables annulés au niveau fédéral.
Une des raisons pour lesquelles il ne faut pas considérer la menace exprimée dans l’opinion concordante de Clarence Thomas comme la parole isolée d’un marginal tient au fait que la Cour envoie depuis un certain temps des signaux contradictoires sur ses intentions. Les militants des mouvements de défense des droits de la reproduction sont conscients de cette menace depuis un moment déjà, et Thomas ne fait que reprendre le flambeau qui lui a été transmis par les évangéliques conservateurs. Dans l’affaire Planned Parenthood v. Casey (1992), la Cour affirmait le principe fondamental de l’arrêt Roe v. Wade selon lequel les femmes ont le droit d’exercer leur propre choix en matière d’avortement sans intervention de l’État et déclarait que les États ne pouvaient pas interdire les avortements durant la période qui précède la possible survie du fœtus hors de l’utérus, soit jusqu’à la 23e semaine de grossesse.
Dans ce même arrêt de 1992, la Cour a cependant jeté le doute sur le statut juridique de Roe. En effet, la Cour a alors déclaré qu’elle n’était pas prête à prendre une telle « décision impopulaire », même si elle remettait en question la conclusion clé de Roe selon laquelle l’avortement est justifié par le recours à la clause de Due Process. Les membres de la Cour n’ont pas reconnu la « liberté » des femmes – c’est Alito qui ajoute à présent ces guillemets alarmistes – de mettre fin à leur grossesse comme une liberté devant être protégée des pouvoirs de l’État, et ils ont affirmé l’intérêt légitime de l’État pour la vie du fœtus, mais tout en limitant, à cette époque, l’étendue de l’interférence de l’État. La Cour a refusé de donner suite à ses propres conclusions dans cette affaire d’il y a trente ans, mais leur commentaire a sans nul doute prophétisé ce que les conservateurs appellent maintenant la décision plus « courageuse », dans l’affaire Dobbs, d’abroger Roe.
Si Thomas parvient à ses fins, et s’il parle ouvertement d’un « agenda » conservateur que d’autres membres de la Cour n’ont pas encore revendiqué comme étant le leur, un certain nombre de mouvements sociaux verront certains de leurs droits les plus durement acquis et les plus indispensables annulés au niveau fédéral. Les droits à l’égalité, à la liberté et à la justice restent des droits abstraits tant qu’ils ne sont pas mis en œuvre dans des circonstances historiques concrètes et contraints de tenir compte des nouvelles réalités sociales au fil du temps. Lorsque nous demandons si le droit d’être libre inclut le droit d’épouser une personne du même sexe, nous répondons à présent par l’affirmative et, ce faisant, nous étendons et élargissons notre idée de la liberté, en concrétisant un principe abstrait et en modifiant le concept que ce principe défend. La liberté et l’égalité acquièrent de nouvelles significations. Ou, dans le cas de l’émancipation des esclaves, l’institution juridique a pris conscience que les notions historiques antérieures de liberté étaient limitées à la propriété blanche et aux propriétaires d’esclaves.
Heureusement, nos conceptions de la liberté ont évolué au fil du temps, et il incombe aux tribunaux de reconsidérer et de reformuler la liberté en réponse à des remises en question historiques légitimes. Dans l’arrêt Obergefell, la Cour déclare que les droits fondamentaux ne sont pas issus « des seules sources anciennes » mais doivent être considérés à la lumière de l’évolution des normes sociales. L’histoire intervient invariablement dans les processus décisionnels. En effet, cette décision cruciale visant à établir le droit au mariage homosexuel mettait en garde contre le fait de fonder le droit exclusivement sur des pratiques et des dispositions traditionnelles, ce qui aurait pour conséquence d’interdire aux unions non traditionnelles de prétendre à des droits égaux à ceux des mariages hétéronormatifs.
Ici comme ailleurs, les conservateurs ont remis en question le fait que de nouvelles libertés (freedoms) puissent réellement être considérées comme la « liberté » (liberty) si le langage de la loi ne permet pas d’en attester la présence. Et nous assistons à une Cour, c’est-à-dire l’instrument judiciaire le plus puissant des États-Unis, qui fait valoir les intérêts de l’État dans les décisions en matière de procréation au détriment de toute revendication que les femmes pourraient avoir. Peut-être pensons-nous que cela n’a pas grand-chose à voir avec les législatures d’État qui interdisent les livres contenant des références à la sexualité et au genre, qui poursuivent en justice les parents qui cherchent à obtenir des soins de santé pour leurs enfants trans, ou les nouvelles attaques contre les personnes LGBTQIA+, mais détrompons-nous.
Les personnes les plus touchées par ces nouvelles formes de privation de droits sont les personnes de couleur pauvres des États “non libres”.
Cette analyse a au moins trois conséquences qui méritent d’être soulignées. La première est que nous aurions tort de croire que la Cour ne s’intéresse qu’à l’abolition de l’avortement en tant que droit fédéral. Les arguments opposés à l’avortement peuvent être utilisés contre un grand nombre de décisions qui supposent que de nouveaux droits émergent de nouvelles conditions sociales relatives à la sexualité, au genre, à l’association intime et à la liberté de procréation. Le problème n’est pas qu’ils s’en prendront d’abord à l’avortement, ensuite au mariage gay et enfin à la contraception. Non, le cadre juridique qui se dessine prend pour cible l’idée même de formes historiques nouvelles du principe de liberté (et d’égalité) et cherche à restaurer l’ordre patriarcal en s’appuyant sur la force de la loi fédérale.
La seconde conséquence : la diabolisation des femmes qui ont recours à l’avortement, considérées comme des agresseuses ou des meurtrières, fait écho à l’attaque contre l’éducation sexuelle dans des États comme la Floride, le Texas et l’Oklahoma, où les enseignants qui abordent des sujets tels que le genre ou la sexualité sont désormais accusés d’abus ou d’endoctrinement, ou au signalement aux autorités gouvernementales de parents qui cherchent à obtenir des soins pour leurs enfants transgenres. Et que dire du refus de reconnaître les droits légaux des personnes transgenres et leur droit aux soins de santé, y compris à l’avortement ? Dans chacun de ces cas, “l’intérêt de l’État” est élargi par l’éradication des libertés fondamentales, celles qui appartiennent aux femmes, aux personnes trans, et en effet, aux personnes LGBTQIA+, aux enseignants et aux universitaires, aux décideurs politiques et aux législateurs qui travaillent pour plus de libertés sociales et d’égalité.
Pour finir, la droite a rassemblé beaucoup d’entre nous en une seule et même cible, comme le montrent les tactiques du mouvement de l’idéologie antigenre qui opère désormais à l’échelle mondiale. Notre tâche n’est pas de nous disperser dans nos propres recoins identitaires en nous accrochant à un objectif au détriment des autres, mais plutôt de nous rassembler en un mouvement plus massif et puissant. Cela implique que les féministes se rallient aux personnes trans, que les défenseurs du mariage gay se rallient à ceux qui luttent pour les bars et les espaces communautaires queer et trans, que la question de la santé reproductive figure dans tous les ordres du jour pour tous les types de femmes et d’hommes, les personnes non binaires, y compris les enfants trans et genderqueer, tout comme devraient y figurer la protection contre le harcèlement et la violence sexistes et sexuels.
Mais rien de tout cela ne fonctionnera si nous ne comprenons pas que les personnes les plus touchées par ces nouvelles formes de privation de droits sont les personnes de couleur pauvres des États “non libres” (“unfree”). Et il ne pourra y avoir de coalition digne de ce nom sans avocats intelligents et radicaux capables de contester et d’arrêter cette tendance juridique. Si la droite nous rassemble en une cible plus efficacement que nous ne nous rassemblons en un mouvement, alors nous sommes perdus. Alors prenons pleinement conscience du pouvoir de la coalition et révisons et affinons nos revendications de liberté et d’égalité en tant que revendications sociales, collectives, historiques — et indispensables.
traduit de l’américain par Hélène Borraz
