D’un gouvernement sans logement
L’éclipse du ministère du Logement dans le dernier gouvernement n’est pas un phénomène nouveau. Rappelons que sous la Ve République, ce grand dossier fut d’abord placé sous la tutelle de la Construction, avant d’être associé à l’Équipement, aux Transports, puis à la Ville et à l’Écologie. Après la loi ELAN (2018) qui a profondément réformé le logement social, mis en place de nouveaux dispositifs contre les marchands de sommeil, et ouvert la possibilité d’un encadrement des loyers dans les zones tendues, la question du logement se trouve raccrochée à la transition écologique et à la cohésion territoriale.
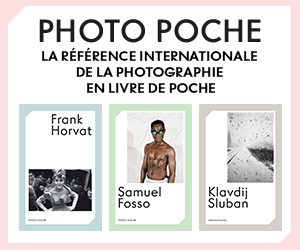
Le dossier du logement fait pourtant partie des enjeux les plus importants de l’organisation sociale, à la fois besoin essentiel à satisfaire au même titre que la santé, l’éducation, l’alimentation, la mobilité et, par là même, enjeu majeur dans l’organisation du territoire. C’est le logement qui fonde le foyer et donne à tout un chacun son « lieu ». Le logement est un dossier politique lourd d’une longue histoire et de débats d’importance dont témoigne le fameux livre de Engels, La question du logement (1872).
Aujourd’hui, c’est donc au prisme de la maitrise des dépenses énergétiques et des stratégies locales que seront traitées les questions de l’extension périurbaine, du logement abordable, de l’habitat indigne, des marchés immobiliers et du sans-abrisme. Il faut supposer que, bien que corsetés par l’Etat, les territoires seront en mesure de répondre à toutes ces questions. L’éclipse du thème du logement dans la longue liste des portefeuilles ministériels, déjà constatée entre 2017 et 2020 et, maintenant, en ce début de second mandat du président Macron, nous semble significatif d’une tendance longue qui ne concerne pas seulement l’organisation politique de la France : celle d’une atomisation de la problématique du logement.
L’archipel résidentiel
Dans un livre à paraitre (juillet 2022)[1], nous qualifions la tendance à l’atomisation des formes de régulation de l’habitat « d’archipel résidentiel ». Nous observons sur le long terme, du début du XXe siècle à aujourd’hui, tandis que la crise du logement, ce mantra des experts de l’habitat, creuse les inégalités d’accès au logement décent, une dynamique d’adaptation et de diversification, instillée par de « nouveaux marchés » et des transformations dans les modes de vie. Si tout un chacun s’encastre dans des formes d’habitat existantes, nombreux sont ceux qui tentent d’en inventer de nouvelles. Par là même, ils mettent en question l’édifice normatif, produit d’une pensée bureaucratique qui court depuis le début du XXe siècle, et contribua à délimiter, hiérarchiser et cloisonner le champ de ce qui est admissible en matière de logement.
Pour comprendre la dynamique des formes nouvelles d’habitat et la recomposition de la question du logement, nous proposons une grille de lecture en termes d’archipel. La perspective de l’archipel permet d’observer l’espace des différenciations comme une mosaïque de contextes reliés entre eux par la conscience structurante d’une unicité. Tout archipel est animé par deux mouvements : l’un s’attachant à différencier ses entités et identités, héritées et nouvelles, l’autre à appréhender comme un tout la diversité de ses formes.
La grille de lecture archipélique invite, tout à la fois, à étudier un ensemble différencié qui se stabilise comme un édifice, et à explorer un champ labyrinthique non fini, qui ne cesse de se fractaliser. Pour chaque forme sociale d’habitat, on peut caractériser son contexte, la place qu’elle prend dans l’archipel, et sa connexion à la dynamique de la « crise » du logement. Chaque forme sociale nouvelle se détache de l’ensemble en acquérant une identité spécifique, formalisée par une régulation et des règles de fonctionnement propres, en particulier de mise en marché et de modalités d’accès de ses occupants.
Ainsi, différents processus contribuent à éclater l’offre d’habitations en de nombreux sous-segments, de l’habitat de luxe au « sans-abrisme ». Alors que le processus distinctif s’oppose à la standardisation, en promouvant l’habitat de luxe comme forme identitaire, le processus de l’exclusion alimente la ségrégation, contrecarre la mixité sociale, au profit de la préservation de l’entre-soi et de la fermeture des espaces résidentiels. Ne pouvant s’opposer à la dynamique ségrégative et spéculative du haut de l’échelle sociale, l’État développe un processus normalisateur, qui sert à généraliser les standards du logement « normé », notamment par le biais de l’habitat social. Reste une troisième voie, la voie alternative, qui, en France, se fraie un chemin avec difficulté, en revendiquant une capacité d’inventions et d’expérimentations individuelles et collectives, qui se veut transgressive par rapport aux modèles hérités et promus par la puissance publique.
Visite rapide de l’archipel
Pour ouvrir notre voyage dans l’archipel résidentiel, on se penche sur l’habitat haussmannien qui, dès le milieu du XIXe siècle, montre comment la crise urbaine de l’attractivité des villes occasionne l’émergence de dispositifs d’habitat nouveaux, spécifiés par des modes de production, des règles d’entrée et de gestion, des configurations d’acteurs. Le modèle haussmannien a développé une offre attractive fondée sur la ségrégation spatiale, à l’échelle de la ville et de l’immeuble, et promu une combinaison des valeurs de représentation et d’intimité propre au mode de vie bourgeois. Par contrecoup, le logement social nait de la raréfaction de l’offre locative bon marché. Il permet de rendre moins sévères les conséquences des crises du logement et a été conçu pour réguler les trajectoires individuelles : du taudis à l’appartement puis, d’étape en étape, jusqu’à la maison « en toute propriété ».
En France, ce projet de « transition » a valorisé un modèle de creuset urbain, accueillant une grande diversité de ménages et leur offrant, tel un tremplin, l’espoir d’un accès au rêve de la maison individuelle. Ainsi le logement social, en tant qu’acteur collectif, s’est-il construit sur une vision segmentée et hiérarchisée du parc immobilier, mobilisant volontiers des notions comme l’adaptation, l’intégration, la socialisation. Dix millions de personnes locataires et occupantes de logements sociaux vivent à telle enseigne. Par extension, toute une généalogie de logements vertueux se développe dans ce sillon, « accompagnant » les ménages, depuis l’apprentissage de l’apprentissage, autrefois, de l’économie ménagère à l’économie des pratiques écoresponsables d’aujourd’hui.
Par contrecoup, un processus distinctif fait émerger la maison individuelle, souhaitée par une grande majorité des Français nourris de désirs d’autonomie, de propriété, de vie familiale et de rapprochement de la « nature ». Plus de la moitié des ménages Français y résident, mais cette forme rencontre une opposition résolue des classes supérieures, chez qui l’uniformité pavillonnaire suscite un rejet affirmé, ainsi que des architectes et des urbanistes, défenseurs de la densification résidentielle. En 2021, la ministre du Logement avait d’ailleurs suscité beaucoup de réactions en déclarant que les maisons individuelles représentaient un « non-sens écologique, économique et social » (Le Monde, 26 octobre 2021).
Pourtant, les crises récentes – Gilets jaunes puis Covid-19 – plaident pour une réhabilitation du modèle pavillonnaire et la sortie de la « diabolisation du périurbain ». Pourquoi la maison individuelle ne constituerait-elle pas l’aboutissement légitime d’un parcours résidentiel pour ceux qui ont connu l’habitat collectif sous ses différentes formes dans une première partie du cycle de vie ? Si le vieillissement de la population s’amplifie à l’horizon 2050, il faudra que les experts de la question du logement pensent plus résolument la complémentarité entre l’habitat collectif dense maximisant l’accès aux services essentiels (au premier rang desquels les soins de santé) et l’habitat individuel optimisant les bénéfices d’un cadre de vie plus sain. Comme dans bien d’autres registres, ce n’est pas la maison individuelle qui est contestable, mais bien la manière que l’on a de la massifier.
Contre la vision normée, le processus distinctif produit l’habitat de luxe qui se nourrit subtilement de visibilité et d’entre-soi. Tandis qu’à l’opposé du spectre, la « norme » rejette mécaniquement les formes dégradées du sous-logement, voire du non-logement, dont les statistiques et les politiques rendent difficilement compte : les taudis, les squats, les îlots insalubres, la Zone, les bidonvilles, les camps. La notion de « sous-logement » témoigne, en raison de la précarité de l’existence de ses habitants, d’une « crise » manifeste. Plus de quatre millions de ménages en souffrent selon les rapports de la Fondation Abbé Pierre. Elle pose la question de ce qui est admis comme étant un « logement » dans notre société. Si l’habitat hors des normes, qualifié de taudis, de logements défectueux, inadaptés, indignes, indécents, spontanés, illégaux ou illégitimes, renvoient à des contextes très différents, le processus de leur stigmatisation reste toujours et partout d’actualité.
C’est par ailleurs un processus qui cloisonne : d’un côté le logement dégradé est pris en compte par les politiques publiques parce qu’il représente, au regard de la norme, un segment certes inadapté mais partie prenante du parc existant ; de l’autre, les situations de non-logement repoussées à la marge parce qu’elles « excèdent » le parc délimité par les statistiques du logement sont purement et simplement maintenues « hors champ », laissées aux initiatives des associations. Oubliant que la puissance publique a bien voulu reconnaître, dès la fin du XIXe siècle, la réalité du taudis et la nécessité de son éradication, au nom de l’objectif majeur de l’hygiène publique, les sociétés contemporaines ont du mal à regarder la réalité du non-logement comme une question de non-accès aux droits fondamentaux et de mise en danger des personnes. Les personnes vivant à l’année dans les campings, les sans domiciles fixes qui se bâtissent des cabanes, les « sans-papiers » dans les camps, n’ont ni nom, ni existence légale au regard du logement, ce qui est plus commode pour effacer leurs campements.
Dès lors, quelles alternatives ? Dans le paysage du logement, comme dans celui de la mobilité et du travail, les « solutions co- » (colocation, covoiturage, coworking) font recette. Elles ont fait irruption au niveau local quasi simultanément, d’une manière qui a pu paraître spontanée, alternative et innovante. Indépendamment de leur apparente nouveauté, qui mérite d’être interrogée, ces formes ont pour point commun de participer de l’avènement de la « communauté des individus ». S’il est difficile de définir un collectif dépourvu de structure organisationnelle, sinon par l’action qu’il poursuit, les « solutions co- » donnent à voir des mécanismes de fonctionnement collectifs originaux, différents des pratiques habituellement hiérarchisées des groupes sociaux.
Dans la colocation, la « vie collective » privilégie le caractère flexible des règles, favorise l’entente et la compréhension au détriment de la sanction et de l’application de la « règle opposable ». Ces formes d’organisation diffèrent des pratiques normées du vivre ensemble dans les copropriétés, cadrées par des règlements intérieurs explicites et implicites. Dans ce cadre, la difficulté d’accès au logement qui est le lot des personnes vulnérables ou sur le seuil de l’intégration économique (étudiants, jeunes travailleurs), pourrait trouver une issue dans ce nouveau marché, fondé sur l’utilisation du parc immobilier existant, dont il reste néanmoins à évaluer les modalités de fonctionnement. Voilà qui interroge par ricochet la copropriété, qui a émergé au début du XXe siècle, mais peine encore à se projeter en tant que communauté de projets.
C’est bien ce qui tente de s’investir dans les différentes formes de « l’habitat participatif », qui recouvre des projets collectifs d’habitat empruntant des statuts juridiques très divers, depuis la forme de la copropriété jusqu’à celle de la SCI (société civile immobilière), en passant par la colocation, mais aussi la Coopérative d’habitants, cadrée par la loi sur la coopération de 1947, cette dernière valorisant l’autopromotion et l’autoconstruction. Tous les groupes qui se constituent pour faire sortir de terre un habitat participatif développent une culture d’acteur alternatif qui se heurte aux partenaires institutionnels de la construction.
En dépit des difficultés et aléas – l’aboutissement des projets participatifs étant toujours laborieux –, des opérations emblématiques ont vu le jour et servent de références, comme le Village vertical à Villeurbanne, Eco-Logis à Strasbourg, MasCobado à Montpellier. À la différence d’autres pays européens, la politique du logement a bien du mal, en France, à introduire le collectif d’habitants comme un acteur légitime et à promouvoir l’expérimentation en matière de construction. La multiplication des vocables – « autopromotion », « habitat groupé », « habitat participatif », « éco lieux » – témoigne de la difficulté des innovations à passer au travers des barrières juridiques et financières.
La difficulté à ouvrir le jeu pour que l’habitant se projette comme acteur de la construction nourrit la dynamique transgressive. Corseté par les contraintes réglementaires et la frilosité des opérateurs du logement, un tiers secteur cherche sa voie. La tentation est grande de subvertir les limites imposées par les collectivités locales, via les plans d’urbanisme directeurs, et par les promoteurs, via les normes du Code de la construction. Friches urbaines et zones à défendre sont des territoires où s’enfantent des formes d’appropriation « sauvages » du territoire et où expérimentent des collectifs voulant créer des « écolieux » et des « tiers-lieux », dans les espaces délaissés et les bâtiments vacants.
Parallèlement, parmi les populations précaires et les populations désireuses d’échapper au mode de vie normé, se développent des modes de vie en « habitat léger », sous différentes formes, depuis la caravane jusqu’à la tiny house, en passant par la yourte et divers autres modèles d’écoconstruction individuelle.
Conséquences politiques
Les groupes sociaux qui investissent ces formes résidentielles, les acteurs économiques qui structurent de nouveaux marchés, les architectures résidentielles qui en résultent, composent la configuration actuelle de l’archipel en recomposition constante. C’est en prenant en compte la multiplicité des formes de ce dernier que l’on peut mesurer l’ampleur de la question du logement et la diversité des régulations attendues à l’échelle des territoires.
L’habitat est un espace d’enjeux politiques, et non simplement un marché́ perverti par le libéralisme financier. Parce que l’économie du logement s’emploie à verrouiller des « produits » immobiliers, hiérarchisés et normalisés, les normes qui les formalisent constituent un enjeu âprement défendu, suscitant en retour leur contestation et leur détournement. Il est temps de cesser d’ignorer la multiplication de formes alternatives d’habitat qui se développent dans les interstices du champ normé, et forment des rhizomes qui contribuent à l’expansion de l’archipel du logement.
D’une certaine façon, la crise du logement s’amplifie par la non-reconnaissance de la diversité des solutions que développent les acteurs et par l’accumulation de dispositifs normatifs corsetant les pratiques habitantes et l’innovation. L’enjeu politique contemporain est de savoir observer et reconnaître des formes d’habitat qui élargissent le champ, comme la colocation ou l’habitation mobile, et le stratifient sans cesse comme celles des mal-logés.
Regarder le champ de l’habitat et la question du logement comme un archipel de formes nourrit l’idée qu’il est possible d’ouvrir le jeu pour penser des alternatives à la massification uniformisatrice et imaginer des expérimentations en mesure de rendre effectif le « droit au logement pour tous ». Les compétences dévolues aux territoires seront-elles en mesure de favoriser cette dynamique ? Les collectivités territoriales sauront-elles, mieux que l’État centralisateur, prendre la mesure de l’amplification de l’archipélisation résidentielle ? C’est bien la question que suscite la disparition du dossier du logement dans les affichages ministériels.
NDLR : Yankel Fijalkow et Bruno Maresca ont récemment publié L’archipel résidentiel. Logements et dynamiques urbaines chez Armand Colin.
