Treize ans après, le silence tunisien
Officiellement, le 14 janvier 2011 ne représente plus rien. Pour les Tunisiens, et pour l’histoire, il marque pourtant la chute de la dictature de l’ancien président Ben Ali et le premier jour des printemps arabes, qui bouleversa le quotidien de 500 millions de personnes et inspira le monde entier.
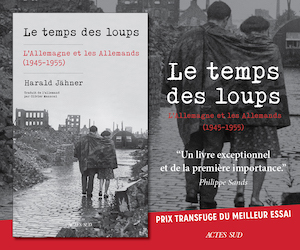
Mais pour le président tunisien actuel, Kaïs Saïed, cette date du 14 janvier « ne signifie rien» puisque, selon lui, « la révolution n’est pas terminée». Depuis deux ans, par sa volonté, le 14 janvier n’est donc plus la date de la fête nationale, changée pour le 17 décembre, jour de l’immolation du marchand ambulant Mohamed Bouazizi. À travers cette date du 14 janvier, c’est à l’ensemble du récit révolutionnaire que le président tunisien s’est attaqué, ainsi qu’à ses accomplissements. Après avoir dissous le Parlement, le président s’est arrogé les pleins pouvoirs, et tente de faire taire toute voix dissonante. Pour l’heure, les protestations internationales sont peu nombreuses.
Dans son entreprise d’éteindre les derniers feux de la Tunisie révolutionnaire, Kaïs Saïed est, il est vrai, bien aidé par la redistribution des cartes géopolitiques en cours depuis son élection. Marginalisé au cours des années 2010, le conflit au Proche-orient dicte de nouveau l’actualité et concentre toute l’attention régionale et internationale, au détriment du Maghreb et des pays qui ont porté les printemps arabes. La Tunisie ne comptent plus désormais que pour sa problématique migratoire. Les négociations avec l’Union Européenne – qui verse à la Tunisie une aide de 105 millions d’euros pour lutter contre l’émigration illégale – concerne essentiellement cette thématique. Selon le Haut commissariat aux réfugiés des Nations unies, la Tunisie est devenue en 2023 le principal point de départ des migrants en Méditerranée. Sur les 157 301 personnes qui ont débarquées sur les côtes italiennes l’an passé (266 940 pour l’ensemble sur les côtes du Sud de l’Europe), 97 306 venaient de Tunisie. Seulement 9,8 % des migrants disposaient toutefois de la nationalité tunisienne.
Cette nouvelle donnée migratoire constitue paradoxalement une carte importante dans le jeu trouble de Kaïs Saïed, un président tunisien qui a su saisir l’opportunité offerte par son temps pour imposer un pouvoir autocratique à des électeurs auxquels il avait vendu la poursuite du projet révolutionnaire. Etape après étape, il s’est attelé avec minutie à détruire l’essentiel des acquis de l’expérience démocratique tunisienne, unique au Maghreb et au Moyen-Orient.
Rappelons-les rapidement. Après le départ de Ben Ali en 2011, la Tunisie a réussi en moins d’une année à organiser les premières élections libres et démocratiques de son histoire. Puis, en dépit des aléas d’un gouvernement peu efficace et de la crise née de l’assassinat de deux opposants politiques, le pays est parvenu à un consensus pour poursuivre cette expérience démocratique. En janvier 2014, une constitution est née. Texte le plus avancé (et de loin !) dans la région, ses mérites sont nombreux – nous le remarquions en 2021 dans les colonnes d’AOC.
Organisée en 10 chapitres et 149 articles, cette constitution stipule que « les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et devoirs », et qu’ils « sont égaux devant la loi sans discrimination aucune ». Les articles 22 et 46 posent de manière explicite l’égalité entre hommes et femmes ainsi que le principe de parité. Le texte mentionne en outre la révolution tunisienne, et insiste à plusieurs reprises sur le caractère démocratique de l’État tunisien. Contrairement à celle adoptée en Égypte à la même époque, il ne fait pas référence à la charia. L’article 42 énonce que « le droit à la Culture est garanti », tout comme « la liberté de création. » Autre innovation qui aurait permit de faire franchir à l’expérience tunisienne une nouvelle étape, l’article 131 pose que « le pouvoir local est fondé sur la décentralisation. » L’article 133 précise de son côté le mode d’élection de ce pouvoir local, organisé en municipalités, régions et départements.
Par la suite, ces deux articles vont être totalement ignorés par les gouvernements tunisiens successifs, empêchant ainsi la Tunisie de poursuivre son développement institutionnel et démocratique. Après le vote du texte constitutionnel, l’année 2014 marque le début de la fin des réformes. Les années de présidence de Béji Caïd Essebsi seront celle d’un immobilisme absolu qui, outre les attentats de 2015, achèvera de plonger le pays dans une crise politique permanente. L’absence de réforme de fond de la police, de la justice et la permanence de la corruption vont précipiter la chute des partis qui ont administré cette transition.
En 2019, Kaïs Saïed joue de ce discrédit pour se faire élire, dissoudre le parlement, et faire ratifier une nouvelle constitution qui instaure un pouvoir présidentiel quasi-absolu, à côté de deux chambres élues pour la forme. Les Tunisiens ne sont plus dupes. Parodie de scrutin, les élections de décembre 2023 – qui concernent les membres du Conseil national des régions et des districts, la future chambre haute du Parlement – affichent un taux de participation de… 11,66%.
Dans le même temps, un arsenal législatif est déployé pour faire taire toute critique. Parmi la longue liste d’opposants emprisonnés ou faisant l’objet de poursuites, l’ancien premier ministre Ali Larayedh fait figure de cas emblématique. Le vice-président du principal parti d’opposition, Ennahda, est détenu arbitrairement depuis plus d’un an pour des accusations vagues de « terrorisme ».
En quatre ans, Kaïs Saïed a renié toutes ses promesses électorales pour assoir son régime autocratique dans la durée.
Cible particulière des autorités ces derniers mois : les journalistes. Le 13 septembre 2022, le président tunisien a émis un décret-loi n° 2022-54 relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d’information et de communication. Les autorités s’appuient notamment sur l’article 24 de ce texte qui prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 dinars (environ 16 000 euros) et cinq ans de prison pour l’utilisation des réseaux de communication afin de « produire, répandre, diffuser … de fausses nouvelles, de fausses données, des rumeurs » dans le but de « diffamer les autres, porter atteinte à leur réputation, leur nuire financièrement ou moralement, inciter à des agressions contre [eux] ou inciter au discours de haine », « porter atteinte à [leurs] droits », « porter préjudice à la sûreté publique ou à la défense nationale, ou semer la terreur parmi la population ». La peine de prison est doublée si l’infraction est considérée comme visant un « agent public ou assimilé ».
Fin décembre, l’ONG Human rights watch a publié un état des lieux de vingt-deux affaires qui trouvent leur origine dans des plaintes déposées par des responsables ou des entités gouvernementaux. Et mercredi 10 janvier, un rassemblement a eu lieu devant le tribunal de Tunis à l’appel du Syndicat national des journalistes tunisiens pour de « réclamer la libération des confrères journalistes Zied El Heni, Chada Haj Mbarek et Khalifa Guesmi et mettre fin aux lois hostiles à la liberté de la presse et à la liberté d’expression ». Exemple parmi tant d’autres du harcèlement dont font l’objet les journalistes en Tunisie, Zied El Heni était détenu depuis le 28 décembre pour avoir qualifié de « kazi » (« guignol » ou « bougre » en arabe) la ministre du commerce. Inculpé sur la base de l’art 86 du code des télécommunications, il risquait une à deux années d’emprisonnement. Il a finalement été condamné à six mois de prison avec sursis. Par ces poursuites répétées pour des motifs équivoques, les autorités tunisiennes entendent réduire au silence toute une profession, et plus largement, faire taire toute tentative de contestation ou de critique du pouvoir.
Négation du récit révolutionnaire, destruction des acquis de la révolution, absence de contre-pouvoirs, mis au pas du Parlement, emprisonnements des opposants politiques et des journalistes, permanence de la corruption, absence de réforme de la police et instrumentalisation de la justice… En quatre ans, Kaïs Saïed a renié toutes ses promesses électorales pour assoir son régime autocratique dans la durée.
La principale limite de ce dispositif est économique. Sous Ben Ali, dans un contexte marqué par un fort népotisme et la prébende de la famille présidentielle, le mirage d’une économie efficiente (3 % de croissance du PIB en 2009) contribuait à donner l’illusion d’un pays stable. Un rideau de fumée dont le président actuel ne peut guère se prévaloir. Après la catastrophe des années covid (contraction du PIB de 8,7 % en 2020), la croissance n’était que de 1,2 % au premier semestre 2023. Insuffisant pour espérer réduire le taux chômage élevé (15,67%). La Tunisie doit affronter une inflation à deux chiffres (10,4 % au plus haut en février 2023, 9 % au plus bas en septembre dernier), et ne dispose pas des ressources en hydrocarbures de son voisin algérien pour attirer des devises ou subventionner l’énergie et les produits de première nécessité. Selon la Banque mondiale, la Tunisie continue en outre de « dépendre des prêts souverains en raison de conditions de financement incertaines et du poids du remboursement de la dette extérieure (3 % du PIB) à court terme. » Le retour des touristes en Tunisie en 2023 – dont on mesure encore mal l’apport en devises et en emplois directs faute de statistiques récentes – ne sauvera pas à lui seul l’économie du pays, quand beaucoup de ces touristes privilégient des séjours courts (quatre jours en moyenne en 2022) et low cost, pour certains à moins de 200 euros, vol compris. Comme au temps de Ben Ali.
