Décarboner l’industrie du ciment
«Si l’espèce humaine devait soudainement disparaître de la surface de la planète, le dernier siècle de notre existence serait clairement identifiable cent millions d’années plus tard par une couche très spécifique de sédiments, recouverte de rouille, que l’on trouverait sur absolument tous les continents », imagine Robert Courland dans l’introduction de son ouvrage Concrete planet[1] consacré à l’histoire du béton. La couche dont parle Courland, ce sont les vestiges du béton armé. Longtemps ignorés par les indicateurs du changement climatique et de l’Anthropocène, le béton et son liant, le ciment, sont désormais considérés au même titre que le plutonium ou encore les microplastiques.
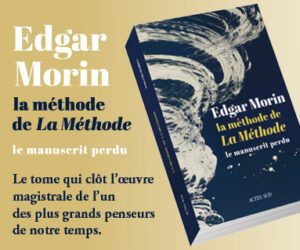
Arrêter de produire du béton ? Facile à dire, mais pas facile à faire, tant cette matière a infiltré notre quotidien, nos économies mais aussi nos cultures. Dans l’hémisphère nord, on commence à lui associer les écueils de la modernité, de l’inhumanité des cités-dortoirs, à l’obsolescence des infrastructures et à leurs effondrements spectaculaires. En revanche, dans le Sud global, elle reste un symbole fort de modernité positive[2], d’épargne et du rêve d’une vie meilleure en dur, alors que la terre crue, accusée d’archaïsme bien qu’elle soit parfaitement adaptée aux climats chauds, est rejetée. La bande dessinée Béton, Enquête en sables mouvants[3], parues aux Presses de la cité, s’attaque à ce géant du XXe siècle pour comprendre et vulgariser les conséquences environnementales de sa production exponentielle, l’extractivisme ardu qu’il sous-tend, mais aussi les pistes pour sortir du « tout-béton ».
Le béton et le ciment c’est avant tout une histoire de multinationales, 50% de la production mondiale est aux mains de dix entreprises. La gronde écologiste anti-béton apparue il y a cinq ans s’attaque expressément à eux. En 2019, les militants d’Extinction Rébellion bloquaient les sorties des bétonnières de sites de production de béton prêt à l’emploi de l’Île-de-France destinées aux chantiers du Grand Paris.
En France, de nombreuses associations luttent actuellement férocement contre la création de nouvelles gravières. Même en Suisse, traditionnellement si paisible, l’émergence de la première Zone à Défendre pour lutter contre l’extension d’une carrière exploitée par le cimentier Holcim en 2021 a marqué les esprits. Les slogans résonnent fort et se font écho : « Stop béton », « Pollueurs », « Écoterroristes », « Laisse le sable à la mer », « Le béton est armé », « Construire à en crever »… Ces actions mettent en lumière les débats cruciaux sur l’impact environnemental mais aussi social du béton, et interpellent les géants de cette industrie sur les injonctions de verdissement de leur secteur. Mais un béton écologique est-il vraiment possible ?
D’énormes problèmes à résoudre
Le béton est une matière « magique » grâce à l’hydraulicité du ciment : il suffit de mélanger 75% de granulats (sable et gravier), 10 à 15% de ciment, d’y ajouter de l’eau, tout cela coulé dans un coffrage, pour qu’en quelque heures le mélange durcisse et prenne la forme que l’on souhaite. En y associant le fer, les inventeurs du ciment-armé ont résolu au XIXe siècle l’un des défauts majeurs du béton, qui travaille en compression, pour lui associer la traction du métal et lui permettre ainsi de franchir de grandes portées.
On comprend qu’avec ces qualités indéniables l’association fer-béton a conquis le monde pour supplanter tous les autres matériaux. En seulement quelques décennies, 80% de ce qui se construit sur le globe est en béton ! Cette matière souffre cependant de quatre problèmes majeurs, tout aussi compliqués à résoudre les uns que les autres. Si certains avaient été anticipés par les ingénieurs à l’origine des avancées technologiques de cette matière composite au XXe siècle, tous n’avaient pas été identifiés.
Le processus de fabrication du ciment émet beaucoup de CO2
Le ciment, composant essentiel du béton, est fabriqué à partir de calcaire et d’argile, des matières que l’on trouve pratiquement partout sur la surface du globe. Ce mélange est chauffé à une température de 1 450°C dans un four rotatif pendant 18 heures afin de produire une matière carbonisée appelée clinker. À cette étape, on lui ajoute du calcaire non cuit, du plâtre ou des déchets d’autres industries[4] afin d’obtenir le ciment.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’impact carbone du clinker, qui est donc le principal composant du ciment, ne se situe majoritairement pas dans l’énergie nécessaire pour atteindre une telle température mais dans le fait que le calcaire libère du dioxyde de carbone lors de la cuisson à travers un phénomène appelé « décarbonatation », qui représente plus de 60% des émissions de CO2 liées à la production de cette matière. Les 40% restants des émissions proviennent de l’énergie nécessaire pour atteindre cette température. Le processus même de fabrication du ciment émet donc inévitablement du CO2. Se passer d’énergies fossiles ne résoudrait par conséquent qu’une seule partie du problème.
Bien qu’une tonne de ciment émette nettement moins de CO2 que la production d’une tonne d’acier, d’aluminium ou de verre, les quantités annuelles produites sur la planète sont si importantes que l’industrie du ciment représente désormais 6 à 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit trois fois plus que celles générées par l’ensemble du trafic aérien mondial.
Le béton dévore le sable
Le béton est principalement composé de granulats (sable et gravier) provenant de gravières terrestres, du lit des rivières ou du fond des mers et des océans. La quantité annuelle de granulats extraits pour la construction est impressionnante, atteignant 50 milliards de tonnes par an, ce qui en fait la matière première la plus consommée au monde après l’eau. En France, plus de 36 000 carrières sont aujourd’hui en activité. Leur création est réglementée depuis 1993 à la suite de pratiques douteuses consécutives à l’urbanisation de l’après-guerre. La même loi interdit également l’extraction de sable des rivières, en raison d’une baisse importante du niveau de l’eau, déjà constatée et directement imputée au prélèvement incontrôlé de gravier et de sable.
Les conséquences écologiques planétaires de cette course au sable sont particulièrement préoccupantes : érosion des berges, disparition des plages, perte de biodiversité, fragilisation des côtes accroissant leur exposition aux ouragans et aux tsunamis, sans compter la perte des moyens de subsistance des communautés vivant de la pêche. Le sable est surexploité partout, sans que la législation ne soit capable de suivre son rythme, entraînant par là même l’émergence de mafias et même la mort de journalistes enquêtant sur le sujet en Inde.
Le Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE-GRiD) a réussi à inclure deux clauses à la 4ème session de l’assemblée des Nations unies pour l’environnement de 2019 à propos de l’exploitation sauvage du sable et de ses conséquences. Elle a été suivie d’un second rapport en 2022 intitulé « Sable et durabilité : 10 recommandations stratégiques pour éviter une crise ». Cependant, le PNUE peine à mettre en place l’Observatoire mondial du sable, projet en gestation depuis quatre ans mais sans surprise récemment rejeté par l’Inde et l’Arabie Saoudite.
L’association acier-béton est obsolescente
Bien que l’association de l’acier et du béton ait façonné les villes du siècle dernier, cette alliance engendre également sa propre obsolescence. Le béton armé exposé aux intempéries absorbe le CO2 présent dans l’air, provoquant la corrosion des armatures en acier à l’intérieur et l’apparition de fissures. Sans un entretien adéquat, ces fissures peuvent causer des effondrements catastrophiques, comme ce fut le cas du pont de Gênes en 2018.
Ce phénomène, communément appelé le « cancer du béton », exige un entretien rigoureux et coûteux des infrastructures et des bâtiments construits en béton exposé. Pour preuve, le budget français alloué à l’entretien des routes et des ouvrages d’arts est en constante augmentation et s’approche du milliard d’euro en 2023, sans compter une augmentation annuelle indispensable de 10% pour pallier le mauvais état général des infrastructures vieillissantes.
De plus, ces dernières décennies, l’utilisation de sable iodé mal lavé, une pratique courante dans les pays du Sud, a accéléré la corrosion à l’intérieur des mélanges de béton, entraînant ainsi une obsolescence plus rapide. En conséquence, l’entretien devient nécessaire dès les premières années de la construction. Cependant, la maintenance importante des structures en béton armé exposées n’est jamais incluse dans les budgets de construction initiaux.
Le béton produit des déchets
Enfin, les ouvrages d’art et bâtiments en béton génèrent des déchets. Alors que les villes étaient traditionnellement reconstruites avec les matériaux issus des époques précédentes, l’avènement du béton a introduit le concept de matériau à usage unique. Il représente probablement le premier matériau à produire des déchets en fin de vie car la démolition des bâtiments en béton est coûteuse, complexe, énergivore et polluante.
Aujourd’hui, la majeure partie des granulats issus des démolitions est « down-cyclée » et utilisée comme remblai ou sous-couche lors de la construction des routes. Cette préférence pour l’enfouissement s’explique par la complexité actuelle du processus de broyage nécessaire à la réintroduction de granulats dans un nouveau béton, des normes techniques autrefois prudentes mais en pleine évolution sur l’utilisation de granulats issus de démolitions dans les bétons neufs et par l’entretien des routes, ogre de granulats, qui accepte volontiers les granulats recyclés pour ses réparations.
Net Zéro
Alors que la demande en ciment et en granulats est en constante augmentation, les industriels du secteur font face à un défi colossal : réduire rapidement leurs émissions de carbone. En France la troisième édition de la Stratégie Nationale Bas-Carbone prévoit de sommer les entreprises d’intensifier leurs moyens pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L’objectif d’une réduction de 35 % en 2030 déjà fixé à l’industrie sera désormais porté à 50 %, soit une demande totale de 81% par rapport à 2015.
Le groupe franco-suisse LafargeHolcim, qui avait fusionné en 2015 pour redevenir tout simplement Holcim en 2021, s’est donné le défi de signer la trajectoire « Zéro Émission Nette », et se targue d’être le premier industriel mondial de matériaux à prendre de tels engagements. « Zéro Emission Nette » signifie que le groupe s’engage à réduire ses émissions à un niveau aussi proche que possible de zéro en 2050, les émissions restantes étant réabsorbées par les océans et les forêts par exemple.
Pour accomplir cet objectif en moins de deux décennies sans réduire le volume de production de ciment, les industriels se concentrent sur des solutions techniques : la réduction de l’utilisation des combustibles fossiles lors des phases de calcination, la diminution de la teneur en clinker du ciment sans compromettre les performances structurelles du béton, souvent désigné sous le terme de « béton vert » ou de « béton bas-carbone » et des technologies complexes en cours d’étude. Si la réduction de l’utilisation des combustibles fossiles semble relativement simple notamment en les remplaçant par de la biomasse ou en brûlant des déchets dont les villes et les incinérateurs veulent se débarrasser (pneus, farines animales, peintures usagées, etc.), les deux autres solutions sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre à grande échelle.
Les bétons « verts »
Afin d’atteindre le second objectif, il faut produire des bétons dits verts. Un béton vert c’est un béton fait à base d’un ciment très peu chargé en clinker, cette matière ultra carbonée qui sort du four. Il faut donc trouver d’autres substances de substitution, si possible allégées en carbone.
Pour ce faire il est nécessaire de se tourner vers les déchets ou coproduits d’autres industries : du laitier de hauts-fourneaux (sous-produits des aciéries résultant de l’élaboration de la fonte), des cendres volantes (déchets de centrales thermiques), du filler calcaire (farine de roche non-cuite) ou de la pouzzolane (roche volcanique basaltique). Or il se trouve que le laitier, le coproduit de remplacement le plus utilisé, est utilisé massivement par les entreprises du secteur en France et même en Allemagne depuis la fin du XIXe siècle, sûrement pas pour des raisons de calcul carbone, mais tout simplement pour des raisons économiques afin de valoriser un déchet d’une industrie vers un autre, tout en gardant les mêmes performances du matériau.
L’utilisation du laitier revêt aujourd’hui une tout autre fonction en faisant chuter artificiellement le bilan carbone des ciments : un vide juridique dans la réglementation européenne lui attribuait jusqu’à récemment un montant comptable quasi nul. Et le miracle opère : nous voici donc en présence de ciments et de bétons allégés en émissions. Précisons donc sans détour que ces laitiers, scories de fusion dont la production va inexorablement s’amenuiser à la suite de la fermeture des aciéries, ont été réévalués grâce à la recommandation de la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Paysage et se sont vu attribuer une nouvelle valeur carbone de 83 kg CO2eq/t, bien en deçà des estimations du bureau d’études expert en architecture Eliott qui les évaluait entre 150 et 500 kg CO2eq/t. La pression des cimentiers à ce sujet a donc probablement porté ses fruits.
Il serait donc plus approprié de parler de « bétons à carbone réduit » plutôt que de « bétons bas-carbone » pour ces gammes aux noms promettant des bénéfices écologiques et dont les pages internet ne lésinent pas sur le vert : Ecoplanet, Ecopact, Deca, Beton BIO…
En France, malgré des communiqués de presse annonçant des réductions de 30 à 100% (avec compensation carbone), ces produits ne rencontrent pas le succès escompté. En 2022, les gammes Ecopact du groupe Lafarge ne représentaient que 6% des volumes de ciment vendus. Selon la revue Nature qui consacrait un article à la décarbonation des industries du ciment et de l’acier, il faudrait au moins dix ans pour voir s’installer, en pratique, des ciments moins carbonés.
Il convient également de préciser que le béton réalisé à partir de granulats recyclés provenant de la démolition de structures en béton ne peut pas non plus être considéré comme un « béton bas-carbone ». En effet, bien qu’il permette de préserver les ressources naturelles extraites, il nécessite la même quantité de ciment pour lier ces agrégats recyclés, et n’affiche donc aucun bilan carbone réduit.
La promesse des argiles
La véritable nouveauté en termes de ciment bas-carbone, est la formule LC3 (Limestone Calcined Clay Cement) issue des travaux du laboratoire des matériaux de l’Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne – dirigé par la professeure Karen Scrivener. Le produit de substitution est ici l’argile (metakaolin) cuit à faible température (600° au lieu de 1450°), et la poudre calcaire non cuite. Cette combinaison permet de lier des bétons qui ont les mêmes performances mécaniques en divisant par deux les émissions par rapport à un ciment très chargé en clinker (CEM1).
En France, Holcim a commencé la production du LC3 dans une usine pionnière en 2023 à Saint-Pierre-la-Cour en Pays-de-Loire, à proximité de gisements de matière première, suivie par l’usine de La Malle dans les Bouches-du-Rhône. L’objectif initial était de produire 500 000 tonnes de ciment par an (3 % de la production totale française toutes entreprises confondues). Initiative unique en son genre en Europe, le projet a bénéficié du soutien financier du gouvernement français, dans le cadre du programme « France Relance » qui encourage les initiatives industrielles de décarbonation à grande échelle.
Outiller les usines pour passer à la fabrication d’une telle alternative ne semble cependant pas si facile et l’on ne trouve pas ces argiles sur tous les territoires. En Suisse par exemple, difficile de trouver du métakaolin, ce qui explique que la maison mère Holcim n’ait pas encore de solutions locales pour produire des ciments réellement réduits en carbone.
Secouer les géants du ciment
D’autres acteurs explorent des alternatives en s’engageant chacun dans la voie la plus verte possible. En Vendée, Hoffman Green propose une formule secrète brevetée qui active des matières sans recours aux fours et utilise uniquement l’électricité, réduisant ainsi l’impact carbone du ciment par cinq. Sa gamme la plus diffusée bénéficie également du faible bilan carbone du laitier. Cependant, le cimentier investit considérablement pour ne pas dépendre exclusivement de ce coproduit des aciéries et a développé le ciment H-EVA, composé aussi d’argiles peu cuites.
La présence de tels outsiders dans une industrie peu encline à l’innovation a provoqué des remous, incitant d’autres acteurs à rechercher des solutions plus vertueuses. Parmi eux, on peut citer la jeune startup Materrup, qui intègre des argiles crues dans ses mélanges et s’est récemment associée à Vicat, un autre cimentier. Descendante de Louis Vicat, l’un des inventeurs du ciment, cette entreprise collabore avec Materrup pour construire une nouvelle usine dans les Landes, qui soit capable de produire cette formule innovante.
Technosolutionnisme
En parallèle de ses recherches sur les bétons moins carbonés et de la communication verte qui les entoure, la feuille de route des cimentiers pour atteindre l’objectif du net zéro ressemble davantage à un mirage qu’à une cible réaliste à court terme. Les solutions explorées sont extrêmement complexes et coûteuses. Citons-en deux, présentées comme particulièrement prometteuses par les communiqués de presse des entreprises.
La première est le captage du CO2 à la sortie des cheminées des fours. Ce procédé consiste à capter les gaz émis par l’industrie, à isoler le CO2 des autres gaz (surtout de l’azote et de la vapeur d’eau), puis à le liquéfier. Une fois liquéfié, deux options sont à l’étude. La première consiste à transporter le CO2 liquide vers le Nord de l’Europe, où il serait réinjecté dans d’anciens puits de pétrole ou de gaz. La seconde option envisage la réinjection du CO2 sous terre, dans des aquifères salins.
Les scientifiques, dont un groupe de géophysiciens de l’Université de Lausanne (UNIL), s’accordent à dire que ce processus, qui n’est pas sans risque, nécessiterait des études géologiques préalables extrêmement précises. Dans le cas des aquifères salins, par exemple, la présence de CO2 modifierait la pression des sous-sols, ce qui pourrait provoquer des soulèvements de terrain, activer des failles et générer des microséismes, voire des explosions entraînant des fuites de gaz. Bien que présentée comme une solution miracle, aujourd’hui embryonnaire (seul 0,1% du CO2 des industries est aujourd’hui capté), le captage du CO2 nécessitera des investissements colossaux et sera difficilement réplicable à grande échelle, principalement en raison de son coût.
Les matériaux issus de fibres comme le bois stockent du carbone par le processus de photosynthèse tout au long de leur vie, et ceci même s’ils sont transformés en matériaux. En revanche, le béton ne se « re-carbonate » que très lentement en absorbant le CO2 de l’air au cours de son cycle de vie. Une autre méthode explorée consiste à capter le CO2 émis par d’autres industries, telles que celles produisant des biogaz, et à le transporter vers les industriels du béton. Ce CO2 est ensuite mis en contact avec des béton de démolition où il se transforme en calcaire en se liant à la surface des agrégats en quelques heures.
En France le projet Fastcarb planche sur cette solution qui séduit car elle s’attaque aussi au problème des déchets du béton en le transformant en ressource désormais utile. L’entreprise Neustrack, spécialisée dans la capture du carbone, s’est récemment associée à Holcim pour développer ce projet à grande échelle. Bien que les chiffres de stockage annoncés soient prometteurs, cette techno-solution qui prétend compenser 20% à 50% des émissions de la production de ciment par la re-carbonation des granulats recyclés demeure cependant très énergivore car elle demande de broyer finement les débris pour une meilleure absorption du CO2. Selon le même article de la revue Nature, cette méthode serait encore assez incertaine et encore moins facile à appliquer que la capture de CO2.
Consommer moins
Ces pistes industrielles embrassent une approche extrêmement technologique pour résoudre les problèmes d’émissions liées à la fabrication du ciment afin de maintenir les pratiques actuelles, sans jamais envisager une réelle réduction de la production. Lorsque les promesses communicationnelles optimistes, les procédés comptables avantageux et les géo-technologies sont écartés, l’utilisation raisonnée et parcimonieuse du béton et du ciment semble être aujourd’hui la seule véritable piste crédible en matière d’ambition carbone pour le « Bâtiment », afin sortir du « tout-béton ».
Quant aux infrastructures, en France, comme le souligne Nelo Magalhaes chercheur et auteur de Tracer des routes accumuler du béton[5], celles-ci consomment 80% du ciment et des ressources en granulat principalement pour l’entretien du réseau existant. On ouvre aujourd’hui de nouvelles carrières essentiellement pour réparer des routes. L’obsolescence de ce réseau est précipitée par la quantité de camions de 28 à 40 tonnes transportant des marchandises souvent non essentielles, dont on sait qu’ils sont responsables de ce vieillissement accéléré.
Le bâtiment fait piètre figure à côté du géant routier. La parcimonie ne sera ici pas suffisante et demandera des mesures beaucoup plus drastiques et donc politiques pour prolonger la durée de vie de nos routes, et nos ponts, et rêvons-le, la revalorisation du transport ferroviaire et fluvial, ou reconsidérer les principes du libre-échange.
NDLR – Alia Bengana est l’autrice, avec Claude Baechtold et Antoine Maréchal, de la bande-dessinée Béton. Enquête en sables mouvants publiée aux Presses de la Cité en avril 2024.
