Emprise scolaire : le grand vide politique
La « tradition républicaine » dont chacun, à droite et à gauche, se réclame en France, attribue à l’école une vocation de salut. Non seulement l’école doit instruire tous les enfants, mais elle doit former des citoyens adhérant aux valeurs des Lumières, de la liberté, de la solidarité, de la raison et du progrès. Elle doit aussi élever les compétences de chacun et favoriser la croissance.
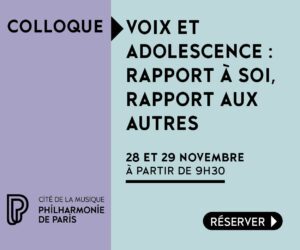
L’école est perçue comme le creuset de la nation et de la démocratie et il n’est pas un problème social dont elle ne devrait se saisir avec la multiplication des « éducations à » : à la tolérance, à l’égalité des sexes, à l’écologie, à l’empathie…
Aujourd’hui, l’école se heurte à mille difficultés et à un bilan critique ou désabusé sur son état. Les comparaisons internationales et les évaluations ministérielles elles-mêmes montrent obstinément que le niveau des élèves français n’est pas parmi les meilleurs, et que l’origine sociale détermine plus fortement les parcours des élèves que ce n’est le cas dans les pays comparables. L’éducation nationale a du mal à recruter de nouveaux enseignants et nombre d’enseignants disent que leur métier est de moins en moins reconnu et de plus en plus difficile, dans un climat scolaire dégradé.
Partout, mais plus encore en France, s’installe l’idée d’une crise de l’éducation. Paradoxalement, plus les diplômes sont indispensables, plus leur utilité paraît incertaine quand s’accentue la compétition pour accéder aux formations perçues comme les plus prestigieuses et les plus rentables. Bref, sans donner dans la nostalgie et le déclinisme, l’école française ne va pas très bien.
Le paradoxe vient de ce que la rencontre de la foi scolaire française et des constats critiques ou désabusés semble, aujourd’hui, n’engager aucun débat public et aucune politique à la hauteur des enjeux. Force est de constater que nous sommes entrés dans le temps des petites mesures et de l’impuissance politique. Au-delà des déclarations de principe convenues, les part
