Folie de (sur)vivre – Sur La Folie Elisa, de Gwenaëlle Aubry
Elles sont quatre, comme les quatre matriarches bibliques – Sarah, Rébecca, Rachel et Léa – mais celles-ci, dans le roman de Gwenaëlle Aubry, La Folie Elisa, seraient mères de quel nouveau monde à venir ? Pour l’instant porteuses d’un monde détruit, à moins qu’elles ne soient gardiennes de ses ruines. L’une d’entre elles, la seconde par ordre d’apparition, s’appelle justement Sarah, les autres Emy, Ariane, Irini. Emy est anglaise, musicienne de rock, Sarah est israélienne, danseuse, Ariane française et actrice, Irini, grecque et sculptrice. La musique, la danse, le théâtre, la sculpture. Incomplet cortège de muses, leurs disciplines sont de scène ou de représentation, comme si ce qu’elles devaient affronter ou combler tenait dans un manque de figuration possible dans le monde, une esthétique hors-service, une réalité devenue insaisissable par la sensation ou par le concept, débordant nos cadre sensibles et cognitifs, du « jamais vu, jamais entendu »/« pas vu, pas pris »/« ni vu, ni connu », un quotidien dissous dans un bad trip, un too much qui appellerait un excès narratif et rhétorique. Une folie. Elles ont toutes les quatre renoncé, fugué, quitté (une carrière, une famille), connu des amants, des douleurs, des folies et trouvent accueil dans une maison. Se sont données, ont tout donné puis sont parties. Ce livre raconte leur trajectoire : « Elles ne sont pas une invention : elles sont la vie » (page 83).
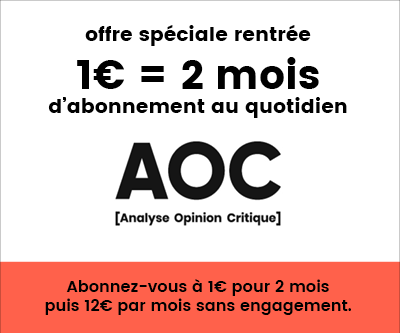
L’anglais de Walt Witman (souvent cité) et de Nirvana (cité une fois). Passer par l’anglais, passer par l’autre. Le débordement a pu se dire en français depuis le XIXe siècle (Baudelaire, Céline, Artaud) mais les six ou sept dernières décennies l’ont préféré en anglais. Si Jim Morrison ne jurait que par Rimbaud, l’inverse est sans doute vrai au paradis des maudits. Quoique la pierre tombale du chanteur des Doors affiche une inscription en grec ancien, Gwenaëlle Aubry qui est aussi philosophe et helléniste décide plutôt d’inviter l’anglais dans son texte, dans les cinq narrations. Cinq car aux quatre « filles de la fuite » (p. 139) se joint une autre voix, « L. », accueillant en somme le livre (prologue, épilogue et une intervention médiane) puisque celui-ci est conçu en suivant un protocole d’emboîtement dédoublé : les quatre narratrices qui prennent chacune une chambre dans la maison prennent aussi tour à tour la parole au sein du récit lyrique d’une personne occupant – ou possédant ? – la maison. La technique de l’alternance narrative est familière de Gwenaëlle Aubry qui en usa dans Personne (2009) et dans Partages (2012). Encadrer le chaos dicte une fonction majeure de la littérature, Kundera dixit.
En face des quatre fugueuses, donc, un « L. ». Une aile ? Une elle ? Comme dans Gwenaëlle ? Alors que la voix sonne féminine – Marguerite Duras mentionnée en 4ede couverture – mais que rien ne le confirme, la personne semble responsable de la maison où viennent se refugier ses « petites folles » (p. 83), ses « folles délogées » (p. 139). Une familiarité les lie puisqu’elles se confient totalement à L. Familiarité familiale qui en ferait ses filles ? Ou ses personnalités changeantes (« flanquées dans ma Folie », p. 15) ? Une folie baptisée « Elisa », entend le lecteur : ce serait la maison-cadre (et le récit-cadre), du nom d’un de ces bâtiments de plaisance que le XVIIIe construisait autour des grandes villes – voir chez Conrad La Folie Almayer, évidemment cité ; il pourrait aussi bien entendre la « folie d’Elisa », le délire d’une nommée Elisa, voire le nom attesté d’une maladie. Le lecteur entend beaucoup de choses dans ce livre qui l’entraîne et le perd à partir de ce titre au jeu allitératif étourdissant qu’aurait pu susurrer Gainsbourg.
Quoiqu’il en soit, c’est L. qui énonce le discours sur la folie – la folie et Lisa (L.) ? – au travers des parcours de ses visiteuses, L. qui joue de ses connotations, qui en décline les aspects, en répertorie les gestes. Le lecteur peut être dérangé, voire agacé par ces narrations successives à la première personne dans laquelle les quatre artistes exposent à fleur de peau leurs pérégrinations sans qu’entre impudeur et exhibitionnisme, franchise et narcissisme, la ligne ne soit tranchée, mais la mesure ne saurait ici être bonne conseillère. Érasme notait dans son Éloge que ce qui distingue le fou du sage, c’est que le fou est mené par ses passions tandis que le sage l’est par la raison. Ces folles-là sont des passionnées consumées par un désir fou. Ô folie, Ophélie. « Voici plus de mille ans que la triste Ophélie/ Passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir. / Voici plus de mille ans que sa douce folie/ Murmure sa romance à la brise du soir. » Bien sûr qu’elles sont rimbaldiennes, les quatre visiteuses.
Polyphonique, le livre de Gwenaëlle Aubry sacrifie également à la polytextualité, supportée typographiquement. Les sections « camera obscura » (chambres d’une luminosité autre dans la maison ou chambres noires pour la révélation de ce que l’on préfère invisible) rapportent en différentes fontes des citations de la presse ou du discours politique, toutes liées au drame migratoire et à la montée des extrêmes droites. En outre, un syntagme graphique, SMA, au lettrage spécifique et au statut d’acronyme, revient une petite dizaine de fois au cours des pages et des vies, recevant à chaque occurrence des interprétations diverses. Je l’ai lu « essaima » en pensant à la dissémination derridienne, débusquant un sens flottant et fuyant, en pensant aux chausse-trappes des œuvres de Borges et de Nabokov, concoction d’inévitable et d’indéterminé, sauf qu’il ne s’agit pas d’un art d’illusionniste dans lesquels ces deux-là passèrent maîtres mais d’un chaos cristallisé devenu matière des jours modernes, « l’architecture de notre fragilité » (p. 124).
Un appel à combattre toutes les exclusions, une convergence des luttes parce qu’une convergence des souffrances, La Folie Elisa s’en fait le prisme.
Tandis que le chemin des quatre femmes réunies par l’auteure croise parfois les mêmes hommes, il partage surtout la lueur funèbre de deux données tragico-historiques contemporaines : la terreur illustrée par la tuerie du Bataclan et la détresse du drame migratoire. Clairement et lucidement, le livre affirme la relation entre les deux*, en écho aux pulsions exterminatoires du nazisme, à l’encontre des malades mentaux comme des Juifs. « Massacre in Paris », Emmy décide de ne plus monter sur scène, de rester dans la fosse. Même si « l’Europe lave blanc » (p. 69), ses fosses sanglantes ne se referment pas. Aujourd’hui, elle joue une Lady Macbeth pour qui toute l’eau de la Méditerranée n’effacera pas les milliers de migrants engloutis. Cela peut rendre fou non moins que d’amener sur des chemins de gloire : la vaillante folie de Quichotte n’est-elle pas préférable à la lâche sagesse de Sancho ?
Et fous, les exilés qui prennent les chemins de l’exil lorsque ceux-ci sont des chemins de mort. Et fous en un autre sens : « […] l’étranger est en train de devenir notre fou d’aujourd’hui, celui que nous ne voulons plus connaître, reconnaître, celui dont nous altérons les traits pour ne plus avoir à nous lire dans son propre visage », écrit Guillaume Le Blanc dans Vaincre nos peurs et tendre la main (p. 27). Folie en un troisième sens que d’accepter l’étranger, au nom par exemple d’un engagement spirituel, la conscience enivrée d’un Bernanos par exemple, qui le poussait à dénoncer toute passivité des sociétés occidentales. On notera à cet égard que la publication du manifeste de Le Blanc est parrainée par trois organisations catholiques qui en recevront les droits d’auteur. Encore un manifeste en soutien des migrants, maugréera-t-on. Certes, il en est paru un certain nombre et la bonne/mauvaise conscience arborée à la boutonnière peut être matière à gausserie mais tant que la situation migratoire désastreuse perdurera, tous les efforts seront les bienvenus. « Mobilisons-nous contre la peur et affirmons que l’homme qui se cache dans ses cartons de fortune au fond d’un square [est] un autre homme au même titre que nous, avec lequel nous sommes connectés. » (p.104)
Un appel à combattre toutes les exclusions, une convergence des luttes parce qu’une convergence des souffrances, La Folie Elisa s’en fait le prisme. Irini donne l’exemple du fil barbelé qui, inventé aux États-Unis pour garder les troupeaux, enferma vite les Indiens, continua par enfermer les Juifs puis aujourd’hui les migrants (p. 71-72). Emblématique de cette continuité néfaste communément répandue, « asile », le pharmakon qui résume le mal contemporain en signifiant à la fois l’abri et l’enfermement. Gwenaëlle Aubry ne cesse d’en jouer les ambigüités, d’y revenir onomastiquement, depuis l’anagrammatique Elisa jusqu’à l’initialisation du prénom d’Ariane Sile (p. 3, jusqu’à un taggeur illuminé nommé Azyle (p. 79).
Dans La Folie Elisa, la haine est détournée dans le réalisme autobiographique des quatre artistes provisoirement échouées ou dans le lyrisme si tendre à leur égard de L. les accueillant dans sa F/folie.
« We can’t go home again » conclut le dernier des témoignages avant l’épilogue. Impossibilité de rentrer à la maison, valable pour les migrants et pour les quatre hétaïres, c’est-à-dire pour tout sujet victime ou conscient de la déréliction du monde. S’il est légitime de le dire pour les migrants chassés par la guerre et la misère, l’est-ce pour les autres ? Le livre pose la question et y répond par l’affirmative. Ne pas revenir, ne plus revenir. Le second énoncé grève le premier d’une précision mortifère. Et si c’était cela, la folie ? Avoir rencontré la mort et pourtant revenir, non pas à-la-maison, effacée par la fatalité, mais revenir parmi les vivants et survivre, vivre au-delà comme le dit l’allemand. « Des vies de rescapés. Nos survies n’étaient qu’intempéries et nous tanguions, nous tentions de naviguer sans chavirer a la moindre vague » (p. 94). Jeanphi, le jeune africain narrateur de Si loin de ma vie, de Monique Ilboudo, le constate sans aigreur, alors que sa route pour « ne pas rester couché où le hasard [l]’avait fait naître » (p. 33), comme le poulet de l’apologue, le fait passer par une longue séquence de turpitudes et d’humiliations, traçant un aller-retour qui passe par la Provence et le Brésil. Il mourra sous les coups d’une foule haineuse à Ouabany, sa ville natale, dans laquelle il vient de monter un centre d’accueil pour jeunes en difficulté et lancer le projet d’une « Marche pour la liberté de migrer ».
Dans La Folie Elisa, la haine est détournée dans le réalisme autobiographique des quatre artistes provisoirement échouées ou dans le lyrisme si tendre à leur égard de L. les accueillant dans sa F/folie. Elle éclabousse, en revanche, dans la sobriété des citations politiques ou journalistiques. Si une maison de feuilles ne pourrait tenir sous le vent de la haine, celle que construit Gwenaëlle Aubry résiste pourtant. Etonnamment car les récits sont de défaite ou de d’abandon – elles n’ont pas su « démonter la fabrique des monstres » (p. 111). Reste que les récits n’entérinent pas la faillite d’une quelconque fin du monde, ils la transfigurent dans le lexique du départ et de la traversée.
Michel Foucault a su mettre en lumière ce qui dans l’imaginaire de la Renaissance, continué au-delà par d’autres figurations, condamnait le fou à l’errance, au « Passage absolu » d’une pratique exilique sous la forme de la nef des fous qui fascinait au-delà de la peur : « [Le fou] est le Passager par excellence, c’est-à-dire le prisonnier du passage » (Histoire de la folie, 1972, p. 22). Le fou non seulement vagabonde mais il est assigné par la société au mouvement, confié à l’eau dans une volonté d’enfermement et de purification qui, en corolaire, lui donne une identité : « Il n’a sa vérité et sa patrie que dans cette étendue inféconde entre deux terres qui ne peuvent lui appartenir » (p. 22). L’exil trouve dans une folie ainsi régulée sa définition et les « runaway girls » (p. 15) leur abri.
Un refrain de résurrection trop lissé par les espérances nous repousserait. Il s’agit plutôt d’une litanie rituelle, pour repousser la peur. Si la littérature sert au moins à cela, elle est encore utile.
De « folie » à « feuille », la parenté étymologique est posée dès la deuxième page du roman, soulignée par un renvoi explicite, via l’exergue puis des allusions parsemées, au livre La maison des feuilles [The House of Leaves] de Marc Z. Danielewski, un des ouvrages les plus importants du début du XXIe siecle, l’inaugurant même puisque publié en 2000. Et serti à l’image du siècle : instable, opaque, inquiétant. Salué par la critique internationale, il n’a pourtant pas su trouver sa place au coté de Finnegans Wake ou de La vie mode d’emploi. Comparaison faite à ces deux ouvrages pour la prouesse littéraire (montage, collage, parodie, enchâssement, etc.) mais autant par un thème commun, à savoir : comment habiter ? Dans l’espace ou dans un texte, les deux étant similaires selon l’évangile postmoderne. Et Gwenaëlle Aubry prend au mot l’offre de Danielewski : prouver l’expansion infinie de la littérature sous la forme de l’expansion mystérieuse d’une maison, à l’intérieur labyrinthique d’elle-même, appelant le creusement, le forage, images récurrentes, vers l’inconnu d’un vide intime : « Leur volume intérieur est impressionnant, du dehors on ne pourrait le soupçonner. À mesure qu’on l’arpente, il va s’élargissant. Elles sont pleines de portes secrètes, de chambres noires, de cryptes, d’escaliers dérobés » (p. 83).
Habiter dans l’espace et le néant, dans le temps et le hors-temps. « Car toute maison est une maison des morts, mais aussi le lieu où ils cohabitent en paix avec les vivants […] » (p. 41). Quel que soit le degré d’hypertextualité, le roman américain doit au roman français la pleine signification de son titre, un livre comme une maison de feuilles : « […] à l’abri dans ma maison des feuilles, planquées dans ma Folie, bienvenue à vous […] » (p. 15).
De littérature, il est beaucoup question dans La Folie Elisa : Whitman, Rilke non nommé mais reconnaissable par sa hiérarchie des anges (p. 80), Koltès (p. 114), et surtout Claudel, sur l’amour (p. 33), Celan, sur l’errance (p. 56) – un Paul catholique (voir supra), un Paul juif. Le premier fait interner sa sœur, le second connut plusieurs internements. Asile, encore. Le livre de Gwenaëlle Aubry se termine sur une bannière agitée : « Vous avancez, hordes du grand dehors. Quelques pas encore et l’asile sera là, l’île ultime où vivre » (p. 141). Faut-il le croire ? Un refrain de résurrection trop lissé par les espérances nous repousserait. Il s’agit plutôt d’une litanie rituelle, pour repousser la peur. Si la littérature sert au moins à cela, elle est encore utile. Irini évoque les « figurines à la poitrine ouverte » (p. 38), des statuettes mexicaines en argile représentant un corps assis dont le buste s’ouvre sur une silhouette debout. Pour l’artiste grecque, son double à elle, en elle, s’est effondré. « Nous portons tous en nous une maison effondrée » (p. 46), conclut-elle. Encore faut-il le savoir pour ne pas fermer les yeux sur celles et ceux qui n’ont plus ni abri ni refuge, qu’ils viennent du dedans ou du dehors des frontières. « C’est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous », prévenait encore Erasme. La littérature nous apprend à ne pas le vouloir. Lisez La Folie Elisa.
Gwenaëlle Aubry, La Folie Elisa, Mercure de France, 2018.
Monique Ilboudo, Si loin de ma vie, Le Serpent à plumes, 2018.
Guillaume Le Blanc, Vaincre nos peurs et tendre la main, Flammarion, 2018.
