Gouverner, c’est pleurer ?
Le spectacle d’Emmanuel Macron laissant, selon l’expression consacrée, « éclater sa joie » lors de la victoire de la France en Coupe du monde invite à interroger les normes qui encadrent l’expressivité présidentielle, et plus généralement l’expressivité en politique. Les images de Moscou sont à rapprocher de celles, strictement inverses, qui ont ponctué les cérémonies les plus sombres des derniers mois : hommage aux victimes des attentats bien sûr, mais aussi cérémonie-hommage à Johnny Halliday et à Jean d’Ormesson. « Visiblement ému », « au bord des larmes » selon les observateurs, le président sut mettre en mots un chagrin qu’il disait partager et même ressentir au moment-même où il s’exprimait, mais qu’il parvenait à contenir : pas de larmes présidentielles, une retenue synonyme de « dignité », une émotion qui se déplace du corps vers le discours. Au regard de cette retenue typique des contextes fortement ritualisés, l’expressivité footballistique du président agitant les bras, sautillant sur son banc, ne tenant pas en place au point de suivre le match debout, interroge sur le droit aux émotions au sommet de l’État.
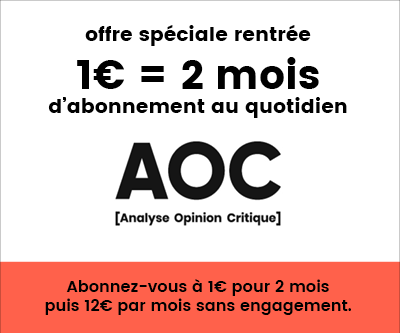
On peut défendre l’hypothèse, simple, selon laquelle le chef d’État, en contexte hyper-médiatisé, remplit une fonction de prescription émotionnelle qui enrichit la problématique classique de l’incarnation et de la représentativité. Il a pour obligation de définir un jeu serré d’émotions exemplaires qui participent du cadrage de la réalité : de quoi faut-il se réjouir ? s’indigner ? sourire ? Cette fonction de prescription émotionnelle s’appuie cependant davantage sur le discours que sur le corps : le chef d’État dit ce que chacun peut (doit ?) ressentir, mais lui-même se contrôle parfaitement.
L’histoire longue du second corps politique du roi, celui qui figure l’institution en sa majesté la plus noble, a sédimenté la figure du gouvernant parfaitement maître de ses émotions. Empruntant à l’idéal stoïcien et à l’idée qu’on doit se gouverner soi-même pour pouvoir prétendre gouverner les autres, le modèle du monarque impassible, de Louis XI à Louis XIV, est devenu un stéréotype qui imprègne aussi notre modernité politique (François Mitterrand en sphinx). Dignité de la fonction, sang-froid aristocratique, capacité à décider rationnellement sans se laisser gagner par les émotions, mais aussi capacité à ne rien laisser entrevoir de ses états d’âme pour toujours demeurer en position de force par rapport à l’interlocuteur… L’idéal contemporain du bon gouvernant a évacué les émotions, sur fond de valorisation unilatérale d’une Raison ou au moins d’une rationalité qui doivent beaucoup à l’imaginaire technocratique. Au regard de cet idéal, les émotions sont le contraire de la rationalité, elles contrarient le déploiement de celle-ci, elles doivent être reléguées dans des espaces seconds, infra-politiques. L’histoire des émotions ne dit pas autre chose, qui montre, après Max Weber et Norbert Elias, que le processus de rationalisation a contribué à bannir les émotions des espaces les plus nobles (les affaires, l’administration, les mondes professionnels en général et bien sûr le monde de l’État en particulier). Les émotions ont été reléguées dans des univers dominés : celui, domestique, des femmes et des enfants ; celui, pas davantage valorisé, des milieux populaires… Émotivité des femmes et des foules, émotivité des peuples colonisés… Le rapport aux émotions, selon ce modèle quasi victorien, est un indicateur de position sociale. On salue la noblesse du fonctionnaire capable d’user de sa seule raison pour administrer aussi froidement que possible, selon le modèle idéal-typique construit par Max Weber dans des pages célèbres. Mais on fustige dans le même temps les femmes esclaves d’une sensibilité qui leur interdit l’accès aux responsabilités.
La condamnation des émotions n’est certes pas totale. Si le modèle républicain traduit l’avènement d’un appareil d’État imprégné de rationalité bureaucratique, il n’ignore pas totalement les émotions. La devise républicaine, les valeurs républicaines, ne sont pas pure rationalité. Les héritiers de la Révolution française avaient fort bien compris qu’il n’était pas judicieux d’abandonner à leurs adversaires la sentimentalité romantique (martyr de Louis XVI et de Marie-Antoinette, restauration d’une monarchie devenue « sentimentale », légende napoléonienne…). La République devait aussi pleurer et rire, et ceux qui l’incarnaient allaient en appeler aux larmes et aux joies.
Un dispositif comme celui de la « minute de silence », suite aux attentats en particulier, illustre assez bien l’hypothèse formulée, à titre exploratoire, par Pierre Bourdieu, d’une stratégie étatique de monopolisation de la violence symbolique.
C’est dans ce contexte qu’on peut parler, s’agissant des gouvernants en général, d’exemplarité émotionnelle. Relayés par des dispositifs institutionnels, le gouvernant est habilité à convoquer les émotions, à en être le grand ordonnateur. Certes, le débat politique autorise les querelles à ce niveau aussi : ce qui indigne les uns réjouira les autres, ce qui déclenche la colère de l’opposition sera qualifié d’insignifiant par la majorité. Mais l’exécutif, parce qu’il détient un pouvoir d’incarnation que les médias ne feront qu’exacerber, peut prétendre à une position de surplomb qui apparaît particulièrement face à des événements exceptionnels : compassion face à une catastrophe naturelle, indignation face à un attentat, joie dans le cas précité d’une performance sportive exceptionnelle… C’est alors au chef d’État de dire l’émotion, de la guider, de la prescrire, d’en réguler l’intensité, d’en autoriser l’expression, au fil d’une rhétorique émotionnelle qui est toujours tendanciellement performative. Un dispositif comme celui de la “minute de silence”, suite aux attentats en particulier, illustre assez bien l’hypothèse formulée, à titre exploratoire, par Pierre Bourdieu, d’une stratégie étatique de monopolisation de la violence symbolique. Ce pouvoir de prescrire les émotions légitimes (et donc de sanctionner les émotions illégitimes, déplacées), n’est certes envisageable que face aux événements exceptionnels. Au quotidien, l’individu est libre de ses émotions, joies et peines relevant au demeurant davantage de la vie privée que de la vie publique. On doit malgré tout être attentif aux dispositifs visant à prescrire des émotions exemplaires, car elles sont un des ressorts d’affirmation de l’exécutif. On peut ainsi faire l’hypothèse que la représentativité démocratique, traditionnellement référée à l’ancrage socio-économique (« président des riches ? »), se double désormais d’une représentativité émotionnelle. La rhétorique sarkozyenne a de ce point de vue marqué un changement significatif : en jouant, lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, de la supposée universalité des réactions émotionnelles face à des crimes particulièrement odieux, il a banalisé la rhétorique émotionnelle. Le raisonnement est simple : je réagis comme vous, nous partageons les mêmes émotions, je puis donc vous comprendre infiniment mieux que ces énarques froids qui ont appris à taire leurs affects… Tient-on là une nouvelle définition de la représentation démocratique ?
Les professionnels de la politique doivent trouver un juste milieu entre expressivité brutale et froideur. Si le représentant démocratique doit savoir se tenir au-dessus de la mêlée et s’affranchir des pulsions émotionnelles qui parcourent les foules, il ne saurait pour autant offrir le profil glacial du fonctionnaire sans âme. Il doit, à mi-chemin de ces deux écueils, dire les émotions, être à leur écoute, les percevoir, les nommer, il peut affirmer les ressentir comme ceux qu’il représente, il peut même, en certaines circonstances exceptionnelles, laisser les émotions le gagner. Les linguistes travaillant sur les émotions nous incitent à bien distinguer l’émotion en tant que discours (elle a son lexique) de l’émotion en tant que force venant troubler le discours (incohérence de l’énonciation, silence, troubles, accélération du débit…). Les politiques se positionnent volontiers sur le premier terrain, usant d’une rhétorique émotionnelle qui permet d’exprimer la colère, l’enthousiasme, la compassion… Le second est moins valorisé qui laisse entendre un possible déficit de contrôle de soi. Car peut-on gouverner en étant le jouet de ses émotions ?
A mesure que les médias s’émancipent des logiques institutionnelles, préférant l’ironie et l’envers du décor aux façades pensées par les chargés de com’, le regard porté sur les écarts émotionnels devient de plus en plus compréhensif.
Le changement à l’oeuvre concerne précisément cette question. Conformément à une évolution observable à l’échelle de la société toute entière, l’expression plus franche des émotions est désormais tolérée. La palette des émotions revendiquées par les politiques s’est élargie. Les Mémoires de Guerre du général de Gaulle n’en connaissaient qu’une grammaire rudimentaire : espoir d’un avenir meilleur, joie face aux évolutions favorables la situation internationale, amertume face aux échecs. On en reste au strict terrain des émotions exemplaires (aucune émotion d’ordre privé n’est évoquée), et on en reste à une appréhension purement discursive des émotions (le général de Gaulle ne pleurera pas). Avec l’avènement de la télévision politique, le langage du corps s’impose progressivement : larmes du candidat Marcel Barbu en 1965, larmes attribuées à Simone Veil à la tribune de l’Assemblée nationale au moment du vote de la loi sur l’IVG, larmes du VGE sur un plateau de télévision face à Michel Rocard… Le petit écran consigne avec gourmandise ces écarts par rapport à la norme institutionnelle qui impose la retenue au sommet de l’État. D’abord pour s’en offusquer, comme s’il s’agissait-là d’écarts impardonnables ; ensuite pour s’en amuser, ces écarts démontrant au final que les politiques ne sont pas de bois, qu’ils peuvent eux aussi craquer.
Ce glissement est tout sauf insignifiant. A mesure que les médias s’émancipent des logiques institutionnelles, préférant l’ironie et l’envers du décor aux façades pensées par les chargés de com’, le regard porté sur les écarts émotionnels devient de plus en plus compréhensif. La logique médiatique, à la différence de la logique institutionnelle, ne condamne pas les écarts émotionnels. Elle opère à bien des égards un renversement du rapport aux émotions : à la télévision, le sang-froid et la retenue sont peu appréciés. La raideur institutionnelle est synonyme de langue-de-bois, de crispation, d’impersonnalité et d’insincérité. On attend des personnalités politiques qu’elles sortent des sentiers battus, qu’elles parlent vrai, qu’elles donnent à voir la sincérité. Cette injonction à l’authenticité démonétise l’émotion simplement dite au profit de l’émotion exprimée : l’humaine fragilité attestée par le surgissement des larmes peut se révéler médiatiquement efficace. Elle fera le bon client des talk-shows, l’invité imprévisible avec lequel, en direct et en gros plan, il peut se passer quelque chose. Mais cette disposition à l’authenticité est-elle politiquement porteuse ?
Au final, personne ne sait si l’image du président sautillant et agitant les bras doit être lue comme l’indice d’une toute-puissance de la communication ou comme la trace dérisoire d’une spontanéité dont le sport permettrait d’entretenir la nostalgie.
On serait tenté de répondre par l’affirmative en observant les stratégies des personnalités politiques. La campagne de 2007 a constitué de ce point de vue une rupture soulignée par nombre d’observateurs. La rhétorique émotionnelle a imprégné les discours de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal, rhétorique confortée par des postures corporelles affranchies des normes de retenue traditionnelles. Les émotions affichées débordent en outre les seules émotions exemplaires : le candidat prend bien sûr en charge les émotions du corps social (indignation, espérance…), mais il affiche aussi des émotions strictement personnelles. Au-delà des campagnes présidentielles, les joies et peines liées à la carrière politique ou même à la vie privée sont assumées au gré d’une communication intimiste avec l’électeur. Sur les blogs, sur les plateaux des talk-shows, dans les ouvrages qu’ils publient de plus en plus volontiers et dont la dimension autobiographique est de plus en plus manifeste, les émotions personnelles sont dites, même à contre-temps, même à rebours du dévouement politique. Ils font surgir des personnalités médiatiques qui gagnent en épaisseur et en complexité, conformément aux logiques standardisées de la visibilité médiatique contemporaine. Sans être systématique, la contre-exemplarité peut nourrir certaines présentations de soi : on dira son amitié pour un adversaire ou son inimitié pour le concurrent d’un même parti, on dira sa lassitude pour le jeu politique ou au contraire son ambition carriériste, on fera surgir des affects tabous (désir sexuel). Tout se passe comme si les politiques étaient désormais convaincus que l’expressivité émotionnelle était politiquement plus efficace que la raideur institutionnelle, ou au moins que la seconde ne devait pas étouffer la première. D’où des stratégies de présentation de soi qui dosent cette expressivité selon les contextes (plus ou moins institutionnels), les publics, les sollicitations. Mais qui toujours participent d’une certaine « féminisation de la vie politique » : Simone Veil dut jadis, face aux accusations machistes, déclarer qu’elle n’avait pas pleuré ; les énarques de la génération suivante, à qui personne ne déniait la qualité d’« hommes d’État » (Fabius, Juppé…) durent au contraire « fendre l’armure » pour mettre en scène leur fragilité émotionnelle. Le stigmate s’est-il retourné ?
Les commentateurs ne sont pas dupes de ces émotions affichées. La dénonciation institutionnelle des écarts a cédé la place à une herméneutique serrée des émotions : sont-elles sincères ? Ne sont-elles pas de pure stratégie ? La dénonciation des colères feintes et des larmes de crocodile est devenue une figure convenue du commentaire politique. Que penser des indignations de Jean-Luc Mélenchon ? Des larmes de Ségolène Royal ? De l’enthousiasme footballistique d’Emmanuel Macron ? Certains vont saluer la simplicité du président capable de laisser s’exprimer le fan de football ; d’autres vont dénoncer avec force la grossièreté d’une stratégie de communication qui flirte avec la récupération. Et au final, personne ne sait si l’image du président sautillant et agitant les bras doit être lue comme l’indice d’une toute-puissance de la communication ou comme la trace dérisoire d’une spontanéité dont le sport permettrait d’entretenir la nostalgie.
