Intimité et effondrement moral – sur La séparation de Sophia de Séguin
Rares sont les premiers textes édités tirés de journaux intimes ; c’est le cas de La séparation, récit d’un évènement aussi ordinaire que tragique : la rupture amoureuse. C’est à cet ébranlement terrible que Sophia de Séguin se confronte dans ce livre, avec lequel, d’une écriture très maîtrisée, elle en explore et en restitue la blessure.
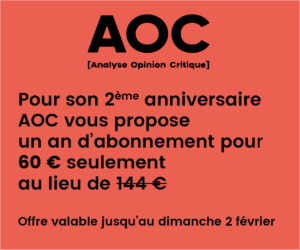
La séparation se donne à lire comme le journal fiévreux d’une personnalité elle-même brûlante. Tenu dans les mois qui suivent la rupture amoureuse, il relate la disparition progressive d’Adrien, qui fut passionnément aimé, et dont le nom ne cesse de hanter les pages. Cet Adrien-là laisse peu à peu la place à un Adrien bien réel, médiocre et défait des qualités et du charme que l’amour lui conférait. L’épreuve de l’amour qui s’en va, qui se trahit lui-même en s’éteignant est une peine banale. Mais la langue de Sophia de Séguin s’obstine à dire la vérité de ces moments, de ces jours, de ces semaines, de ces mois, qu’il faut consacrer à un deuil particulier, le deuil amoureux, qui est aussi celui d’un certain soi, de ce « je » que nous avons été avec l’autre.
Dans La séparation, c’est avec le lecteur que le « je » de l’auteure partage une intimité véritable. « Je n’ai jamais été “moi-même” avec Adrien […]. Je suis toujours restée inquiète et craintive, avec beaucoup de secrets et non moins de mensonges. » Cette intimité n’est à aucun moment l’occasion d’une quelconque lamentation – dont on se serait, de toute façon, bien passé. Non, elle est plutôt le refuge d’une écriture crue et sensuelle qui ouvre grand le champ du privé. Une écriture sûre de ses effets aussi, alors que le monde intérieur s’effondre et se reconfigure. Une écriture passagère, autant que le sont les amours : lorsque, enfin, Adrien n’est plus aimé, le texte s’effondre sur lui-même et prend fin. Comme la dernière pelletée de terre s’écrase sur une tombe, Sophia de Séguin referme son journal en ne voulant plus aimer. Ni Adrien, ni personne.
L’intimité
La séparation amoureuse n’est pas qu’un déchirement émotionnel ; une rupture s’incarne. Et la catastrophe est aussi organique que romantique. « C’est vrai que je suis amaigrie, des cernes violets et le cul me démange après vingt heures. » Si la forme du journal permet l’impudeur, il est plus rare que l’humour en anime les pages. La franchise et le cynisme de Sophia de Séguin sont pourtant très drôles. Des vers qui lui provoquent des démangeaisons mal placées le soir ? Le journal ne peut pas se passer d’une telle information ; il aurait été dommage de ne pas se voir rappeler par l’auteure que vingt heures, c’est « l’heure où ces dames sortent pondre ». La plaindre ou sourire ? Fidèle à elle-même, elle a choisi son camp : « L’idée d’abriter une petite faune, d’avoir mon élevage personnel, me fait sourire. » Et les choses sont simples, parfois. Il suffit de « prendre le cachet, et passer les draps à 90 degrés. Adieu, les vers. »
On ne se défait pas si facilement de l’inflammation émotionnelle qu’une rupture provoque, évidemment. « Il me manque, Adrien, il me manque beaucoup, souvent, mais cette douleur-là n’a rien à voir. C’est un tranchant de poignard, vif et précis. Parfois une angoisse, un regret de tel geste, tel moment, tel voyage qu’on n’a pas fait » Mais le corps n’est jamais bien loin, dans La séparation : « Ou alors j’aimerais bien qu’il me baise. »
Alors qu’on a tendance à se représenter la séparation comme une expérience qui pulvérise et laisse ses acteurs en mille morceaux, Sophia de Séguin rappelle ainsi qu’il n’en est rien ; le corps s’obstine, encombrant de ses petits maux quotidiens, de ses désirs médiocres, de solitude et de souffrance. Les gestes habituels et le quotidien sont une prison. « Ma cervelle est vide et fixe, et mes yeux dans le métro. ».
Albert Camus notait dans ses Carnets[1] que « le plus grand malheur n’est pas de ne pas être aimé mais de ne pas aimer ». Le désespoir de Sophia de Séguin est de cet ordre : « je comprends, et c’est une terreur, que je ne serai pas capable d’aimer toujours Adrien ». Le voilà, l’insupportable drame, l’insurmontable malheur : l’amour s’éteint. Ce n’est pas la fin d’un couple que l’autrice pleure, ni la fin d’une vie qu’elle projetait. Elle fait partie de ceux qui n’aiment plus, qui n’aiment pas.
La fièvre sensuelle et nerveuse du verbe retombée, il reste à s’interroger sur la stratégie de l’éditeur de présenter le texte comme arrivé par hasard dans ses bureaux, presque malgré son autrice. Mais derrière ces coquetteries d’un autre temps, le texte recèle un précieux témoignage, celui d’un « je » de femme, qui se livre avec la volonté d’une honnêteté absolue. En conséquence il exaspère parfois par son incapacité à n’écrire jamais que l’individuel, à penser l’ancrage social, pourtant prégnant mais jamais interrogé – l’amant se nomme Pierre-Étienne, les vieux copains sont ceux de « l’École » et on les retrouve dans les cafés à Odéon. C’est par un autre aspect que le texte séduit. Tout entier dans la tête de l’auteure, on s’amuse avec elle, on adhère à ses méchancetés et à ses bassesses, on déteste Adrien. Surtout, on suit partout la langue, qui s’entête et persévère, qui s’acharne, à dire et à survivre.
L’ambiguïté morale
Il reste néanmoins difficile de ne pas s’étonner qu’un récit de femme à la première personne s’accommode si bien de ce male gaze qui réduit les femmes à des objets de désir et de plaisir. La puissance d’affirmation que constitue l’écriture dans La séparation rencontre ainsi une étonnante normativité. Si le « je » et ses humeurs sont au centre du processus, la sexualité semble le lieu d’une dépossession de soi. Sophia de Séguin ne « baise » jamais mais est toujours « baisée » ; reste à savoir si c’est la raison pour laquelle, selon elle, les étreintes ne semblent avoir de valeur que partagées entre conjoints.
Quand il est question des autres femmes, la misogynie latente ne fait plus aucun doute. Comme lorsque la narratrice explique prendre plaisir à dévisager la beauté des femmes, dans les transports en commun, avant de préciser qu’il n’est question que de certaines femmes, et surtout pas « les mignonnes, les petites salopes, les apprêtées ». Elle a été de celles-là, elle s’en souvient : « mes cheveux emmêlés, mes collants filés sous la jupe, dans les bottes, la saleté au cœur, comme une petite salope, comme j’étais à dix-sept ans ». Avec ce souvenir revient celui du mépris des hommes du passé, et de celui du présent qui « a de quoi » la mépriser, elle a tout de même « couché avec lui complètement ivre, le premier soir ».
Sophia de Séguin laisse donc éclore ses réflexions sexistes avec la même honnêteté que les petites bassesses que sa colère lui inspire. Ce n’est pas à elle qu’on reprochera, comme à Rousseau dans ses Confessions, de se complaire à mettre en avant ses qualités morales. L’avertissement de l’éditeur qui précède le texte indique néanmoins que l’auteure a consenti à la publication en « précisant toutefois que ces pensées étaient partiales et, désormais, d’un autre monde ». On aimerait le croire.
Si la rupture amoureuse est un lieu commun de la littérature, nous sommes assaillis d’injonctions sociales à faire notre deuil, à avancer, à surmonter l’épreuve. Sophia de Séguin maintient une distance prudente et précieuse avec ces poncifs. Elle ne cherche aucunement à éviter la chute. Elle se laisse aller au manque, à la colère et à l’orgueil, dernier rempart contre le désespoir. C’est le sentiment aussi dérangeant que puissant qui jaillit de La séparation : l’orgueil et la colère conditionnent, pour un moment, la survie. La sincérité de ce jaillissement le fait luire de vérité.
La forme du journal apparaît ainsi comme le prétexte à un véritable exercice de style. Si la narratrice accepte de sombrer dans les dédales de son désespoir et de sa colère, son écriture, elle, conserve une rigueur exceptionnelle. Le lecteur n’est jamais pris à témoin, ni chargé d’aucun rôle que celui de comprendre que la cruauté a ses raisons… Et de se laisser impressionner par les réflexions de Sophia de Séguin, lorsqu’elle explique par exemple, en quelques mots, que l’Origine du Monde de Courbet est loin d’être un tableau obscène. Sa description rappelle qu’une jambe seulement du modèle est repliée, et l’autre allongée, et que ce qui se dévoile alors n’est qu’une toison pudique, un sexe fermé. On rejoint aussi ses évidences, que l’écoute prolongée d’un opéra, même du plus beau d’entre eux, finit par faire regretter le silence, ou encore que « Maupassant est vraiment d’une bêtise incurable ».
Sophia de Séguin, La séparation, Le Tripode, 192 pages.
