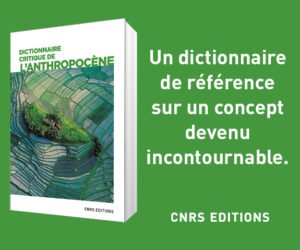Après la terreur – à propos de Homeland de Howard Gordon et Alex Gansa
Les séries n’entaillent pas le cours du temps ; elles font époque. Elles se glissent dans nos existences comme une habitude, et bientôt se trament à la réalité des jours et du monde. Soit, en effet, qu’elles prétendent n’avoir d’autre matériau que les aléas du quotidien (c’est la voie de la sitcom), soit qu’elles entendent nouer leurs intrigues à la marche de la politique nationale ou internationale. Plutôt que fidèles chroniqueuses, elles se risquent alors, afin d’être raccord avec le moment de leur diffusion, à des présents hypothétiques.
Pour sa sixième saison, dont le démarrage coïncida avec la prise de fonction du 45ème président des États-Unis, Homeland envisagea ainsi la victoire d’une femme démocrate. Loin de se décrédibiliser, la fiction trouva, dans cet écart par rapport à l’actualité, un détour pour figurer les forces réactionnaires et séditieuses agitant la société américaine, en même temps qu’elle suggérait une alternative à la rhétorique de Donald Trump.
À la fois frontales et obliques, de telles œuvres – en France, l’on citerait Le Bureau des légendes ou Baron noir – se nourrissent de leur environnement social et médiatique autant qu’elles l’informent. Aussi leur réussite se mesure moins à leur rigueur qu’à leur plasticité – ou, plus exactement, à la façon dont ce qui les structure (personnages, relations, motifs, scènes-clés…) peut accueillir les fluctuations du temps. En ce sens, la série est un filet lancé sur le contemporain.
Le « 11 Septembre » apparaît comme une origine, une blessure fondatrice à partir de laquelle s’est développé un rapport inquiet – voire paranoïaque – au monde
Entamée en octobre 2011, Homeland s’est achevée, après huit saisons et 96 épisodes, en avril 2020. La première date marque les dix ans de l’attaque coordonnée par Al-Qaïda contre le World Trade Center, le Pentagone et le Capitole[1] ; la seconde la signature d’un traité entre les États-Unis et les Talibans concernant le retrait des troupes de la coalition internationale d’Afghanistan.
Loin de dessiner la ligne d’une résolution, une telle trajectoire aura été intégrée à la série selon deux modalités principales : la répétition et l’involution. Homeland a débuté dans l’angoisse d’une nouvelle attaque. Alors que The Sopranos avait, après le 11 septembre 2001, retiré de son générique un plan sur les Twin Towers, la série créée par Howard Gordon et Alex Gansa ne cessera de revenir au moment de la chute. Un échange entre l’agent de la CIA Carrie Mathison et son collègue Saul Berenson enfoncera, épisode après épisode, le clou du traumatisme : « J’ai déjà raté quelque chose par le passé. Je ne referai pas la même erreur. – C’était il y a dix ans. Tout le monde a raté quelque chose ce jour-là. »
La fiction audiovisuelle américaine, films et séries confondus, noue alors un nouveau rapport aux événements. Après l’invisibilisation, le film-refuge (World Trade Center, 2006), l’allégorie (Cloverfield, 2008) et avant la fiction de résilience (The Walk, 2015), le « 11 Septembre » apparaît comme une origine, une blessure fondatrice à partir de laquelle s’est développé un rapport inquiet – voire paranoïaque – au monde[2].
Or, il faut y insister, en dépit de leur brutalité et de leur soudaineté, ces actes ne sont pas apparus nus sur les écrans de télévision qui en furent les principaux relais. Accompagnés de commentaires, d’analyses, de témoignages et de déclarations officielles, ils ont très vite été intégrés à une narration dont le générique de Homeland suggère la généalogie, sans toutefois que la série se prête plus avant à son examen.
Comme le relate l’historienne Carol Gluck, « le récit a évolué en fonction des titres que l’on pouvait voir à l’écran sur chaque chaîne. Les premiers “Attentats contre l’Amérique” et autres “Jour de terreur” se sont vite mués en “Guerre contre l’Amérique”, reprenant dans un premier temps les gros titres des journaux étrangers ; puis ce sont les mots du président Bush, le 14 septembre, qui ont été utilisés et, dès lors, on put lire sur CNN : “La Nouvelle guerre de l’Amérique”. »[3]
C’est bien cette idée d’une « Guerre contre le Terrorisme » qui, de Ronald Reagan à Barack Obama, irrigue les discours que Carrie entend à la télévision depuis son enfance, et auxquels elle s’efforce de répondre une fois adulte. L’événement a donc tout autant la force d’une rupture que d’une confirmation : il fait entrer dans la lutte sans fin de la justice contre l’injustice, de la liberté contre l’oppression, du Bien contre le Mal, une génération soudain dessillée par une violence qu’elle croyait lointaine.
Le récit héroïque déployé après le 11 Septembre ne suffit plus à justifier les morts « collatérales ».
C’est là que Homeland s’avère passionnante. Car, tout en épousant la hantise d’un personnage qui outrepasse, et de loin, le cadre juridique déjà peu contraignant défini par le PATRIOT Act, la série ne va cesser de lui opposer des points de résistance. En mettant à mal le profil-type des « terroristes », en nouant le désir puis l’amour à la traque, en réitérant l’échec à prévenir une attaque, en montrant enfin les conséquences dévastatrices de la politique étrangère américaine.
À cet égard, la quatrième saison va offrir une inflexion inattendue à un récit qui s’est d’abord développé sur le territoire national autour de la relation passionnelle entre Carrie et Nicholas Brody, soldat retenu prisonnier huit années en Irak, et dont le retour triomphal marque le début de la série. Nommée en Afghanistan, Carrie supervise les opérations contre Haissam Haqqani. Mais, plutôt que le chef des talibans, une frappe de drone décimera une famille réunie à l’occasion d’un mariage. Au moment de la vérification du nombre et de l’identité des victimes, un jeune homme fixe la caméra de l’armée qui, cachée dans le ciel, surplombe son malheur.
La distance et l’asymétrie – entre ceux qui regardent et ceux qui sont regardés, ceux qui dirigent le drone et ceux qui en subissent l’intrusion, ceux qui tuent et ceux qui meurent – est comme suturé par le croisement des regards entre le garçon et Carrie. Ce n’est certes pas la première fois que Homeland subvertit la logique opératoire des images de surveillance – c’est même l’un de ses motifs récurrents –, mais l’ébranlement est ici plus profond. L’écran ne présente plus des cibles, mais bel et bien des êtres qui ne sauraient être réduits à des données, des modèles, des profils, et dont l’histoire mérite d’être racontée, et ajointée à celle des États-Unis.
Au moment de conclure, quatre saisons plus tard, les scénaristes ramèneront Carrie à l’endroit de ce massacre. Elle découvre des enfants mutilés jouant dans les rues du village et, à la place de la maison bombardée, un alignement de pierres tombales. Si ces morts sont alors les siens, ce n’est plus uniquement parce qu’elle en porte la culpabilité ou le deuil, mais parce qu’elle en est concrètement responsable. Ce faisant, Homeland se décharge de l’iconographie chrétienne qui était la sienne durant la cinquième saison, pour renvoyer son personnage à ses décisions et à ses actes, mais aussi à la politique dont elle a été l’exécutrice.
L’horizon n’est plus celui de l’examen de conscience, du martyr ou de la rédemption, mais bien d’un renversement de perspective sur la « Guerre contre la Terreur ». Le récit héroïque déployé après le 11 Septembre ne suffit plus à justifier les morts « collatérales ». Censée ne fabriquer que de l’oubli, selon un mot fameux de Jean-Luc Godard, la télévision souffrirait plutôt ici d’hypermnésie. Espérant réveiller d’anciennes alliances, Carrie court au milieu des disparus – ce qu’annonçait déjà une très belle séquence de la cinquième saison, lorsqu’elle se retrouvait cernée par les portraits de ceux dont elle avait provoqué la mort.
Homeland entend toutefois dépasser cette hantise. Le geste est fort, qui associe à la tentative d’établir la paix, un commentaire transparent sur ce qui a entraîné la guerre. Le temps semble alors se scinder. D’un côté, une ligne de progression, où la diplomatie, la confiance et la bonne volonté se trouvent requises pour tenter de passer outre les blessures, les humiliations et les intérêts contraires ; de l’autre, une ligne d’involution, qui offre un implacable réquisitoire contre la politique de George W. Bush et de ses faucons.
En visite sur le terrain pour annoncer la signature d’un traité avec son homologue afghan, le président des États-Unis trouve la mort lors d’un déplacement en hélicoptère. Les premières images semblent incriminer une faction rebelle des talibans. Dans cette situation critique, le président par intérim, inexpérimenté et faible, sensible surtout aux arguments les plus simples, voit dans la menace d’une offensive armée contre Kaboul l’occasion d’asseoir son autorité.
Il est évident que, à travers l’exploitation d’un fragment visuel arraché à son contexte et l’engrenage d’un récit manichéen, la série cesse d’adresser les conséquences de la « Guerre contre la Terreur » pour en démonter les causes politiques, institutionnelles et imaginaires. Tandis que dans les couloirs de la Maison Blanche se chuchote à nouveau que « les États-Unis ne négocient pas avec les terroristes », Saul affirme que la guerre se préparant, mais aussi bien celle qu’il mène depuis près de vingt ans, est basée sur un mensonge. Cela, évidemment, pourra sembler une évidence. Mais ce sont les prémisses mêmes de la série qui se trouvent renversées, sa part d’impensé qui est, enfin, examinée.
Durant l’épilogue, Carrie apparaît dans son bureau. Ses murs sont couverts de coupures de presse. La vision est récurrente. À partir de la masse brute et désordonnée des faits, son travail aura toujours été de découvrir un motif, de construire du sens, et ce faisant d’établir les moyens d’agir. Se mêlent cette fois articles authentiques – concernant la militarisation de la CIA, les sites secrets d’emprisonnement et de torture, l’espionnage à grande échelle ou les révélations d’Edward Snowden – et personnages de fiction. Son corps, filmé de dos, l’intègre à ce réseau d’images et de mots. Et c’est bien ce corps, prostré, tressaillant, tiraillé si souvent par ses troubles bipolaires, qui aura été, pendant une décennie, un lieu d’élucidation du présent. Telle aura été l’une des grandes vertus de cette fiction, parfois trop naïve, parfois trop schématique, que de nous aider malgré tout à voir ce que nous avions – réellement – sous les yeux.