La disparue – sur Pour te ressembler de Christine Détrez
« Des livres sur la mort, il en paraît par dizaines tous les mois. Rien n’est plus commun. Le deuil oblige à dire. Auteur ou lecteur, on cherche des mots, car ils sont pour le disparu la seule obole pensable », notait il y a quelques années déjà Philippe Forest. La rentrée littéraire 2021 confirme à nouveau le diagnostic, de Premier sang d’Amélie Nothomb, mémoires imaginaires de son père décédé l’année dernière à Emmanuelle Lambert, qui revient elle aussi sur la mort de son père dans une épiphanie lumineuse, Le Garçon de mon père. Dans une société sans espoir eschatologique et sans promesse d’éternité, où l’on demande lors des obsèques aux parents et aux proches de raconter par des anecdotes la vie du défunt ou de lire un poème à défaut de liturgie religieuse, l’écriture vient communément accompagner le deuil, éterniser les noms, si ce n’est réactiver le pouvoir de résurrection originel des inscriptions et des formules magiques.
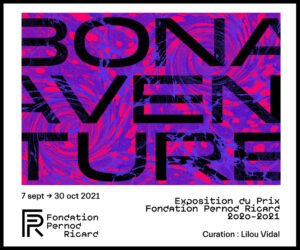
Pour te ressembler de Christine Détrez, enquête sur sa mère morte alors qu’elle avait deux ans, est l’un des originaux et des plus fervents de ces textes qui participent par-delà la mode contemporaine d’une très longue tradition. « Le tombeau, père de signes », disait Alain. De fait, la lecture de la formidable histoire du livre de Yann Sordet parue l’année dernière (Histoire du livre et de l’édition. Production et circulation, formes et mutations, aux éditions Albin Michel) confirme l’intuition du philosophe : il n’y a aucune fonction plus profondément associée à l’écriture que celle de la mémoire des morts.
« On retrouvera bien au-delà de la question même de l’origine des écritures cette articulation des pratiques scripturaires et de la mémoire des défunts. On écrit, selon des modes et des lieux définis, la mémoire des morts ; on détermine dans une société donnée quels défunts ont droit à une “mort écrite” : dans l’Athènes du Ve siècle av. J.-C., au temps du christianisme primitif et des ensevelissements clandestins, lorsque l’église devient lieu de sépulture, lorsqu’on met au point les livres des morts en contexte monastique, lorsqu’on développe la pratique des annonces nécrologiques dans la presse périodique du XIXe siècle… », note l’historien du livre, dont l’étude ne cesse de rappeler à quel point biographies, vies, et autres cénotaphes de mots ont été le moteur de l’économie du livre et souvent sa raison d’être.
Rien n’est aussi vrai à l’heure du posthumanisme : l’écriture historienne « exorcise la mort en l’introduisant dans son discours » disait Michel de Certeau et alors que la biographie officielle continue à officier au profit de la mémoire des grands, l’écriture littéraire prend en charge les mémoires familiales, propose généreusement l’éternité aux époux et aux parents, mais aussi aux sans-grade et laissés pour compte – c’est même toute la gloire de la littérature d’ajourd’hui que de donner, à la suite des Vies Minuscules de Pierre Michon, une place textuelle aux noms des « infâmes » prêts d’être oubliés.
Nourrie par des traditions littéraires différentes, l’expérimentation de W ou le souvenir d’enfance de Perec, l’exégèse pathétique de la photographie telle que l’a pratiqué Barthes dans La Chambre claire, la tradition juive du Zakhor, le livre de mémoire (pensons au très beau 209 rue Saint-Maur, Paris Xe. Autobiographie d’un immeuble de Ruth Zylberman), les livres de vie contemporains ont trouvé aussi, à côté des jeux romanesques sur les vies imaginaires, dans la « non-fiction » autobiographique dépouillée un modèle original et puissant, d’Adieu de Pierre Pachet à L’Enfant éternel de Philippe Forest. Le modèle de l’enquête dont Marie-Jeanne Zenetti a exhumé les sources dans la « factographie » et dont Laurent Demanze a montré la fécondité en est une forme privilégiée : il consiste à mettre en scène autant l’enquêteur et le processus de l’enquête que le résultat.
Modeste, vigilant à ne pas écraser par ses fantasmes la vérité d’une vie, l’enquêteur refuse ce que Philippe Forest nomme en mauvaise part « la nécromancie héroïque » et préfère la microhistoire lacunaire, la citation des éléments matériels et les puissances de la suggestion. Son geste croise celui du travail historien ou journalistique — pensons aux Disparus de David Mendelsohn, au très discuté Laëtitia ou la fin des hommes d’Ivan Jablonka, et, plus récemment, à la Mort d’un voyageur. Une contre-enquête de Didier Fassin ou à la belle méditation de Christophe Granger dans Joseph Kabris ou les possibilités d’une vie. 1780-1822.
Trouver les moyens de la « science impossible de l’être unique » comme disait Barthes : c’est bien à cette tradition que s’apparente le roman vrai de Christine Détrez, enquête sur une mère institutrice morte dans un accident de voiture en Tunisie et doublement invisibilisée par la modestie de ses origines sociales et par une mémoire familiale qui a vite tourné la page. Universitaire, habituée aux archives et aux entretiens, Christine Détrez restitue très professionnellement tout un moment de l’histoire de France, proche de celui évoqué par Annie Ernaux dans Les Années (« Le monde est grand, leur monde est vieux, et tout semble possible à ces jeunes du baby-boom ») et exhume tout le monde oublié des écoles normales d’instituteurs pour retrouver sa mère, tout en nous faisant ressentir toute l’épaisseur émotive de sa poignante quête, toute la densité et l’intensité de son geste.
Loin de faire taire les spectres, il s’agit de construire une relation aux morts, de se laisser instruire par eux.
Consciente de la difficulté, à laquelle s’était déjà confronté un Alain Corbin enquêtant sur l’obscur savetier Louis-François Pinagot dont il avait tiré le nom d’un registre, à faire « sortir de l’ombre » une femme sur laquelle « il n’y a presque rien à trouver, quasi rien à raconter », Christine Détrez déploie autant les ressources des méthodes archivistiques que l’enquête familiale, fouille Internet, va à la rencontre des témoins autant qu’à celle des images et des films qu’elle parvient à retrouver, toute « décidé[e] [qu’elle voulait] savoir, quelles qu’en fussent les conséquences ».
« L’aventure » mémorielle commence d’abord en effet par l’ego-histoire : pourquoi la narratrice a-t-elle attendu la cinquantaine pour s’intéresser vraiment à sa mère alors que, précisément, elle « écrivai [t] des livres et des articles, donnai [t] beaucoup de conférences sur le “genre”, et notamment sur les femmes invisibilisées, oubliées de l’histoire » ? Pourquoi à la place de sa propre mère, c’est la mémoire de Françoise Dorléac, elle-même morte très jeune dans un accident de voiture, qui occupe son imaginaire : « Je n’avais pas de photo de celle qui avait été ma mère avant Danielle [la seconde épouse de son père], mais je tapissais ma chambre de collégienne de photos des deux actrices » ?
Quel secret entraîne le silence de son père : « mon père avait décidé́ également de couper avec toute cette branche familiale, rien de mieux qu’un coup de hache dans l’arbre généalogique pour élaguer notre histoire » ? Même si des « failles, à plusieurs reprises, avaient fissuré le silence », pour « tendre la main » à sa mère de l’autre côté du temps, il faut d’abord s’interroger sur sa propre vie et sa propre maternité, en partant de l’oubli et de ses vérités.
Alors que d’autres dispositifs possibles auraient été possibles et au fond, symboliquement équivalents (« écrire un livre sans L, consonne de mon manque, consonne pour une mère absente, partie, évaporée »), Christine Détrez choisit par « déformation professionnelle » une enquête de non-fiction : « ceci n’est pas un roman. Depuis le début, le pacte est clair, je raconte mon enquête, et tout ce que j’écris est vrai. L’accident, le silence, les recherches, les trouvailles et les échecs. Les hasards, les coïncidences » explique la narratrice.
Mais l’évocation lyrique de la disparue complète la quête de faits, offrant au lecteur des passages de pure poésie : « Elle m’attendait, elle avait tout son temps, elle semait sur mon chemin des éclats d’émerveillement, des plumes comme des caresses pour attraper mes cauchemars, des élytres de scarabée mordoré, d’abeille bleu nuit ou des perles de rosée dans les toiles comme un éclat de ses bijoux, l’irisation métallique des libellules comme des barrettes à ses cheveux, la nacre délicate des coquillages comme du fard à ses paupières. ».
Nous sommes ici au cœur de cette complicité nouvelle entre le savoir historique, anthropologique ou sociologique et les écritures littéraires qui participe de la richesse de la création contemporaine et du brassage des discours. Face à l’énigme de l’altérité lorsqu’il s’agit de parler du monde vivant ou des autres cultures, face à la disparition et au passé, aucune ressource de la parole ne peut être exclue et surtout pas sa capacité à combler les silences. L’imaginaire supplée le manque, la rêverie nourrit le désir de connaissance : « Peut-être qu’à force de la regarder elle reprendra vie, dans une boucle des synapses de mon cerveau. À défaut de me souvenir, arriverai-je, enfin, à l’imaginer ? »
« Je n’avais qu’un désir, c’est que cet horrible accident fût transformé en beauté » : la citation d’Isabelle Duncan est en exergue de Pour te ressembler car le projet esthétique, loin d’écarter de la réalité, peut au contraire y conduire. « Les morts font de ceux qui restent des fabricateurs de récits » souligne Vinciane Despret dans le magnifique et séminal Au Bonheur des morts cité en exergue par Christine Détrez : nous savons la puissance d’anamnèse provoquée par la mort, qui appelle la parole et invite à l’écriture. Celui qui reste est non seulement invité, mais commis à témoigner et à enquêter, l’horizon étant la production d’un livre de mémoire plus inventif qu’une biographie et irréductible à la simple écriture du trauma. D’où la nécessité de la poésie, puissance d’actualisation maximale du langage. Comme Emmanuelle Lambert, qui refuse d’écrire autrement qu’au présent revécu et touche aussi au sublime du punctum barthésien, il s’agit de restituer au mort sa forme de vie, de la préserver en la réanimant, et non de s’en débarrasser en l’enterrant sous les mots.
Le récit assume ainsi à la fois l’échec de la nécromancie parfaite et son pari de dépasser le néant.
Pour reprendre le terme que Vinciane Despret emprunte au philosophe français des « modes d’existence », Étienne Souriau, il s’agit moins de reconstituer une vie achevée que d’« instaurer » l’existence des morts dans le présent, leur faire place, d’entendre ce qu’ils peuvent apprendre aux vivants. Loin de faire taire les spectres et de produire un détachement à travers un travail de deuil, il s’agit de construire une relation aux morts, de se laisser instruire par eux. « De celle qui a été effacée si longtemps, enfin on parle » note Christine Détrez.
Il faut savoir interpréter les signes, lire les images et « l’intraitable réalité » (Barthes, La Chambre claire) des photographies : « Car comment imaginer, à vingt-six ans, quand on est amoureuse, qu’on va bientôt mourir ? Dans ce regard, elle est déjà̀ ailleurs ». Il faut aussi retrouver l’autre en soi (« Elle était cet ailleurs dans mon regard sur les photos. Elle était le petit pigment brun dans mon iris droit »), autrement dit lancer le « ricochet incessant du jeu des ressemblances » comme manière de faire vivre la disparue : « je me penche sur cette photo comme sur un miroir. Je me penche sur cette photo, et c’est moi qui lui renvoie le visage de celle qu’elle aurait été si elle avait vieilli ». Car ce qui compte lorsque l’on vise à « instaurer » le mort, c’est de lui rendre autant son existence passée que sa vie possible : « Les pliures du papier lui font les rides qu’elle n’a jamais eues. Les pliures du papier sont les griffes de l’oubli auxquelles je veux l’arracher ».
« Une femme dont la responsabilité́ de l’existence désormais t’échoie » note la narratrice : prendre soin des morts, c’est leur rendre un passé, mais « construire, à rebours, la mémoire d’elle », c’est aussi offrir à sa mère un présent dans le tissu de sa propre vie « qui file », c’est faire rayonner son ombre dans toutes les directions du temps. C’est, comme le fit Ivan Jablonka dans l’Histoire des grands-parents que je n’ai eus, imaginer par des « si » les potentiels d’une vie. C’est ainsi que l’on peut rendre avec justesse ce que Giorgio Agamben nommait une « singularité quelconque » : « il n’y a là rien que de très ordinaire. Ce qui finalement rend la vie extraordinaire » dit précisément de sa mère Christine Détrez.
« Écrire est un travail modeste, un sauvetage inutile dans le désastre du temps : conserver l’épave d’un instant, d’un geste, d’un mot », note Philippe Forest à propos de ses propres édifices mémoriels. Comme Modiano dans l’inoubliable Dora Bruder, le récit assume ainsi à la fois l’échec de la nécromancie parfaite (« je n’ai pas trouvé ce que je cherchais, je ne sais sans doute pas plus qu’avant qui elle était. Son regard perçant sur les photos est resté une énigme » précise Christine Détrez) et son pari de dépasser le néant : « Je suis de l’autre côté du Styx, […] j’ai franchi le fleuve de l’oubli […] à la force de mes bras j’ai remonté le courant de cette rivière qui scintillait au pied des montagnes au profil de femme allongée. »
Prenant à l’appui l’exemple de Perrine Lamy-Quique enquêtant sur les cinquante-six enfants ensevelis en 1970 sous l’éboulement d’un sanatorium face au Mont-Blanc, force est de constater avec Pour te ressembler que l’on ne parvient que du bout des lèvres à « faire être ce qu’on a fait disparaître, contre le silence » ou, avec les mots de Rabelais, à « ramener les paroles dégelées » : la puissance d’instauration des hypothèses et des rêveries vaut toutes les sommes documentaires et leur volonté de « restauration de la vie intégrale » ambitionnée par Michelet.
Quels que soient les moyens de ces « sciences de l’être unique », elles contribuent bien à leur manière à « instaurer » le passé dans le présent, à faire ressembler les vivants aux morts et les morts aux vivants. « L’écriture est le souvenir de leur mort et l’affirmation de ma vie », on se souvient de la formule de Perec dans W ou le souvenir d’enfance. « Non tu n’es pas mort », chante Jacques Brel à son ami Jojo, reprenant une invocation aussi ancienne que celle de l’Ode funèbre de Bach (« Doch, Königin! du stirbest nicht ») – l’histoire de la culture considérée comme dispositif d’immortalité reste à faire.
Je ne sais pas si, dans cette histoire à écrire, l’immense richesse des enquêtes biographiques contemporaines dont participe pleinement Pour te ressembler, constitue sur la longue durée un fait culturel majeur. Mais je veux croire avoir entrevu quelque part entre les lignes de Christine Détrez le visage et toute l’importance d’un être unique « soufflant les akènes des pissenlits, faisant pleuvoir sur mes pas les pétales de cerisiers et les feuilles rousses de l’automne » et offrant « en guise de présents, des pierres en forme de cœur, même si aux cailloux elle préférait les morceaux de verre colorés dépolis par la mer ».
Christine Détrez, Pour te ressembler, Denoël, août 2021, 224 pages.
