L’inépuisable – sur Les Sources de Marie-Hélène Lafon
On ne sait pas à quoi il ressemble mais, très vite, on a envie qu’il crève. Ou plus exactement, on a envie que l’héroïne prenne ce qui lui tombe sous la main et en finisse, n’importe quoi, un fer à repasser, une masse dans la grange, un fil de fer pour étrangler, comme dans ce film d’Almodovar où une femme tue son mari macho avec un os de jambon.
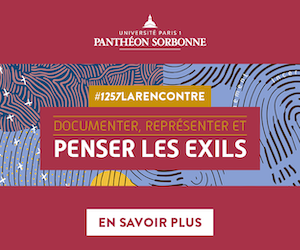
Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? était le titre. La femme des Sources se le demande aussi : pourquoi s’est-elle mariée avec cet homme, et puis pourquoi ensuite n’est-elle pas partie avec les enfants ? Elle en a trois depuis l’âge de vingt-six ans, deux filles, un garçon.
Le récit commence les « samedi 10 et dimanche 11 juin 1967 ». Un peu plus loin, dans une deuxième partie intitulée « Dimanche 19 mai 1974 », l’homme n’est pas mort et il se morfond : « Il avait fallu que ça tombe sur lui, une femme molle et nulle, nulle en tout. » Giscard d’Estaing vient d’être élu président.
Elle, qui n’a pas de nom (lui s’appelle Pierre), n’est pas partie parce que ça ne se fait pas, parce que sa mère lui dit qu’elle doit tenir son rang, patronne de ferme, ce n’est pas rien : « trois enfants, trois prénoms, trente-trois hectares, trente ans ». Le personnage du mari n’a encore rien dit, rien fait, on n’a rien vu, c’est un chapeau sur un banc comme Bouvard et Pécuchet (première phrase : « Il dort sur le banc ») et pourtant on le hait affreusement, puisqu’on ne le connaît qu’à travers la répugnance qu’il inflige à l’héroïne : « elle se dégoûte, il la dégoûte, il est pire qu’une bête, les bêtes ne sont pas méchantes, les bêtes ne parlent pas pour dire des mots qui sont pires que les coups. »
Jusqu’à ce que s’énonce ce reproche, on n’a qu’une idée très vague (et d’autant plus inquiétante) du mal que cet homme cause à cette femme. On sait qu’« il ne faut pas faire de bruit quand il dort sur le banc », que quelque chose « est arrivé dès le début, aussitôt après le mariage », que les sœurs de l’héroïne préfèrent ne plus venir à la ferme, que les bonnes et le commis ont « beaucoup vu et presque tout entendu ».
Mais quoi ? Ce n’est justement pas dicible, pas pensable peut-être précisément : « Elle a des mots, maintenant, pas beaucoup, deux ou trois, ça suffit », lit-on page 18, « depuis toutes ces années elle a trouvé des mots pour se parler à elle, dans sa peau, de ce qui lui arrive » mais cela n’est jamais tout à fait acquis, puisqu’à la page 51 : « elle ne trouve pas tout à fait les mots ».
On comprend au moins qu’il est question de viol conjugal, que la femme même enceinte subit l’homme tournant « autour d’elle, surtout les nuits dans le lit où il fallait encore servir et le laisser faire ». Si l’on ne saisit pas tout de suite quel est le problème, évidemment, c’est certes parce que Lafon raconte une conscience féminine dressée à l’obéissance et craignant le qu’en-dira-t-on. Mais cela ne serait rien sans son art de donner corps au déni par la langue.
Les mots de la pensée sont feutrés : l’héroïne, par exemple, ne se dit pas qu’elle a « supprimé » ou « euthanasié » des chatons. Elle se dit qu’« elle a fait le nécessaire ». Les actions ne s’agissent pas, elles s’imposent de l’extérieur du sujet : « Elle attendait, comme les autres filles de son âge, que son fiancé ait fini le service. » On vit le nécessaire.
C’est une autre époque, et comme toujours chez Lafon, presque un autre monde, celui de la vallée de la Santoire au milieu des volcans, dans le Cantal. Là, les chiens ont des noms de naphtaline, ils s’appellent Popof, et les chiennes Belle. Tout le monde vit ensemble, enfermé dans une même propriété, les ouvriers dorment dans « la chambre des hommes » au-dessus de celle des patrons. On commence à avoir idée qu’on vit dans un « trou », qu’on est « les derniers Indiens », comme l’écrivaine a intitulé l’un de ses récits en 2008.
Dans un entretien qu’elle accordait en 2021 à AOC, Marie-Hélène Lafon décrivait sa famille à l’égal de celles de ses récits : « L’insularité est définitive, elle est organiquement induite par la topographie de la ferme : maison et corps de bâtiments agricoles, seuls au milieu de trente-trois hectares. Il n’y a pas d’école maternelle, je ne connais que mon frère et ma sœur, on n’a pas de cousins et nos parents sont des gens peu socialisés. »
Dire que cet homme est vide serait injuste. Comme la majorité des mâles, il pense à des choses simples : manger, baiser.
Pendant quelques pages, on peut penser que c’est moins l’acte sexuel avec cet homme que ses conséquences qui mine la femme : « Elle ne sait pas ce qu’elle est devenue, elle est perdue dans les replis de son ventre couturé, haché par les cicatrices des trois césariennes. Ses bras, ses cuisses, ses mollets, et le reste. Saccagé. » La pilule contraceptive ne sera légalisée qu’en décembre 1967. Le médecin de famille lui a proposé « une ligature des trompes » sans qu’elle demande rien, mais à l’instigation de sa mère, pour être « tranquille ». Sauf que « jamais elle n’est tout à fait tranquille » avec cet homme.
Les mots du mal émergent peu à peu. La première fois, de façon ambiguë : elle « secoue la tête pour ne pas penser à ces six premiers mois de son mariage, de janvier à juin 1960, où elle habitait Soulages. Elle se souvient et ça cogne de tous les côtés. Elle a été enceinte tout de suite ». Parfois les souvenirs cognent, en effet, migraine, « ça » neutre. Il faut encore sept pages pour que la chose soit clairement exprimée : « C’est vrai, il a raison, un tas, elle est devenue un tas. Un gros tas. Il cogne dedans, dans les jambes, dans le ventre. » Beaucoup plus de temps encore pour qu’on aperçoive « un gros bleu sur le mollet gauche, les autres sont cachés sous la jupe qui lui serre le ventre. »
Mais donc, elle ne tue pas son mari. Mieux, même, après nous avoir mené à un paroxysme d’abjection (« elle sent mauvais, il a raison, elle pue »), au second jour de ce week-end de juin 1967, le dimanche, Marie-Hélène Lafon fait retomber la tension, ou plutôt renverse la pression. Cette femme a quelques issues de secours. Par exemple, elle a le permis : « ici, les autres femmes de paysans ne conduisent pas encore et elle se sent fière ». Elle peut (ou pourrait, on ne sait pas) critiquer son mari quand c’est lui qui prend le volant et conduit trop vite pour lui faire peur, et aux enfants : « on croirait qu’il le cherche, qu’il le fait exprès ; et en plus il bousillera l’Ami 6 ; il aura tout gagné ».
Lui aussi pue, finalement, à bien y réfléchir : « l’odeur mentholée de son après-rasage lui soulève le coeur ». Elle commence à questionner ses mots à lui, la façon dont il l’humilie ainsi que leur jeune fils, déjà accusé à quatre ans de ne pas être un vrai homme, de devenir un « pauvre type ». Elle n’est pas loin de formuler la différence culturelle des genres : « Les hommes ont de la chance, ils ont moins d’ennuis que les femmes avec le corps. » Nous, on le sait depuis le début, puisque « Pierre » n’a pas de corps dans le roman. Seul celui de la femme est supposé être problématique.
Qu’on se rassure, malgré la proximité de Mai 68, l’héroïne ne part pas dans une communauté hippie avec ses enfants. Elle ne fume pas de drogue, ne fait pas la révolution. En réalité, la situation de patronne de ferme lui plaît assez, une certaine idée de la richesse, du bien-être petit-bourgeois : « Si on était des gens normaux, comme tout le monde, on aurait une salle à manger, là, dans cette belle pièce. » Il aurait juste fallu que ce ne soit pas lui, cet homme, qui soit son mari. Pourvu que les employés aient assez à manger et à l’heure, les vaches seraient bien gardées.
Le livre aurait dû s’arrêter là, mais Pascale Gautier, l’éditrice de Marie-Hélène Lafon, lui a suggéré d’ajouter une plongée dans l’esprit du mari. C’est la deuxième partie du texte. On est en eaux peu profondes, comme on l’imagine. Dire que cet homme est vide serait injuste. Comme la majorité des mâles, il pense à des choses simples : manger, baiser.
Ce n’est peut-être pas tout à fait une pensée d’ailleurs, plutôt un ressenti sans mots, comme quand une amibe se rétracte sous l’effet d’un stimulus. Parfois les amibes peuvent phagocyter d’autres cellules : « Ce qu’il préfère, quand les filles sont là, c’est le dimanche matin ; elles lui lavent le dos, l’une ou l’autre, à tour de rôle, ça arrive deux fois par an. Ils sont seuls dans la cuisine, un peu avant dix heures. Il prépare un premier gant bien chaud et savonné sur le bord de l’évier, à gauche, et un deuxième, à droite, très chaud aussi, mais sans savon, pour rincer. Elles descendent, remontent, plusieurs fois, de la nuque aux reins, sans mouiller la bande élastique du slip kangourou. »
Cette scène d’inceste ou d’oignement était dans une des nouvelles de Liturgie (2002), le deuxième livre publié de Marie-Hélène Lafon. Moyennant quoi celui que nous avons entre les mains s’intitule Les Sources, sans être pour autant plus autobiographique que les autres : plutôt une histoire de l’humanité à travers des gens que l’autrice connaît bien. Une des deux filles du couple, nommée à la première page, Claire, vient congédier la maison familiale à la toute fin, après la mort des parents et juste avant de vendre ladite maison : « Elle ne ferme pas les yeux, la lumière est douce. » Auparavant, elle s’est adossée à l’érable de la cour où, enfant, sa sœur montait se réfugier.
Comme elle n’a pas fait Mai 68, Claire ne pense pas à l’idée de « rhizome » : « Elle préfère le mot source au mot racine. » Ce serait une même notion d’entrelacs, de ramifications pourtant, sans forcément d’origine ou de terminaison. Avec cette différence que si la « racine » ancre et s’étend, part à la recherche de nourriture et d’eau, la « source » quant à elle en procure, dans un mouvement inverse.
Dans le même entretien que cité plus haut, Marie-Hélène Lafon résumait ainsi la question : « Au fond, il y a une sorte de capillarité organique entre ce qui fait mourir, ce dont on meurt longuement, ce qui fait vivre, ce qui fait se tenir debout et ce dont, moi, je fais matière à écriture… […] Je me tiens là aussi, dans ce flux-là. » Dans ce flux de la source, on pense au verbe « puiser », issu du mot « puissouer, espèce de filet de pêche » : un instrument à trous pour écoper une chose infinie.
Marie-Hélène Lafon, Les Sources, Buchet-Chastel, 128 pages, janvier 2023.
