Tout n’est que vanité – sur Asteroid City de Wes Anderson
La critique, notamment française, semble s’être lassée des films de Wes Anderson, quitte à le rejeter depuis The French Dispatch. L’appétence du cinéaste pour faire de ses mises en scène un jeu de train électrique dont il contrôle jalousement chaque détail a pu paraître comme une impasse, et cet exercice ludique qui rejoue à chaque nouvel opus des dispositifs complexes de récit enchâssés, de décors obsessionnellement reconstitués et de systèmes de mouvements de caméra proches de l’horlogerie, comme une coquille.
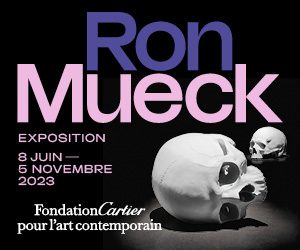
On a souvent reproché à cette mécanique répétitive et à la monotonie de son faux rythme de tourner à vide. Rien de tel dans Asteroid City qui fait de son carnaval de stars internationales une danse macabre tragi-comique.
Le goût du divertissement
Il y a dans Asteroid City précisément un goût du divertissement, mais au sens le plus fort du terme, dans son acception pascalienne : « tout le malheur de l’homme vient de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre ». Si le réalisateur construit avec chaque film ces maisons de poupées dont il maîtrise chaque élément, c’est donc pour se détourner de l’idée de sa propre fin et donc finitude. L’hystérie de son cinéma et de ses personnages a toujours masqué une profonde mélancolie. Mais ce motif n’aura jamais été si actuel que dans Asteroid City, film sur le deuil qui n’a de cesse de s’agiter pour ne pas affronter son sujet principal : la peur de la mort, le manque, l’infini. Le créateur insuffle à sa galerie de personnages son propre aveuglement métaphysique : tous se rencontrent dans une ville fictive du désert à la lisière du Nevada et de l’Arizona pour y observer des phénomènes astronomiques. En l’année 1955, la petite ville, célèbre pour avoir été le point d’atterrissage d’une météorite 6 000 ans plus tôt, attire des adolescents surdoués passionnés d’astronomie et alléchés par la bourse qui s’offrira à celui d’entre eux qui aura livré l’invention la plus utile.
Ces space cadets et leurs parents se concentrent sur l’observation de la voûte infinie, oubliant leur condition qui, elle, ne l’est pas. Dans le ciel, on ne trouve pourtant pas que des étoiles. C’est aussi le champignon d’essais atomiques qui matérialise de son panache blanc la distance qui sépare la terre du ciel. Une photo de cette fumée radioactive se trouve épinglée à côté du portrait d’un autre type d’étoile que celles qui intéressent les génies en herbe : Midge Campbell, étoile de cinéma incarnée par Scarlett Johannson, est une bombe atomique au même titre que l’explosif lancé dans le désert, clin d’œil à la silhouette de Rita Hayworth collée sur la carlingue d’Enola Gay pour insuffler de la chance aux pilotes chargés de bombarder le Japon. Tout le film cherche à penser ce trajet du regard, des objets, des corps dans un sens et dans l’autre, de la terre au cosmos et vice versa.
Oraison funèbre
« Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face » : Wes Anderson reprend à son compte cette maxime de La Rochefoucault en détournant son scénario de son cœur fictionnel – la mort récente de l’épouse d’Augie Steenbeck que le père endeuillé ne trouve pas la force d’avouer à leurs quatre enfants – et en dirigeant vers le ciel les regards de toute sa petite société réunie pour quelques heures. Les yeux farouchement tournés vers le ciel, chacun y oublie l’espace d’un instant la douleur du deuil plus ou moins récent, intime ou collectif, auquel il fait face. Le phénomène rarissime que viennent observer les cadets de l’espace dont fait partie le génial fils de Steenbeck, surnommé Brainiac, ne peut justement se regarder en face sous peine de voir s’inscrire la lumière stellaire directement sur la rétine de l’observateur. Les astronomes amateurs se couvrent donc les yeux avec des boîtes en carton (dont l’un des enfants ne voit que l’agrafe à l’arrière de la boîte au lieu de percevoir l’infini) : fabriquer une image drolatique et prosaïque pour illustrer une idée métaphysique.
La profession d’Augie le destinait pourtant à faire face à la violence de la mort puisqu’il est photographe de guerre. Midge, elle, mère célibataire d’une prodige des sciences, se prépare à un rôle prochain selon une méthode proche de Stanislavski et met en scène la mort de son futur personnage pour mieux s’imprégner. Dans sa baignoire, elle prend la pose, inanimée, le bras ballant, telle Marat. Saisir la mort pour de vrai ou l’interpréter pour de faux : Augie et Midge, deux faces d’une même médaille, étaient voués à se rencontrer.
Chaque personnage nourrit un rapport intime à la disparition, comme la scientifique qui dirige le stage d’astronomie et qui confie à l’un des jeunes que sa mère lui a manqué chaque jour depuis sa disparition quarante ans plus tôt. Cette confession dans la bouche de Tilda Swinton qui a incarné dans Eternal Daughter de Joanna Hogg le double rôle d’une fille et de sa mère fantôme fait frissonner tant Asteroid City propose une lecture du deuil maternel aux antipodes de celle de la cinéaste britannique tout en gardant en son cœur le même sentiment brut. Ce trou béant laissé par la météorite est comme l’éléphant dans la pièce : il est cette chose si évidente mais inconvenante dont il convient de ne pas parler. Au sens propre : puisque Augie n’a jamais réussi à annoncer à ses enfants que leur mère était décédée. Il finit par s’y résoudre en déplorant que leur jeune âge les empêche d’avoir la moindre notion fiable de temporalité. Les récits qui s’enchâssent de façon complexe les uns dans les autres mettent en perspective des mesures de temps différentes, confrontant chacun à sa place dans l’univers.
Les lois de l’hospitalité
Ce divertissement vient prendre corps dans la forme même du récit qui met en abyme sa propre fabrication. Le cinéaste dandy prend dans chacun de ses films un plaisir d’homme de bonnes manières à mettre les formes pour accueillir son spectateur dans le petit théâtre qu’il a concocté spécialement pour lui. Un maître loyal nous accueille ici, dans le décor nu d’une scène de théâtre en noir et blanc, pour nous présenter la pièce qu’écrit le dramaturge Conrad Earp (Edward Norton) et que nous reconnaîtrons comme étant le film auquel nous assistons. Wes Anderson a toujours eu ce plaisir du récit qui le conduit à exhiber les coutures de ses histoires. Dans Asteroid City, les sujets graves sont sans cesse ramenés à leur nature fictionnelle, hypothétique, inventée. Devant cette accumulation de précautions oratoires, on ne peut s’empêcher que le récit émane au contraire d’une émotion parfaitement intime du deuil et d’une angoisse toute personnelle de la fin du monde. Le degré de réflexivité s’emboîte dans la performance de Scarlett Johansson jouant une actrice au travail autant que dans une séquence où le dramaturge prend conseil auprès d’un prof de théâtre très stanislavskien et de ses élèves pour travailler sur scène la distinction entre le sommeil et la mort.
Le récit et ses coulisses
Les prologues en sont toujours des chants de bienvenue en même temps qu’un manuel d’utilisation qui livre les clés du récit. Mais il faut y voir plus ici qu’une simple afféterie ou qu’un clin d’œil de l’autre côté de l’écran. La réflexivité du récit vient cogner contre la nécessité humaine de se raconter des histoires pour ne pas voir la mort en face. Aucun nombrilisme dans ce geste, mais plutôt une réflexion sur la place de l’art qui lorgnerait vers les essais de Jean-Luc Godard tel Scénario du film Passion, cinéaste adoré par Anderson, qui commente le travail à l’œuvre. Augie, contrarié de ne pas comprendre une action de son personnage, sort du décor de la ville désertique pour franchir les bords de l’histoire et aller consulter l’auteur. Il traverse à toute allure les studios d’enregistrement, exactement comme le fait, hasard des idées qui circulent inconsciemment d’un cinéaste à l’autre, le protagoniste des Herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan qui, au moment clé de l’intrigue, s’extrait du monde du film pour venir regarder, via le truchement d’un miroir, le spectateur en face. Augie ne trouve pas son créateur, mais en ouvrant une ultime porte, il se trouve face à face avec l’actrice qui devait jouer sa femme dans une scène de science-fiction dont on déplore qu’elle ait été coupée, car le couple y apprenait rien de moins que les secrets de l’univers de la bouche d’un alien. Cette rencontre avec le fantôme de sa femme est le moment le plus doux et le plus émouvant du film, celui qui donne à toute l’agitation qui l’a précédé toute sa vanité.
Le mouvement irrépressible qui entraîne le personnage au-delà du décor, dans les coulisses du monde fictionnel, emprunte directement au cartoon burlesque auquel Wes Anderson rend un hommage plus appuyé qu’à son habitude avec la présence d’un petit oiseau numérique qui ouvre et clôt l’aventure du désert en criant Bip bip. L’allusion à la créature trompe la mort de Chuck Jones résonne notamment dans l’attitude trompe la mort d’un adolescent qui s’auto-défie sans cesse de sauter dans un cactus ou du toit d’un immeuble, expliquant que c’est en se confrontant sans cesse au danger fatal qu’il parvient à être certain de sa propre existence. Mais le désert fantasmé de l’ouest américain n’est pas uniquement le lieu où Coyote éprouve des accidents décisifs chaque jour, pourtant inlassablement répétés. Il est aussi le lieu auquel on accède par le chemin de fer, le lieu de la conquête brutale d’un Ouest au mépris de ses occupants séculaires.
Lorsque la population passagère d’Asteroid City se voit confinée pour conserver le secret de la visite extraterrestre à laquelle elle a assisté, le stage d’astronomie devient un Rio Bravo qui voit se croiser un militaire Amérindien plus qu’assimilé et un cow-boy qui entonne des quadrilles à la guitare. Le folklore du western vient questionner en pointillés le sang versé sur cette terre rouge des siècles plus tôt tout autant que la question de la spoliation des terres. Les trois semaines au cours desquelles Augie a tu à ses enfants la disparition de leur mère n’est rien en regard des emboîtements d’époque qui se sédimentent dans ce lieu baigné d’une histoire violente. Ce désert fictif de l’année 1955 dans lequel on meurt de chaud, se confine à l’extérieur et craint collectivement la fin du monde n’est bien sûr qu’un miroir tendu aux anxiétés collectives de notre époque. Wes Anderson a beau empiler des couches de vaudeville trépidant, il n’en livre pas moins, fût-ce à sa manière pleine d’afféterie, son premier film sur les grandes peurs du monde contemporain.
Dans ce grand colin-maillard où chaque visiteur d’Asteroid City tourne ses yeux vers le ciel, seules trois personnages prennent à leur charge d’offrir un rite funéraire à la femme d’Augie emportée par la maladie. Ce sont ses trois fillettes, auto proclamées sorcière, vampire et zombie qui creusent le sable de leurs petites mains et inventent des prières, s’attachant à faire un lien entre ici et au-delà.
Asteroid City, un film de Wes Anderson, en salle à partir du mercredi 21 juin 2023.
