Macron et les intellectuels de la décivilisation
L’objet de ce petit texte d’humeur est une réflexion sur l’usage convenu et de plus en plus utilisé dans les médias de la notion de décivilisation, depuis qu’elle a été adoubée par quelques prétendants reçus à l’Élysée s’érigeant en intellectuels et conseillers du gouvernement en vue d’éclairer un président cherchant à fonder en valeur sa politique verticale et autoritaire à l’encontre des manifestations massives contre la réforme des retraites[1].
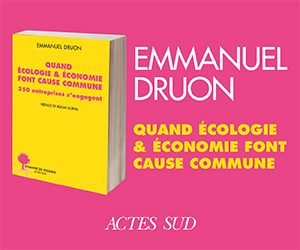
On peut s’interroger sur le choix et la représentativité de ces intellectuels conviés par Macron ou par ses conseillers. Une des hypothèses est qu’il se fonde sur leur réputation médiatique plutôt que leur renommée auprès de leurs pairs. Pour le pouvoir, l’intellectuel est celui qui occupe les tables rondes des médias et qui doit sa réputation à l’audimat et à la fréquence de ses apparitions dans l’espace public (plusieurs centaines d’apparitions de Jean Viard dans l’espace médiatique). Nul doute qu’à ce compte Jean Viard, le sociologue patenté des Grandeurs, soit un invité de taille. « Mister Feel Good Sociology ou l’optimiste invétéré », tel est le titre donné par deux journalistes de L’Obs (05 janvier 2023) qui se questionnent sur son influence auprès des élites : « ce directeur de recherche au CNRS à la retraite, chouchou des médias, des politiques et des chefs d’entreprise ».
Ce n’est pas la première fois que ce sociologue confirmé par les médias à l’appétit insatiable est consulté par le Grand Autre. Celui auquel on a donné le surnom de Jupiter l’avait déjà appelé à son secours au moment de la crise des Gilets jaunes, le revoilà remis en scène et au sommet de sa renommée, la montée vers le palais présidentiel. Bourdieu dans son ouvrage Sur la télévision, suivi de L’Emprise du journalisme (Raison d’Agir, 1996) dénonçait ce qu’il appelait « les fast thinkers » médiatiques, c’est-à-dire ceux qui sont consacrés comme intellectuels par les médias. Dans ce même ouvrage, il s’interrogeait sur la dimension publique du sociologue dont l’expertise, disait-il, n’est recevable qu’à la condition qu’elle soit informée, critique, subversive et populaire. On en est loin.
Le choix des conseillers en dit long sur la médiocrité d’un pouvoir déboussolé en quête de sens et qui plutôt que d’être à l’écoute des citoyens et des syndicats va se rassurer auprès des diseurs de bonne aventure, chroniqueurs, politologues complaisants, à la parole facile, qui font la pluie et le beau temps et qui actionnent leurs réseaux et relations pour se faire passer pour les bonnes et vraies têtes pensantes.
Depuis cette entrevue élyséenne, le terme décivilisation fait florès et il a acquis ses lettres de noblesse, validé par le Maître des lieux et ses courtisans qui, comble de l’ironie, en aurait trouvé le motif chez Norbert Elias dans son ouvrage publié en 1969, La Société de cour. Contrairement à ces bien-pensants des temps présents, pour Norbert Elias, l’analyse de la société de cour n’aspire à aucune prétention moralisatrice et universaliste, elle se situe dans un contexte historique spécifique, celui de la noblesse de cour de l’Ancien Régime. Le processus de civilisation décrit est celui propre aux dominants, à savoir un dispositif formel de bonnes règles de savoir-vivre, de maintien de son rang et du respect de l’étiquette sociale en vue de consolider les hiérarchies pour imposer la sujétion des sujets envers ceux qui sont en haut de la pyramide sociale.
Cet ouvrage de sociologie historique a permis à Elias de penser le rapport des individus à la société, notamment les règles d’interdépendances réciproques et de domination dont la reproduction n’est jamais assurée sans le recours aux valeurs dont la fonction est de maintenir à distance le corps du peuple. En cela, le processus de civilisation rejoint le concept d’habitus de Bourdieu, l’incorporation et l’intériorisation des systèmes de valeurs assurant et confortant l’hégémonie des élites.
Vu sous cet angle, le processus de civilisation est indissociable d’une analyse du pouvoir et n’a rien à voir avec le sens commun de « civilisé ». Bien au contraire, il s’agit d’une critique virulente de l’emprise et des manières subtiles dont celle-ci s’exerce sur les individus afin de diminuer leur liberté. En ce sens, parler de décivilisation (non-respect des règles au sens vulgaire) est un détournement de l’œuvre de Norbert Elias. Ne nous y trompons pas, on peut même parler d’une utilisation illicite du terme « processus de civilisation », celui-ci n’ayant rien à voir avec un état supposé supérieur dans l’ordre moral et social, mais étant un dispositif de contrainte du corps social. Dans cette perspective, la décivilisation serait plutôt un juste retour des choses, l’abrogation d’un pouvoir autocrate et absolutiste en vue de plus d’équité et de justice sociale et environnementale à l’égard des plus vulnérables et précaires situés au bas de l’échelle sociale.
Les bonnes valeurs et manières des civilisés sont l’arbre qui cache la forêt, à savoir ne pas faire de l’ombre à l’autorité dominante et à la parole certifiée de celui qui croit à son savoir omnipotent. N’oublions pas que Macron a construit d’emblée son ascension en mettant au cœur de l’exercice de la souveraineté sa personne surplombante, un président extraordinaire à la différence de son prédécesseur, le président ordinaire. D’où l’importance qu’il attribue, en dépit de son incantation à la participation, à la verticalité et à la reconnaissance de ses qualités supérieures.
Depuis l’introduction du mot décivilisation dans la politique au cœur même de l’enceinte dorée de l’Élysée, cette expression prononcée autour d’un café entre gens de bonne fréquentation fait désormais florès dans les médias et les débats publics. Que ce soit sur BFMTV et CNEWS ou dans le journal Le Point[2] pour ne citer que quelques supports de communication, les commentateurs s’en donnent à qui mieux mieux. L’avantage du terme provient de sa polysémie et de sa faculté d’embrasser des événements différents, du wokisme aux mouvements écologistes et des black block incontrôlables aux chômeurs et bénéficiaires du RSA et autres asociaux, traités comme des profiteurs aux dépens des bons salariés : tous des décivilisés. Il a aussi le mérite de pouvoir ratisser large dans l’éventail politique, des partis bien pensants à l’extrême droite.
La décivilisation fait dorénavant partie tout autant du vocabulaire politique que journalistique, tout comme le wokisme, utilisé à toutes les sauces. Il contamine le langage courant et les réseaux sociaux, car il a bonne mine et paraît bien plus policé et correct que les mauvais « sauvageons » de Sarko. Surtout, il laisse à penser et donner l’illusion qu’il est le produit d’une longue maturation intellectuelle dont Elias serait la justification. En vérité, il traduit la régression morale et sociale d’un pouvoir de plus en plus illégitime, menacé, et qui pour se faire respecter en revient aux idées les plus éculées, à savoir la crainte de ce que Louis Chevalier (1959) avait désigné comme « Les classes dangereuses ».
« Décivilisé » est un énoncé propre à une classe sociale qui voit son pouvoir s’éroder et qui renoue avec ses vieux démons.
Le XIXe est l’époque où les classes laborieuses équivalent aux classes dangereuses et criminelles. Les classes dangereuses sont devenues par la magie du verbe politique contemporain des éco-terroristes ou des rebelles en puissance parce que décivilisés, opposés aux valeurs républicaines et à celui qui s’en prétend le gardien. Son usage est une parade sémantique à la peur qui s’est emparée du pouvoir depuis le soulèvement des Gilets jaunes et dont la finalité est de disqualifier et délégitimer toute possibilité de révolte et comportements jugés comme grossiers, vulgaires et contraire à la bonne norme. Profitant de sa victoire à la Pyrrhus contre les manifestations sur la retraite, l’auguste président cherche des justifications savantes et bienséantes pour criminaliser les mouvements en cours, les Zadistes, les Soulèvements de la terre, Extinction rebellion et même la Ligue des droits de l’homme, etc.
« Décivilisé » est un énoncé propre à une classe sociale qui voit son pouvoir s’éroder et qui renoue avec ses vieux démons : se convaincre de sa prééminence et supériorité pour asseoir sa domination de plus en plus contestée et légitimer l’exercice de la violence. Qui dit « décivilisé » connote l’image du mauvais sauvage qu’il faut redresser, la dimension coloniale de l’expression étant sans équivoque, le décivilisé est un primitif. Le recours à la morale et aux valeurs comme dispositif de contrôle, de subordination et d’exclusion de ceux d’un rang inférieur aux élites a été bien analysé par David Graeber dans son Essai sur la hiérarchie, la rébellion et le désir (Payot, 2015). C’est un moyen de discréditer en les abaissant les perdants du jeu économique, les pauvres, les travailleurs, les émigrés, les ruraux, et de nos jours les rebelles à la globalisation néo-libérale afin de les faire passer pour des ratés, voire des profiteurs, ou pire, comme des terroristes en puissance.
« Décivilisé » est plus soft que « barbare ». Surtout, le terme a l’avantage de détourner l’attention sur sa réelle signification en pointant un idéal civilisationnel en train de s’effondrer alors que ce qui est ciblé ce sont tous ceux qui refusent l’ordre et les règles d’un pouvoir de plus en plus chancelant où « le marché est vanté à l’infini comme le seul synonyme de liberté et de démocratie et où ses thuriféraires se sont attribués le droit de réformer chaque individu et chaque chose sur terre » (Graeber).
« Décivilisé » annonce potentiellement la possibilité pour ces couches sociales de sombrer dans le chaos et l’anomie et de se faire les fossoyeurs de la prétendue civilisation dont Macron serait l’ultime protecteur et défenseur. Recourir à cet énoncé est une manière de sacraliser sa stature en lui conférant un rôle à son image : civiliser la France et les français, redresser le pays et le remettre dans le droit chemin.
« Décivilisé », cependant, traduit aussi la panique du pouvoir face à la dissolution des principes de hiérarchie et de supériorité des élites dont le magister est remis en cause par des citoyens toujours plus informés et éduqués.
L’histoire est une farce qui se répète. Du temps des classes dangereuses, le carnaval était un moyen de se moquer des raffinements des élites bourgeoises, des bonnes manières, de la pudeur. Le carnaval louange les dépravés qui se moquent des civilisés et de leurs bonnes manières en rompant d’avec les convenances sociales et qui par la ruse et la farce se déjouent du pouvoir et de sa maîtrise fantasmée par les puissants. Il exprime le besoin de rupture et de sédition en brisant de manière burlesque les chaînes du pouvoir et de l’autorité. En Angleterre, au XVIIIe « la réforme de la culture populaire » envisagée par Edmund Burke, participait selon Graeber (ouvrage cité) de ce même mouvement, à savoir interdire toute manifestation d’indécence et de parodie grotesque mimant le pouvoir.
Burke est connu en France par ses écrits contre la Révolution française, défenseur des idées libérales, il n’en reste pas moins qu’il faut selon lui impérativement préserver la hiérarchie sociale, modérer la participation politique et rétablir les traditions contre les esprits faux qui régissent la France et qui ont proclamé les droits de l’homme. Tout un programme qui, par bien des égards, n’est pas si éloigné de celui de Macron. « Pour l’essentiel, cette réforme qu’appelle de ses vœux Burke découlait de la tentative, largement répandue parmi les autorités religieuses de la moyenne bourgeoisie, d’améliorer les manières des classes inférieures, et principalement d’éliminer de la vie populaire toute trace carnavalesque » (Graeber, ibid.). Et d’énumérer les cibles des réformateurs : « les acteurs, les ballades, la chasse à l’ours, les combats de chiens, les cartes, les livres de colportage, les charivaris, les charlatans, la danse, les dés, les devins, les foires, les contes populaires, les diseuses de bonne aventure, la magie, les masques, les ménestrels, les marionnettes, les tavernes, la sorcellerie » (Graeber, ibid.). Burke en appelle à la réforme des mœurs tout comme nos réformateurs contemporains.
Le plus comique de l’histoire, c’est le retour des charivaris avec le mouvement des casseroles – les casserolades – comme un des éléments de rébellion sociale et d’ironie du verbe suprême. Et tout comme autrefois, sans avoir honte du ridicule, le pouvoir a sommé les autorités, en l’occurrence les préfets, d’édicter un arrêt d’interdiction de l’utilisation d’ustensiles domestiques sur la voie publique, mais aussi de s’en prendre à la métaphysique des droits de l’homme.
Macron est un revenant des temps passés, ne serait-il pas le Burke des temps post-modernes par sa prétention à réincarner un ordre ancien tout en libéralisant le marché, l’économie et favorisant les droits des possédants et des puissants ? Loin d’être un visionnaire, il réactualise les vieilles rengaines des réactionnaires et des conservateurs pour qui la réforme signifie redressement moral des plus défavorisés et exclusion de ceux qui s’y opposent à la soumission et au dictat du chef.
