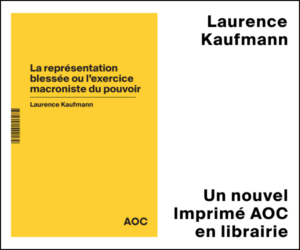L’objet du déni bordelais – sur Humeur noire d’Anne-Marie Garat
Sidérante d’énergie sur la page, où la puissance océanique de sa langue était capable de soulever des montagnes d’informations, comme dans la vie, où elle aura fait preuve d’un engagement aussi constant que généreux au nom de l’art, Anne-Marie Garat a écrit Humeur noire sans préméditation aucune et sans avoir la moindre raison de penser que ce livre d’une liberté d’autant plus magistrale qu’il s’appuie sur une érudition impressionnante pourrait bien être le tout dernier qu’elle écrirait, en tout cas qu’elle publierait de son vivant, quelques mois avant sa mort, le 26 juillet 2022 à l’âge de 75 ans, des suite d’un cancer brutal.
Humeur noire en devient testamentaire, alors même qu’il constitue un pas de côté dans une œuvre romanesque foisonnante dont l’un des sommets reste la trilogie entamée avec le volumineux Dans la main du diable en 2006, dans lequel elle aura réussi la prouesse de nous rendre au goût du feuilleton romanesque échevelé sans rien renier des exigences de la modernité, s’arrachant par le haut à « l’ère du soupçon » à une époque où tant de romanciers jetaient l’éponge (mais l’on n’oublie pas les merveilleux Dans la pente du toit, paru en 1998, et La nuit atlantique, en 2020).
C’est peu de dire que relire Humeur noire à l’occasion de sa parution en poche, un an après sa mort, alors que la première lecture avait eu lieu un an avant, est une expérience saisissante. On sait bien que, d’une lecture à l’autre, les livres vivent leur vie, dans le secret de nos bibliothèques, et parfois se recomposent au point de se métamorphoser.
Mais le phénomène prend ici une dimension supplémentaire, quand ce récit nécessaire entremêle les heures les plus sombres de l’histoire bordelaise et l’autobiographie d’une enfant des quartiers ouvriers de la cité girondine : la saine colère qui a présidé à son écriture donne au texte une qualité de présence tout à fait stupéfiante. Au-delà de l’émotion qu’elle peut générer, c’est aussi cette qualité de présence, en vérité, qui émerveille de bout en bout tandis que « chante la colère », pour frayer à la source de la littérature occidentale en citant les trois premiers mots de l’Iliade. D’un bout à l’autre le texte vibre d’émotions sensiblement vivifiantes, confirmant au passage ce paradoxe à jamais perturbant : rarement sans doute l’on est autant présent à une vérité de soi-même que dans l’hors-de-soi de la colère.
Véritablement on l’entend autant qu’on la lit, emportée qu’elle est à la poursuite de ce trop-plein d’une colère revenue de très loin, qui menace de la déborder mais qu’elle canalise en multipliant de longues digressions érudites. Elle s’octroie dans l’exercice la plus grande liberté, et si certaines digressions peuvent paraître s’éloigner du sujet, c’est chaque fois pour mieux nous attendre au tournant : tant il est évident, à l’instant de retrouver le cœur du propos, et par exemple, que rappeler les heures horrifiques du Bordeaux pétainiste (« au prorata de sa population, Bordeaux est l’une des villes qui déporte le plus grand nombre de Juifs, proportion d’enfants compris », quand bien même il aurait fallu « le tardif procès Papon en 1997 pour rappeler la servilité des édiles bordelaises, des journalistes, universitaires, des élites économiques et artistiques, aux menées nazies ») ne peut que nous ramener tôt ou tard à l’héritage des florissants esclavagistes de Saint-Domingue.
Ces derniers sont restés si longtemps maîtres de la ville qu’on croise partout leurs noms, aujourd’hui encore, au coin des rues : ainsi, et pour ne prendre que ce seul exemple presque au hasard, du cours Journu-Auber dans le quartier des Chartrons, qui doit son nom à Bernard Journu-Auber comte de Tustal, époux d’une riche créole de Saint-Domingue qui fut « député anti-abolition à l’Assemblée Nationale, fondateur et censeur de la Banque de France, planteur et armateur de navires de traite de 1787 à 1792. »
Colonie française la plus riche d’Amérique grâce aux profits immenses générés par le travail de centaines de milliers d’esclaves enchaînés à la culture du sucre et de l’indigo, Saint-Domingue aura été la manne bordelaise jusqu’à la proclamation de la République d’Haïti, en 1804 – et même après, comme l’on sait : puisqu’en 1825 les bateaux français de Charles X venus braquer leurs canons sur Port-au-Prince devaient obtenir « dédommagement des colons blancs de la confiscation définitive de leurs propriétés. En 1828, une commission ad hoc évalue leur perte à 150 millions de francs or. Y siègent les plus riches planteurs, dont le baron Pierre-Barthélémy Portal (mon cours Portal voisin), maire de Bordeaux et maître des Requêtes, qui en est le président. […] Cette colossale rançon ruine la république d’Haïti ; les intérêts de l’emprunt seront payés jusqu’en 1960. »
On en vient au long des pages à soupçonner Anne-Marie Garat d’avoir lu tout ce qui pouvait se lire sur le commerce triangulaire.
Ce que l’on sait moins, c’est comment les indemnités furent calculés non pas en fonction du foncier, mais en fonction du nombre d’esclaves possédés et de leur rendement à l’hectare : « 2 850 francs or par tête pour le coton 3 250 le café, 3 800 l’indigo, 4 000 le sucre […]. C’est donc bien tête par tête que les esclaves de Saint-Domingue et leurs descendants “indemnisent” leurs maîtres français du dol de leur libéré, implacable vengeance coloniale dont les effets socioéconomiques s’observent encore aujourd’hui en Haïti, sans que la France admette cette prédation inique, ni même l’idée d’une réparation. »
Sans que la France l’admette, et encore moins Bordeaux, qui n’a pas même commencé sérieusement d’entreprendre le travail mémoriel qui lui incombe au contraire de Nantes, Bristol ou Liverpool : en témoigne assurément l’anecdote qui aura déclenché la fureur d’Anne-Marie Garat en plusieurs étapes, ouvrant les vannes à l’expression d’un malaise bien plus ancien qui s’avère le cœur battant de son livre et qu’elle met ici à nu en accomplissant un travail considérable. Elle s’autorise d’autant mieux, au passage, à écarter par avance les objections liées à la notion d’appropriation culturelle, plusieurs fois évoquées, qu’elle maîtrise parfaitement, non seulement la documentation historique, mais aussi son usage inscrit ici dans le droit fil des travaux de Patrick Boucheron rappelant que « le présent, c’est l’actualité du passé ». Ce qui lui permet d’articuler cet usage à la nécessité qu’elle défend de « réparer la relation », ce qui rappelle qu’elle fut aussi lectrice d’Édouard Glissant et de Patrick Chamoiseau, avec qui elle a eu souvent l’occasion de débattre autour de la notion de diversité.
Malaise bien plus ancien, car chaque « retour à Bordeaux », aussi rares ces retours se soient-ils faits au long des années, l’aura longtemps et confusément renvoyée « aux âges obscurs d’une archéologie intime – la mienne autant que de la ville –, à mon ressentiment mêlé de malaise, d’émotions refoulées qui faussent la perception. » Ce mot très foucaldien d’archéologie va comme un gant aux premiers chapitres de Humeur noire, où le souci d’objectivité et de rationalité l’entraîne, avant de juger des mentalités bordelaises contemporaines, à retracer son propre parcours socialement improbable de lycéenne puis d’étudiante à une époque où les amphis de lettres, « remplis aux deux tiers de filles – pull shetland et collier de perles, imper mastic ceinturé, dress-code de l’étudiante bordelaise – comptent 3 % d’enfants ouvriers (ouvriers, dit-on encore). Si j’ignore alors cette éloquente statistique, j’en fais à mes dépens l’expérience intuitive, jusqu’à lire enfin Les héritiers. Les étudiants et la culture de Bourdieu et Passeron […] qui m’instruit sur les inconvénients de mon pedigree, très minoritaire parmi cette élite de la jeunesse girondine ».
Ne pas disposer des codes, au passage, implique rapidement pour qui veut tracer son chemin de se doter d’autres outils, et la capacité de travail en est un, assurément : on en vient au long des pages à la soupçonner d’avoir lu tout ce qui pouvait se lire sur le commerce triangulaire et, de manière plus pointue encore, sur le destin de quelques anciens esclaves qui vécurent à Bordeaux une fois affranchis et dont les cas émergent de l’anonymat, ainsi de Marie-Louise Charles, née esclave en 1765 en Guadeloupe et dont la dernière trace existante la désigne comme veuve et lingère établie à son compte dans le quartier de Mériadeck, en 1807.
Mais il est temps d’en venir à l’objet du délit, qui est avant tout un objet du déni bordelais : c’est tout à fait par hasard qu’un jour de flânerie en compagnie d’un cousin resté bordelais, Anne-Marie Garat est entrée dans les locaux qui furent autrefois ceux de la « fac de lettres » bordelaise et qui abritent aujourd’hui ledit Musée d’Aquitaine. S’y retracent l’histoire de Bordeaux et de sa région et le musée, depuis une dizaine d’années, compte une exposition permanente dédiée à la traite négrière.
Entre deux tableaux illustrant la vie de bourgeois bordelais du XVIIIe siècle posant dans leur salon, l’un « avec nourrice noire, bébé blanc aux bras, posée en plante décorative près de ses maîtres ; l’autre d’une dame poudrée avec jovial négrillon enturbanné, collier de servage au cou », scènes de genre classique de cette époque, elle découvre ce cartel intitulé « Noirs et gens de couleur à Bordeaux » dont il convient, sans bouder le luxe qu’offrent le format des articles d’AOC, de citer dans son entière brièveté :
« Au moins 4 000 Noirs et gens de couleur viennent à Bordeaux au XVIIIe siècle. Il s’agit pour l’essentiel de domestiques suivant leur maître, d’esclaves envoyés apprendre un métier, et d’enfants métis venus parfaire leur formation. Il y a peu de problèmes de cohabitation en dépit d’une forte discrimination. Dans le premier quart du siècle, les autorités veulent limiter cet afflux en organisant des recensements obligatoires, une police particulière et un “dépôt” des Noirs. Mais ces mesures ont peu d’effet, avec une vingtaine d’emprisonnements connus. En 1777, trois cents personnes de couleur sont recensées dans la Généralité. Les deux tiers sont des esclaves bien que “la France ne puisse admettre aucune servitude sur son sol”. En 1776, deux Noirs esclaves gagnent un procès contre leur maître obligé de leur rendre la liberté. Ces velléités sont cependant combattues jusqu’à la Révolution. »
Humeur noire nous rappelle la capacité de l’imagination à créer des images, et si possible des images justes et vraies.
Quoiqu’elle n’ignore pas la difficulté de vulgariser des connaissances en 900 signes, c’est peu de dire qu’Anne-Marie Garat s’offusque de « la tartufferie de cette rhétorique – bordelaise la qualifiai-je d’emblée », non sans faire penser incidemment à la fameuse « bouillie bordelaise » pour reprendre le nom d’un produit né du traitement de la vigne dont les jardiniers connaissent bien les qualités de fongicide polyvalent « utilisé depuis très longtemps pour lutter contre les maladies apparaissant dans le jardin et plus particulièrement dans le potager ». Le fongicide ici concourt assurément à « l’incurable tendance de cette ville à édulcorer son histoire – et, question sucre, celle-ci en connaît un rayon. Noirs et gens de couleur viennent donc à Bordeaux. Ils y suivent leur maître. Un “bien meuble”, sujet de verbe d’action ? Un quidam disposant de lui-même, décidant d’aller et venir ? Ces gens sont à Bordeaux pour y apprendre un métier, parfaire leur formation. Bonifier l’instruction dispensée là-bas, aux îles à sucre ? Braves négriers bordelais. Qui, dans leur fol altruisme, encombrent leur port de ces apprentis au point que leur afflux provoque un trouble à l’ordre public » : l’étude de texte est jubilatoire.
« C’est la lectrice et l’écrivain à la fois que ce cartel hérisse, indigne et révolte. Il me rend à ma détestation foncière – ma peur – des usages inconséquents du langage, ce qu’ils charrient de toxique, de criminel, de mortel parfois. Les mots tuent. La pensée, les hommes. Ainsi que le signifie radicalement Orwell : la pire chose que l’on puisse faire avec les mots, c’est de capituler devant eux. »
Après avoir tergiversé – qui est-elle pour réagir ? au nom de quoi ? – elle décide cependant d’écrire une lettre au directeur du Musée, récemment nommé après avoir dirigé le musée d’histoire de Marseille, ce qui permet à l’écrivaine d’espérer qu’il n’est pas « encore sous influence des milieux bordelais ». Il ne la gratifie cependant, un mois plus tard, que « d’une réponse pondérée faisant l’éloge de son établissement, plaidant pour l’excellence du contexte muséal et trouvant quelque peu malvenue [sa] susceptibilité quant à la teneur du cartel incriminé. Toutefois s’engageant en conclusion à envisager de commencer à réfléchir à consulter pour éventuellement amender son texte ».
Las, plusieurs mois étant passés, lorsqu’Anne-Marie Garat a l’occasion de retourner au musée d’Aquitaine, le cartel n’a pas bougé d’un iotat, « l’afflux » quelque peu menaçant des Noirs et gens de couleur « venus » à Bordeaux pour « parfaire leur formation » est toujours affiché comme tel, et personne n’a trouvé moyen d’expliciter comment ils peuvent être « essentiellement des domestiques mais aux deux tiers des esclaves ».
Les écluses de la colère se sont alors et grand ouvertes ; à défaut de réagir véritablement, du moins « Monsieur le directeur du musée d’Aquitaine » aura offert une magnifique adresse à cette colère. Piquée au vif, cette fois, Anne-Marie Garat impulse une tribune qui paraît dans Le Monde contresignée par quelques écrivains (dont l’auteur de cet article), ce qui produit enfin de premiers effets : disons qu’une nouvelle version du cartel inviterait un instituteur bienveillant à noter l’effort fourni, un autre plus exigeant à rire jaune. Certes « il n’est plus question d’afflux. Mais Bordeaux tient toujours à ce que ses esclaves (décidément domestiques) suivent à l’insu de leur plein gré leurs patrons des îles à la métropole. Cette fois, c’est afin d’y apprendre un métier utile aux plantations avant d’y retourner. Genre stage de découverte. Avant retour à la case et au taf. Sympa. Humour noir à la Pierre Desproges ? Hélas non, juste premier degré bordelais pur sucre. D’ailleurs, s’il y a discrimination raciale, c’est seulement par l’usage du collier de servitude. Parce que, hormis cette petite manie, la présence de cette population semble tolérée. […] Je pinaille, chamaille et querelle, ça me fatigue moi-même. / Me fatigue surtout que des gens estampillés par l’Université, supposés maîtriser la langue française, soient bigleux à ce point sur ce qu’ils énoncent qu’on les dirait ne savoir de quoi ni de qui ils causent. Manque d’imagination dirait tout raide Hannah Arendt ».
L’imagination, c’est-à-dire, la capacité à créer des images, et si possible des images justes et vraies, c’est bien ce que Humeur noire répare ou restaure dans ses fonctions indispensables, s’autorisant de sa qualité d’écrivain pour s’y employer avec flamme : l’écrivain, ici, étant assurément celui qui prend soin des mots de tous, pour tous.
On ne spoliera pas la toute fin du livre en citant le cartel revu et corrigé comme il se devrait, c’est-à-dire, en citant la version qu’Anne-Marie Garat in fine propose après avoir mis au net, dans ce livre décidément testamentaire, la part de colère qui lui revient en propre face aux dénis de mémoire de sa ville de naissance : version dont assurément le Musée d’Aquitaine s’honorerait de s’inspirer, plutôt que de persister à afficher sans vergogne l’objet du déni bordelais.
Humeur noire d’Anne-Marie Garat, Actes Sud, « Babel », 304 pages.