L’Afrique, laboratoire mondial d’une ignorance organisée ?
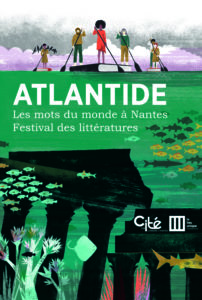
À Dakar (Sénégal) s’ouvre ce 2 février la conférence de financement du Partenariat mondial pour l’éducation. Ce rassemblement bénéficie du parrainage conjoint des gouvernements du Sénégal et de France. Le président Emmanuel Macron y prendra part. Y participeront des bailleurs de fonds, le secteur privé, des fondations philanthropiques, des organisations internationales et la nébuleuse de la société dite civile. Vaste entreprise de communication, le but de la conférence est de récolter, à l’horizon 2020, deux milliards de dollars annuels qui seront consacrés à l’éducation dans les pays dits émergents. Cet énième para-téléthon n’est pas sans soulever d’importantes questions qu’il n’est plus possible d’éluder.
La course à la scolarisation
À peu près dans tous les pays africains, les années postindépendance auront été marquées par la course à la scolarisation. De fait, au cours de la période coloniale, peu de progrès avaient été réalisés dans ce domaine. L’économie coloniale était basée sur l’extraction des matières premières et des produits de rente. Elle avait, pensait-on, surtout besoin d’une main-d’œuvre primaire, abondante et à bas prix. Dans ces conditions, et compte-tenu de leurs capacités innées, lesquelles n’étaient guère infinies, exposer les indigènes à des formations spécialisées relevait du gaspillage. Il suffisait d’initier quelques intermédiaires à l’accomplissement mécanique des tâches élémentaires que requérait, par ailleurs, leur intégration subalterne au sein d’une économie vouée à l’extraversion.
C’est la raison pour laquelle pour beaucoup, la fin du régime colonial se confondit avec la conquête de la liberté d’apprendre. En effet, dix ans après la décolonisation, et malgré d’évidentes disparités, les taux de scolarisation grimpèrent considérablement. Les nouveaux États s’étaient emparés de la planification des besoins en matière d’éducation. Paradoxe, plus les taux de scolarisation grimpaient, plus – croissance démographique oblige – le nombre d’enfants scolarisables était en constante augmentation. L’articulation entre la sphère de l’éducation et la sphère productive avait beau laisser à désirer, l’éducation était devenue un mécanisme incontournable dans les stratégies de mobilité sociale.
La construction des systèmes éducatifs ne répondait guère, comme en Occident, aux besoins d’un capitalisme industriel en phase d’expansion. Elle était plutôt liée à un processus de salarisation de nature essentiellement bureaucratique, par définition insoutenable en l’absence d’une accumulation véritable. C’est donc naturellement que la crise éclata au milieu des années 1980. Croulant sous le poids de la dette, maints États furent contraints de passer sous les fourches caudines du FMI et de la Banque mondiale. Obligés de procéder à la compression de leurs dépenses, les gouvernements africains diminuèrent drastiquement les budgets alloués aussi bien à l’école publique qu’à la santé publique, au logement, à la protection sociale, aux transports, voire aux arts et à la culture.
Sommé de se « désengager » de ces secteurs par les organisations internationales et les institutions financières, l’État ne reconnaissait plus le financement public de l’instruction comme faisant partie de sa responsabilité régalienne. Ainsi prit fin la course à la scolarisation par le biais de financements publics, l’une des politiques sociales sans doute les plus révolutionnaires de la période postcoloniale.
C’est ainsi qu’au long des années 1990, le continent entreprit une longue transition qui se solda par une massive déscolarisation des enfants, le délabrement de maintes institutions de recherche, la clochardisation des personnels enseignants, une fuite sans précédent des cerveaux en direction notamment des États-Unis et d’autres pays occidentaux, et l’apparition d’une génération perdue, une classe de superflus n’ayant de choix qu’entre l’enrôlement dans les marchés régionaux de la violence (enfants soldats) ou les routes de la migration et de l’exil.
La destruction du capital humain et des institutions
L’Afrique a donc servi de laboratoire privilégié aux expériences les plus brutales de néo-libéralisation de l’éducation au tournant du XXe siècle. À l’orée des années 2000, le paysage éducatif s’était, au demeurant, notablement reconfiguré. Dans le cadre de la gestion des programmes d’ajustement structurel dans ces pays lourdement endettés, un véritable processus de dépolitisation de presque tous les aspects de la vie sociale était en cours. L’État avait été considérablement affaibli et vidé de sa puissance. Dans ce vide s’étaient engouffrés une multitude d’acteurs locaux et internationaux dotés de ressources multiformes (financements, expertise, capital d’influence). Ils s’étaient saisis de la chose publique et détenaient d’énormes pouvoirs en matière de reconstruction du système éducatif.
Au regard de la nouvelle orthodoxie, l’éducation n’était plus une question politique fondamentale, liée à la reproduction de la société et de ses valeurs. Prenant pour prétexte la défaillance des gouvernements, bailleurs de fonds multilatéraux, ONG, gouvernements étrangers, experts, lobbies et firmes transnationales s’étaient progressivement infiltrés dans le pilotage de l’éducation, rognant ce faisant sur les prérogatives autrefois monopolisées par les États. Désormais, il n’était plus question de développement, mais de « réduction de la pauvreté ».
Alors que partout ailleurs la priorité était à l’économie du savoir, l’on considérait désormais qu’en Afrique, seul l’enseignement primaire pouvait se prévaloir d’être le moteur pour l’amélioration du bien-être social général. S’ouvrit ainsi une période relativement singulière de l’histoire des sociétés postcoloniales, celle de la destruction des institutions et du capital humain accumulé au cours de la première décennie de l’indépendance dans des domaines clés tels que la santé, l’agriculture, l’alimentation ou l’ingénierie. Cette destruction contribua à l’érosion et à la fragilisation des capacités d’autosuffisance des sociétés locales. Qu’il s’agisse de l’enseignement scolaire formel, de l’éducation de la petite enfance ou des programmes d’alphabétisation et d’acquisition des savoir-faire utiles dans la vie courante, les pouvoirs africains avaient perdu la capacité de définir de façon autonome le sens, l’objet et le contenu de l’éducation. Nous ne sommes pas sortis de cette trajectoire.
L’Afrique continue de faire l’expérience d’un dénuement éducatif massif. Or les conditions internationales ne sont guère favorables à la mise en œuvre de politiques éducatives autonomes. Les nouveaux marchés du savoir qui émergent à la faveur de la financiarisation de l’économie et de la planétarisation des échanges excluent, par définition, les pauvres. Les organisations internationales ou inter-gouvernementales, les anciennes puissances coloniales, bref une multitude d’acteurs y compris étrangers ont contraint l’État à partager avec eux l’autorité exclusive qu’il était supposé exercer sur la chose publique. C’est le cas en matière d’éducation. Or, aucune de ces entités n’est comptable devant les citoyens qui sont les sujets des politiques qu’elles conçoivent, financent et exécutent.
L’éducation est devenue un service que l’on vend et achète. L’école n’est pas une institution sociale puisque la société, estime-t-on, n’existe pas. Seul existe un marché, avec des vendeurs et des acheteurs. Ceux et celles qui n’ont rien à vendre et rien à acheter ne comptent guère. L’école n’est qu’un rouage de plus dans le grand projet de soumission de la vie au calcul économique. L’enseignement est une industrie qui obéit aux mêmes lois de rentabilité que tous les autres investissements. Le contenu de ce que l’on enseigne importe de moins en moins. Seul compte le mode d’accès à ce savoir fragmentaire.
Le principe du recouvrement des couts constitue désormais la norme, y compris pour l’école publique. Ces coûts sont, pour l’essentiel, supportés par les ménages. Aux pauvres qui ne disposent guère de ressources familiales suffisantes, il est courant que l’on propose désormais des prêts. En termes de contenu, l’enseignement se fait en priorité dans les matières jugées utiles. Les sciences sociales et les humanités ne servent à rien. Le marché désormais dicte aussi bien les programmes que la pédagogie. L’enseignement n’étant plus conçu que comme un service parmi d’autres au sein d’une économie où le plus efficace l’emporte sur les autres. Le sujet que forme l’école n’est pas celui des Lumières, lequel devait porter la démocratie, dans le droit fil du projet universel d’émancipation. C’est le sujet endetté, prêt à se lancer dans les affaires, grâce à la généralisation du crédit.
Le siècle de l’ignorance organisée
Ces recompositions ne sont pas typiques de l’Afrique même si elles prennent, ici, une allure dramatique. Contrairement à ce que proclame la vulgate, le XXIe siècle ne sera pas seulement celui du savoir et de la connaissance. Il sera aussi celui de l’ignorance abyssale, tout à fait volontaire, et de la violence opaque, mais organisée. Cette volonté d’ignorance, et cette violence organisée, les pauvres en paieront le prix le plus élevé.
Le savoir lui-même sera de plus en plus sélectif et fragmentaire, parcellaire. Il sera de plus en plus délégué à toutes sortes d’artefacts eux-mêmes de plus en plus miniaturisés. Le savoir ne vaudra plus du tout par lui-même ni par sa capacité à libérer l’esprit humain. Il ne bénéficiera d’aucune autonomie. Connaître, ce sera de plus en plus apprendre à se plier à une seule norme, celle du profit et de la rentabilité. Le savoir n’aura plus pour but l’élévation de la personne humaine et l’amélioration de ses rapports avec les autres entités et espèces vivantes.
Viendrait-elle à entériner l’idée selon laquelle seule la rationalité économique et instrumentale doit guider les choix de politique éducative en Afrique, la Conférence de financement du Partenariat mondial pour l’éducation relancerait, sur une échelle plus vaste que dans le passé, le processus de destruction du capital culturel et humain non seulement du continent, mais de l’ensemble de l’humanité.
