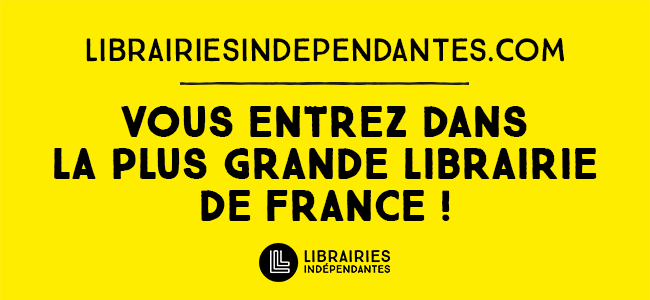Lois de bioéthique : où sont les femmes ?
Les États généraux de la bioéthique ouverts le 18 janvier dernier sont la première étape d’une révision générale des lois de bioéthique prévue par la loi de 2011. Organisés par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), l’instance consultative qui éclaire le législateur et le gouvernement sur ces matières complexes et disputées, ils remettent en jeu les multiples questions que les avancées de la science et des techniques médicales posent à l’opinion publique, dont les conceptions diverses du juste, du bon et de l’acceptable ont beaucoup évolué depuis les premières lois de bioéthique de 1994. Des sondages récents dessinent ainsi un libéralisme marqué, favorable à l’expression d’une liberté plus grande de l’individu-e sur son corps, des origines de la vie à la mort, et sur les formes sociales d’accueil de la vie (familles monoparentales et homosexuelles).
Y a-t-il risque de dissolution de la société, de marchandisation des corps ? Ou bien y a-t-il possibilité de s’affranchir d’un ordre sexuel hétéro-normé ouvrant le droit, à tous, à une vie familiale sans discrimination de sexe (garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme) ? C’est dans ce contexte que je propose ici ce que pourrait être le point de vue des « femmes » dans le débat bioéthique en cours et une lecture critique de l’avis n° 126 (juin 2017) du CCNE, avis favorable à l’extension de l’assistance médicale à la procréation (AMP ou PMA) aux femmes célibataires et aux homosexuelles, mais non à la GPA (gestation pour autrui, où l’on implante un embryon sans lien génétique avec la mère porteuse puisqu’il provient des gamètes des parents d’intention, avec ou sans donneur extérieur).
Femmes et bioéthique : droits des femmes ou chose publique ?
Pour les Françaises, l’enjeu de la révision des lois de bioéthique est double. D’une part, les femmes homosexuelles en couple et les célibataires réclament au nom de l’égalité juridique un « droit » à la PMA, aujourd’hui réservée en France aux couples hétérosexuels infertiles. L’argument, mobilisé depuis l’obtention du mariage pour tous, s’inscrit dans sa suite logique, puisque le droit de fonder une famille est l’horizon prévisible – pour ne pas dire « naturel » ! – du mariage. Cependant, cette revendication fait passer le recours à l’AMP du statut pathologique, pris en charge par le corps médical, à une demande « sociétale », ce qui en modifie profondément l’économie, le coût, la signification sociale, et a motivé l’auto-saisine du CCNE, dont l’avis discute de ses multiples effets.
D’autre part, il s’agit de savoir si l’une des techniques possibles d’AMP, la GPA, interdite en France mais légale dans d’autres pays d’Europe et du monde (et de ce fait source de « fuites » vers l’international et de problèmes d’apatridie filiale et nationale, dans les cas d’enfants nés à l’étranger de GPA), est une pratique respectueuse des droits de la personne ou si elle s’apparente, comme le soutiennent certaines féministes, de droite comme de gauche, et l’Église catholique, à une marchandisation du corps des femmes et des enfants nés de ces contrats de gestation contraire à la dignité humaine.
Directement concernées par ce débat, les femmes sont pourtant loin d’être seules à s’y exprimer et, avec les États généraux, c’est toute la société française qui est invitée à se pencher sur leur corps et leur choix de vie, pour en tirer des conclusions « éthiques ». Le CCNE, instance à visée consensuelle, qui représente le monde de la recherche, de la science de la médecine et des « principales familles philosophiques et spirituelles », justifie, non sans raison, cette perspective sociétale parce que les droits des unes ont des conséquences sur les droits des autres (hommes, enfants à naître, corps médical…). Cette perspective éminemment sociale enchâsse les droits des femmes dans la société, sous le contrôle régulateur d’autorités morales ou scientifiques. Elle contraste par exemple avec la conception américaine du droit à l’avortement, construit par la Cour suprême comme le droit individuel et privatif de la femme sur son corps propre, érigé contre les ingérences de la société. Cette approche, hyper-individualiste, ignore cependant la question, sociale et collective, du financement public des droits reproductifs, dans une approche quelque peu hypocrite de la liberté individuelle.
Tel n’est pas le cas en France où, malgré les angoisses d’« individualisme sans frein » exprimées par l’Église catholique ou les craintes de la Manif pour tous d’une « fragmentation de la société française » et d’une société « sans pères », la forme même du débat « éthique » intègre et légitime leurs perspectives, limitant le droit des femmes par celui d’autrui, et la souveraineté individuelle par celle de la société. C’est d’ailleurs pourquoi ces deux instances tiennent beaucoup à peser dans le débat, à corriger le libéralisme prêté à la société française par les sondages et à faire valoir leur vision morale englobante de la société.
Ainsi, dans le débat éthique qui s’ouvre en 2018 en France, le corps des femmes est largement subsumé par le corps social, et devient littéralement la chose publique, l’objet d’un grand débat républicain.
Liberté, égalité, gratuité… et spectre du marché
Alors que le processus de consultation des États généraux commence tout juste et que l’on peine à trouver sur leur site internet des comptes rendus substantiels (le forum internet évoque les « chambres d’écho » typiques des médias sociaux, où chacun se conforte dans son opinion personnelle), le raisonnement collectif dont témoigne l’avis n° 126 mentionné plus haut a le mérite d’offrir une certaine profondeur de vue, bien qu’il surprenne parfois par des incohérences, points aveugles, ou peurs bien françaises.
Le CCNE réitère les principes de gratuité des dons et de non-disponibilité et de non-patrimonialité du corps humain et s’oppose fermement, on l’a dit, à la GPA. Il réaffirme tout d’abord la liberté des femmes de procréer ou non. Cette liberté n’est pas toujours mieux servie par la technique, comme le rappellent les sages, sceptiques à l’égard de la congélation d’ovocytes, mais favorables à des campagnes d’information auprès des femmes jeunes, et à des politiques publiques de conciliation maternité/travail pour prévenir les risques des grossesses tardives.
Les techniques d’AMP sont en revanche présentées comme un domaine d’extension de la liberté procréative des femmes, puisque le Conseil accueille favorablement la revendication d’égalité d’accès des femmes homosexuelles et célibataires, non sans considérer avec attention les risques invoqués par l’Église ou les mouvements traditionalistes d’une société « sans père » (le géniteur, qui fournit dans ce cas les gamètes mâles, disparaît de la filiation, exposant l’enfant à une inégalité face à ceux bénéficiant d’un double lignage). Estimant la recherche insuffisante pour juger des effets des nouvelles formes de vie familiale sur les enfants, le CCNE note avec pragmatisme que « la famille change » et qu’il serait injuste de ne pas ouvrir l’accès à l’insémination artificielle avec ou sans donneur (IAD) aux femmes célibataires ou homosexuelles, dans la mesure où leur projet d’enfant est mûrement réfléchi et reflète un désir d’autonomie légitime dans laquelle la société n’a pas à s’immiscer.
Cependant, ces conclusions libérales sont limitées en pratique par le principe, fortement réaffirmé, de la gratuité du don des gamètes laquelle suscite une pénurie avouée aux effets délétères (achats de gamètes à l’étranger), réduit les chances, pour les femmes, d’obtenir une AMP dans des délais raisonnables et compromet donc leurs chances de succès. Le CCNE affirme ainsi, sans crainte du paradoxe, que la gratuité « se paye de la pénurie. Protéger la liberté de l’offre revient à ne pas satisfaire la totalité des demandes. C’est un choix éminemment éthique et politique » (p. 24).
Quel choix éthique ? Un choix nationaliste illusoire, où l’éthique du don, vraie en-deçà des Pyrénées, devient mensonge mercantile au-delà, le marché, lui, ne s’arrêtant pas aux frontières nationales… ? Et quel choix politique : le cynisme ? Dès lors que le principe de « gratuité du don », auquel le CCNE tient mordicus, tout en indiquant complaisamment que d’autres pays européens la contournent par des achats de gamètes à l’étranger et que les femmes homosexuelles ne seront pas prioritaires sur les listes d’attente, la démocratisation de l’AMP pour ces dernières est compromise.
En outre, le célibat des femmes interroge les sages non du point de vue du droit mais sous l’angle économique, car les études statistiques montrent que les familles monoparentales, principalement constituées de femmes, connaissent des taux de pauvreté supérieurs à la moyenne nationale, ce qui pourrait nuire aux intérêts de l’enfant. Cette réserve légitime ne suscite toutefois aucune proposition concrète de leur part, sans doute parce que cela excéderait le champ de la bioéthique. Pourtant le CCNE n’hésite pas à s’aventurer dans le domaine de l’égalité économique et social lorsqu’il dépeint la misère du bout du monde que susciterait la GPA, comme on le verra plus bas. Pourquoi une telle sélectivité ? On perd ainsi une occasion de poser, de façon transversale dans toutes les politiques publiques, le problème plus général de l’égal accès des individu-e-s aux aides à la prise en charge d’enfants, qui avantagent traditionnellement en France les « familles nombreuses ». Cette question, posée de façon iconoclaste par Virginie Despentes lorsqu’elle écrivait dans King Kong Théorie ne pas vouloir faire d’enfant tant que les crèches ne seraient pas ouvertes 24h/24, n’est ni déplacée, ni farfelue. Elle évoque les conséquences concrètes de choix (bioéthiques) égalitaires et, très sérieusement (dans la lignée des travaux de Gosta Esping-Andersen), la figure d’un État-providence véritablement non sexiste. Les femmes célibataires candidates à l’AMP, et le législateur avec elles, seraient donc bien inspiré-e-s de mieux lier ces questions qui engagent les conséquences sociales de leurs actes.
La GPA et le CCNE
Enfin, avec la GPA on entre dans une zone de turbulences non seulement pour les droits des femmes et le droit de la filiation, mais aussi pour le raisonnement éthique du CCNE lui-même, qui livre dans ce chapitre ses propos les plus enflammés mais pas toujours les plus cohérents.
En lutte manifeste contre ce que j’appellerais le « Lumpen Progestariat », le CCNE se dit frappé par le risque « non nul », mais largement ignoré des acteurs du circuit de la GPA, « de mort ou d’atteinte grave à la gestatrice », et s’inquiète de la montée d’un marché international de la GPA, où des parents d’intention sans aucun lien biologique avec les enfants à naître alimentent un trafic d’enfants destiné à alimenter les filières d’adoption en pénurie d’enfants. La description de la misère des porteuses est révulsive (implantation d’embryons surnuméraires suivie d’avortements imposés, imposition de césariennes injustifiées, privation de liberté des gestatrices, cloîtrées, en Inde, dans des maisons spécialisées, et non indemnisées lorsque leur grossesse n’est pas menée à terme…) et celle du lien mère biologique-enfant dès la grossesse convaincante : la disjonction entre procréation et filiation se paie pour les femmes, semble-t-il, d’un prix exorbitant et dégradant indigne de leur personne humaine.
Pourtant, le CCNE n’est pas complètement honnête. On peut regretter par exemple une approche confuse des « violences économiques » où, à la limite, toute transaction économique ou relation asymétrique est qualifiée de violence, et où les effets du marché sont souvent confondus avec ceux de la misère (alors que c’est souvent l’accès au premier qui permet de sortir de la seconde, comme le montre de nombreuses études sur le travail des femmes). Se reflète ici une vision caricaturale et bien française du marché, aveugle à sa dimension éthique possible, et à sa régulation nécessaire.
L’éthique du marché a pourtant été mise en évidence par Jacques Derrida, dans une réflexion sur l’argent (Comment penser l’argent, Roger-Pol Droit dir., Le Monde éditions, 1992). On dit souvent que la dignité n’a pas de prix, mais c’est souvent le contraire, socialement, qui est vrai : la valeur sociale d’un bien et donc sa dignité ont un prix, que l’argent, équivalent universel, peut signifier. C’est le sens de la rémunération du travail, sans laquelle c’est la « gratuité » qui est esclavage, et de sa compensation par un juste prix, la reconnaissance éthique du travail d’autrui, en particulier le travail des femmes, longtemps forclos de l’économie et privé de reconnaissance symbolique. Que dire de la douleur, que la société dédommage en droit civil par des indemnités, ce dont personne ne dénonce le caractère vil, ou mercantile… ?
Pourquoi donc refuser d’étendre ce raisonnement à la GPA ? Pourquoi choisir le cas misérabiliste de l’Inde et non le cas, subtil et nuancé, des États-Unis (où vont d’ailleurs de nombreux Européens désireux des contourner les restrictions européennes), pour réfléchir aux dilemmes éthiques de la GPA ? Peut-être parce qu’alors on y découvrirait l’existence d’un commerce légitime, dont les aspects mercantiles, et des prix élevés, rémunèrent le travail et protègent les droits de chacun : des avocats qui régulent ce marché, des médecins qui effectuent ces actes, du corps des femmes qui font naître les enfants, et des parents d’intention qui en sont les auteurs génétiques. Mais un commerce relationnel aussi, au sens premier du terme, où les mères porteuses ne sont pas mues par la misère (dans plusieurs États et de nombreuses agences, les règlementations écartent les bénéficiaires de l’aide sociale et s’assurent de leur confort physique et psychique). Elles sont motivées par une éthique altruiste, souvent religieuse. Elles font ainsi contre une juste compensation (que peu contestent, sauf dans les États où la GPA est illégale – tant il va de soi que le travail du corps de la femme mérite salaire) don de la vie, à des familles avec lesquelles elles tissent souvent des liens. Cette solution exige cependant une véritable régulation qui n’existe pas de façon homogène aux États-Unis et que le CCNE n’envisage pas, même à titre d’hypothèse.
Cependant, poser cette question de la régulation, c’est quitter la posture épouvantée des principes dignitaires nationaux, pour se donner les moyens de connaître et d’encadrer des pratiques imparfaites, dans un monde qui ne se limite plus au cénacle de la bonne société française. Derrière les principes éthiques de l’avis du CCNE se cachent ainsi de nombreux présupposés, pas toujours clairement admis ni explicités. Or, on ne parvient pas à de bonnes conclusions avec des arguments obscurs, ou biaisés. Dans la délibération citoyenne que promettent les États généraux, il importe que les femmes prennent la parole pour y évoquer tous les sujets qu’elles jugent bon, car la liberté démocratique ne consiste pas uniquement répondre à la question que l’on vous pose, mais réside, aussi, dans le pouvoir de définir soi-même les termes du débat.