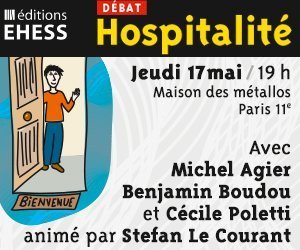Antigone aurait été zadiste
Alors qu’Édouard Philippe annonce la reprise des expulsions à Notre-Dame-des-Landes (NDDL) pour le 14 mai, la question qui a animé les débats des éditorialistes comme des cercles familiaux se pose à nouveau : faut-il déloger les zadistes « illégaux » qui occupent les terrains qui appartiennent à l’État à NDDL ? Ce débat, polarisé par l’intervention violente des CRS pour « restaurer l’État de droit », oppose deux camps bien distincts autour d’une question centrale : la propriété, conçue tantôt comme un droit absolu du propriétaire sur sa chose, tantôt comme un droit relatif, nécessairement conditionné à l’usage qui en est fait et à sa possible convergence avec une certaine idée de l’intérêt général. Ainsi, les partisans des expulsions avancent que l’État fait un usage légitime de son droit de propriété en récupérant par la force la maîtrise de ces terrains dont il a le droit de jouir et disposer « de la manière la plus absolue », selon la formule consacrée de l’article 544 du Code Civil.
L’intervention dans la ZAD vise donc avant tout à défendre la propriété privée, et se justifie en outre par le fait que, si l’État, propriétaire par préemption des terrains, n’intervenait pas, cela créerait un dangereux précédent qui autoriserait tacitement tout un chacun à s’installer n’importe où et à réquisitionner tel ou tel autre terrain au prétexte de développer un nouveau projet de société. À l’appui de cette conception de la propriété privée, les défenseurs de l’ « ordre républicain » brandissent le spectre de l’anarchie généralisée, éventuellement doublé de la menace du : « cela pourrait aussi arriver dans votre jardin », afin de toucher la fibre propriétariste de leurs interlocuteurs.
Face à cet argumentaire, les partisans de la cause zadiste font valoir que le droit de propriété, loin d’être un droit naturel figé dans le marbre d’une table de loi immuable, est un droit conventionnel fondé sur l’usage, qui doit s’accorder avec l’intérêt général pour être légitime. Les usagers des terrains à NDDL, en raison des activités et des projets qu’ils ont développés depuis des années sur ces plaines, ont donc un droit à tout le moins à ne pas se faire déloger violemment, si ce n’est un droit à rester et à s’installer de manière durable. Et ce d’autant plus que les projets développés à NDDL proposent des alternatives à l’organisation dominante de l’agriculture et de la vie en communauté, et que ces projets contribuent à l’intérêt général en ouvrant des possibles qu’il sera sans doute utile d’explorer à terme. Pour trancher la question de la légitimité des expulsions, il ne s’agit donc pas, selon les partisans de la cause zadiste, de considérer ce que le droit de propriété est, mais ce qu’il devrait être, et sa convergence avec l’intérêt général.
L’opposition des deux camps ressemble ainsi à celle que Sophocle dépeignait dans son Antigone : les partisans de l’ordre clament que la loi de la Cité est de leur côté et qu’il s’agit de faire respecter la propriété privée, tandis que leurs opposant leur rétorquent qu’un droit supérieur les enjoint à défendre la ZAD et ses projets, un droit de propriété qui fait de l’usage utile à la collectivité le critère de l’allocation des ressources, et qui à ce titre fait primer le droit de ses occupants sur celui de l’État garant de la propriété.
Le véritable enjeu du droit de propriété n’est pas tant de savoir qui a la maîtrise du terrain que de savoir qui en est privé.
L’opposition entre ces deux conceptions de la propriété est d’autant plus intéressante qu’elle recoupe une distinction similaire dans le débat sur la légitimité de certaines colonies israéliennes déjà fort anciennes en Cisjordanie. Un contradicteur un tant soit peu taquin pourrait en effet rétorquer au défenseur de la ZAD : « avec de tels arguments, pourquoi ne défendez-vous pas similairement le droit des colons sur les territoires occupés ? Si c’est l’usage qui fonde la propriété, pourquoi les colons israéliens, installés depuis parfois plusieurs décennies, qui ont transformé le désert en terres habitables et cultivables n’ont-ils pas une revendication légitime sur ces terres ? » Est-il possible de défendre de manière cohérente un droit de propriété fondé sur l’usage dans le cas de la ZAD et le condamner quand il s’agit de colons israéliens ? La conclusion semble a priori être que non. Notons en passant qu’il y a un corollaire intéressant à cette proposition : ceux qui défendent le droit de propriété de l’État à NDDL devraient, en toute logique, également défendre le droit au retour des Palestiniens sur les terres occupées en violation de la législation internationale. N’étaient-ils pas les propriétaires légitimes avant que des colons israéliens ne viennent par leur usage revendiquer un droit sur terre ?
Mais ce contraste forcé, entre deux situations si différentes, fait apparaître à quel point l’opposition entre les partisans d’un droit de propriété absolu fondé sur un titre historique et les défenseurs du droit d’usage est simpliste et caricaturale. Trois considérations au minimum nous permettent de souligner les limites de cette façon de poser le débat qui nous enjoindrait de prendre parti pour l’un ou l’autre camp. Tout d’abord, on ne saurait comparer ces deux cas sans considérer d’une part leur histoire respective (infiniment plus complexe dans le cas des colonies israéliennes en Cisjordanie que dans le cas de NDDL) et surtout les perspectives de l’évolution du conflit liées à chacune des solutions proposées. On ne peut considérer les principes de manière abstraite en déniant leur inscription dans un contexte qui leur donne leur sens, et qu’ils influenceront en retour.
En second lieu, la comparaison des deux cas nous rappelle que le véritable enjeu du droit de propriété n’est pas tant de savoir qui a la maîtrise du terrain que de savoir qui en est privé. Le droit de propriété, dans son acception classique, est avant tout un droit d’exclure, autrement dit, un droit de priver autrui de l’accès à une ressource. La question de qui en est privé, et dans quelles conditions n’est évidemment pas anodine quand il s’agit de décider si l’usage qui est fait d’un titre de propriété est légitime ou non. C’est une chose (déjà contestable en soi) de s’approprier une source à côté d’une rivière qui garantit au tout-venant un accès à l’eau, c’en est une autre de s’approprier la seule source disponible au milieu du désert et d’en commercialiser l’eau. Penser la propriété en ne considérant que le droit du propriétaire indépendamment de ceux qui sont exclus de la ressource et de leur situation telle qu’elle est définie par un contexte plus large, c’est ne considérer qu’un aspect d’un problème éminemment plus complexe, car ne concernant pas le seul propriétaire, loin s’en faut.
La propriété n’est légitime qu’à la condition de promouvoir la liberté individuelle.
Enfin, et c’est sans doute ici le plus important, opposer la propriété comme droit absolu fondé sur un titre historique à une propriété légitimée par l’usage, c’est oublier la raison principale pour laquelle la propriété est une valeur centrale tant du libéralisme politique que du républicanisme. C’est oublier que la propriété n’est légitime qu’à la condition de promouvoir la liberté individuelle. Dans son récent ouvrage La propriété de soi, essai sur le sens de la liberté individuelle, le philosophe Jean-Fabien Spitz rappelle que « tout système de propriété est un choix social qui répartit des droit d’accès à des ressources indispensables pour mener une existence indépendante » (p. 29).
Si la propriété est issue d’une convention et n’est légitime qu’à la condition de promouvoir la liberté individuelle, toute la question est donc de trouver « comment la norme commune doit fixer les droits respectifs des individus les uns par rapport aux autres pour rendre possible l’autonomie de tous ». Dans cette optique, lorsque des conflits surgissent autour de la répartition des droits de propriété (comme dans le cas de la redistribution par exemple), Jean-Fabien Spitz, s’inspirant des travaux de Laura Underkuffler, soutient qu’on ne saurait trancher de tels désaccords sans recourir à « un argumentaire qui analyse la manière dont telle ou telle décision de répartition de ces droits promeut ou entrave la valeur de l’indépendance individuelle, qui demeure le fondement exclusif du droit d’appropriation privée » (p. 181).
En réinscrivant la question de la propriété dans son contexte, en considérant qui sont les exclus de l’appropriation, et en nous rappelant que la propriété des uns ne peut être légitime qu’à la condition de servir ultimement l’autonomie de tous, on réalise alors à quel point le parallèle entre NDDL et les colonies israéliennes en Cisjordanie est fallacieux. De plus, la méthode que propose Spitz pour résoudre les conflits autour de la propriété n’est que de peu d’utilité dans ce dernier cas, car elle suppose l’existence d’une communauté politique de type démocratique suffisamment apaisée pour considérer comment la propriété se met au service des revendications d’autonomie de tous les individus de manière égale, indistinctement de leur genre, origine ou conviction religieuse.
Quelle allocation des droits de propriété sur NDDL permettrait de servir au mieux l’autonomie de tous ?
Par contre, dans le cas de NDDL, la réintroduction dans l’analyse des trois éléments pointés ci-dessus nous permet de dépasser l’opposition binaire dont nous étions partis. Il s’agit en effet d’abord de souligner la nécessité de juger en contexte et de considérer les débouchés probables d’une expulsion ou d’une régularisation (ou d’une autre solution intermédiaire) avant d’y procéder. Se braquer sur un principe, que ce soit celui du droit de propriété absolu de l’État ou celui du droit d’usage des zadistes, indépendamment du contexte ne peut mener qu’à une impasse. L’injonction à choisir un camp est donc toxique. Elle mène à défendre la propriété dans l’une ou l’autre de ses acceptions et à prendre fait et cause pour l’un ou l’autre des camps en présence, sans possibilité de concessions ou de solutions intermédiaires fondées sur une conception qui ne soit pas monolithique de la propriété.
Il s’agit ensuite de considérer qui seront les exclus de la nouvelle allocation du terrain. Dans le cas d’une réappropriation totale par l’État, la réponse est évidente : les zadistes, qui ont développé à NDDL des projets sur lesquels s’appuient clairement leur revendication d’autonomie, seront les nouveaux exclus. Si à l’inverse l’État devait autoriser la continuation des projets de la ZAD, les seuls à pouvoir formuler une revendication déniée d’autonomie seraient les occupants historiques, déjà exclus il y a souvent plusieurs dizaines d’années lors de l’achat des terres en vue de la construction de l’aéroport (ce que dénote d’ailleurs lourdement l’usage de l’adjectif « historique » pour les distinguer des occupants actuels). Notons à ce sujet que quatre des agriculteurs dits « historiques », qui avaient été expulsés mais avaient continué à occuper leurs terres dans la ZAD, ont obtenu le 24 avril une réhabilitation sous la forme d’une convention d’occupation précaire courant jusque fin 2018.
Cela est bien entendu à prendre en considération si nous essayons de trancher le conflit en nous appuyant sur la méthode proposée par J.-F. Spitz, c’est-à-dire en nous demandant quelle allocation des droits de propriété sur NDDL permettrait de servir au mieux l’autonomie de tous ? En raisonnant de la sorte, il s’agirait d’évaluer chaque projet dans son contexte, d’examiner comment il promeut ou non l’autonomie des individus qui y participent (de même que de ceux qui n’y participent pas), et de considérer comment la perpétuation de chaque projet est susceptible d’aller à l’encontre ou non de l’autonomie d’autres individus, qui pourraient donc avoir une revendication légitime à ce que ce qu’il ne soit pas reconduit. Une telle méthode permet en outre d’éloigner le spectre de l’anarchie généralisée, puisque ce n’est pas n’importe quel projet sur n’importe quel terrain qui pourrait se voir reconnaitre un droit à l’expérimentation, mais seulement des projets qui servent l’autonomie individuelle et collective, et qui dans leur établissement ne nient pas ce même droit auprès d’autres individus ou collectifs.
Imagine-t-on l’État et le législateur ne reconnaître comme chauffeurs Uber que des chauffeurs ayant déjà une licence de taxi ?
Mais l’application de cette méthode suppose que l’État accepte le dialogue et reconnaisse que la propriété privée n’est pas la seule et unique forme d’organisation de la maîtrise sur les choses qui promeuve l’autonomie des individus. Comme ont cherché à le montrer les projets menés à NDDL, le principe du commun, tel que théorisé entre autres par Pierre Dardot et Christian Laval, peut fonder un projet émancipateur et s’articuler à une forme de vie en communauté fondée sur l’institution de règles communes au niveau local. L’ambition largement avouée de nombreux projets est d’ailleurs de montrer que des alternatives à l’organisation dominante de l’activité économique, fondée sur la propriété privée et la hiérarchie, existent et sont non seulement viables mais désirables.
Or, en conditionnant l’examen en vue d’une régularisation au dépôt d’un projet nominatif, l’État a concrètement usé de sa position dominante pour imposer sa propre conception de l’organisation économique et refuser le dialogue. Il s’agit bien entendu en partie d’un jeu de dupes, puisque les projets pourront s’inscrire dans un cadre juridique individualisé tout en conservant une pratique du commun que l’on peut difficilement proscrire dans les faits. Mais il demeure que par cette victoire, extorquée sous la menace des expulsions et ultimement fondée sur le droit du plus fort, l’État a refusé de reconnaitre que de tels projets collectifs puissent être légitimes. La violence physique à l’encontre des zadistes s’est donc doublée d’une violence symbolique encore bien plus grande, puisque, en acceptant de n’examiner que les projets nominatifs, l’État a obligé les porteurs de projet à renoncer à leur identité et à rentrer dans le modèle qu’ils entendaient précisément contester par leur pratique.
Conditionner la négociation à un reniement public des principes au fondement des projets menés à NDDL semble d’autant plus hypocrite que l’État a pu se montrer flexible dans d’autres cas, lorsque différentes startups ont de manière similaire entrepris de remettre en question le modèle dominant de l’activité économique telle qu’elle était opérée dans un secteur. Airbnb et Uber par exemple, ont assez aisément obtenu une régularisation de leur activité disruptive, qui avait commencé par se développer en dehors de l’emprise directe du législateur. On ne peut que difficilement imaginer les aberrations auxquelles on aurait assisté si l’État avait agi avec Airbnb et Uber comme il l’a fait avec les projets de NDDL : imagine-t-on le législateur accepter de n’examiner que les dossiers de propriétaires disposant d’une licence d’hôtellerie ? Ou de ne reconnaître comme chauffeurs Uber que des chauffeurs ayant déjà une licence de taxi ?
La différence de traitement entre Uber, Airbnb et ZAD donne à penser qu’il y a bel et bien deux poids deux mesures envers les entreprises « disruptives ».
Mais de telles hypothèses font sourire. Dans les cas de Uber ou d’Airbnb, ces ruptures avec le modèle dominant d’organisation économique ont été acceptées, sinon encouragées. Pourquoi dès lors ne pourrait-il en être de même avec les projets de la ZAD ? Et ce d’autant plus que ces derniers semblent plus aptes à promouvoir l’autonomie des individus en général et n’excluent a priori personne de leur activité, là où Airbnb et Uber marchent sur les plates-bandes des hôteliers et des chauffeurs de taxi, tout en ayant un effet relativement ambivalent et discutable sur l’autonomie réelle des individus.
Cette différence de traitement donne à penser qu’il y a bel et bien deux poids deux mesures envers les entreprises « disruptives ». Airbnb et Uber cherchent à faire un bénéfice en ponctionnant un travail qui échappe à l’impôt et à la régulation sociale, mais ne contestent pas les fondements ou la légitimité de l’économie de marché dans laquelle elles s’inscrivent, et s’en voient plébiscitées. À l’inverse, les projets menés à NDDL visent à montrer que d’autres manières d’organiser le travail et l’activité économique existent, sans pour autant contester la nécessité de la régulation et de leur inscription dans une structure étatique incontournable (parfois à leur plus grand dam), mais se voient adresser une fin de non-recevoir. Quant à l’objection classique qui consiste à dire que les projets menés à NDDL refuseraient de rentrer dans le cadre fixé par l’État car ils refuseraient en réalité de payer les impôts liés à leur activité économique réelle, il me semble d’une part qu’elle n’est pas entièrement fondée, et d’autre part qu’elle est neutralisée par le fait qu’on peut en dire exactement autant de bon nombre de startups « disruptives » comme Airbnb, Uber, Amazon, et compagnie.
À la contestation du droit de propriété classique que portaient les zadistes, l’État a choisi d’opposer un usage très concret de son droit d’exclure, illustrant ainsi de manière paroxystique le lien intrinsèque qui existe entre propriété privée, pouvoir d’exclure, et garantie de ce pouvoir par l’usage de la force. Les zadistes ont tenté de lui tenir tête, mais ont ainsi radicalisé leurs positions, et l’affrontement est devenu aussi binaire dans la ZAD que sur le terrain des idées.
Malgré l’apaisement sur le terrain (jusqu’au 14 mai du moins), l’opposition est plus polarisée que jamais, puisque l’État exige toujours que les projets soient soumis de manière nominative et nie symboliquement la valeur des alternatives développées dans la ZAD. Tout l’enjeu est à présent de tirer les leçons de l’Antigone de Sophocle et de dépasser cette opposition binaire, afin de ne pas persister dans l’entêtement tragique de chacun des deux camps, mais de plutôt repenser ce conflit sur la propriété en fonction de sa légitimation classique : sa capacité à promouvoir l’autonomie individuelle et collective.