Face au présent, une expérience utopique plus que jamais nécessaire
Notre présent est devenue promesse d’inhumanité. Dark times. Changement climatique qui annonce la catastrophe, migrations qui témoignent de la possibilité effective et toujours plus grande de laisser mourir, victoire des populismes droitiers en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, tout nous rappelle à la fragilité des idéaux conquis dans une longue histoire de luttes qui commence peut être avec la conquête de l’Amérique et la création d’un droit dit naturel pour tous les hommes par l’école de Salamanque et qui semble s’achever sous nos yeux. Le retour de l’eugénisme et d’une hiérarchie des individus dans l’imaginaire de l’homme augmenté, et voilà ceux qui pensent encore que l’humanisme mérite attention plongés dans un vrai cauchemar.
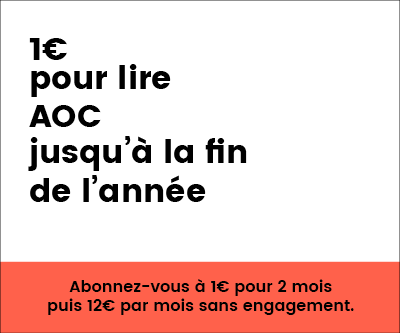
Mais ces dark times voisinent avec des savoirs d’une très grande qualité. Un nombre incroyable de chercheurs observent, réfléchissent avec une pensée aiguisée et une critique réelle, ce qui se passe au présent. Nous savons de ce fait, implicitement ou même explicitement, ce qu’il faudrait faire pour enrayer la crise climatique. Nous savons que le capitalisme tue les pauvres en Asie, les expulsent violemment des villes qui ont poussé avec la croissance échevelée, nous savons quelle solidarité municipale ou communale, voire même étatique, aurait permis de les aider à rester là où ils vivaient et à maintenir ainsi leur droit à l’existence, nous savons qu’il faudrait à nouveau contrôler le capitalisme par des règles rigoureuses si nous souhaitons plus de solidarité, plus de responsabilité, et nous savons que le droit renonçant à son hétéronomie fondatrice prend le chemin inverse.
Le train est lancé à grande vitesse mais personne n’active l’avertisseur d’incendie qui pourrait l’arrêter, car l’activer ce n’est pas juste savoir, c’est aussi agir.
Mais ce que les savoirs mettent au jour ne semble pas avoir de réelle influence. Pour parler à la manière de Walter Benjamin, le train est lancé à grande vitesse mais personne n’active l’avertisseur d’incendie qui pourrait l’arrêter, car l’activer ce n’est pas juste savoir, c’est aussi agir. Or ceux qui disposent des rênes du pouvoir agissent en sens inverse et si la société sécrète des modes de penser et de vivre alternatifs, cela reste toujours très circonscrit (les dites utopies concrètes) ou en puissance (vous allez voir les citoyens vont se réveiller), ou en rage d’impuissance (les réfugiés déboutés du droit d’asile rejoignent les sans-papiers, ils partagent une même colère).
Alors comment expliquer ce peu d’efficience des savoirs ? Il y a plusieurs pistes à suivre pour s’expliquer et peut-être remédier à cette situation où les savoirs semblent impuissants à enrayer la catastrophe, bien qu’ils nous aident à la contempler au fur et à mesure.
La première piste de réflexion doit chercher à comprendre la place actuelle du doute dans sa version hyperbolique : personne ne croit plus en la science ; ou plus exactement ceux qui y croient, l’assignent à un modèle scientiste contemporain pour qu’un gouvernement par les datas et les nombres valorise le capital. On tourne donc en rond. Mais quand on n’y croit plus, cela mérite attention.
La seconde piste doit analyser une méconnaissance de l’ordre des raisons entre savoir et action, entre philosophie et action, bref analyser la distance prise désormais depuis longtemps avec la philosophie de l’action. Les savoirs ne sont ainsi plus interrogés en termes de fins mais plus souvent en termes de qualités intrinsèques.
Enfin, les chercheurs sont eux-mêmes bombardés théoriquement et idéologiquement par une conception très fataliste de l’histoire. Loin d’être ce mixte de ce qui nous arrive et de ce qui arrive par nous, l’histoire semble n’être que ce qui nous arrive, que nous pouvons décrire mais que nous ne pourrions pas infléchir. Il y a là une rupture épistémologique non seulement avec les Lumières et son règne de la critique (Keith Becker, Reinhardt Koselleck) mais avec les années 1960 et 1970 où la raison dialectique (Sartre) n’avait pas encore été balayée par une pensée du « système », cette abstraction sur laquelle aucun individu ou même sujet collectif ne peut plus prétendre avoir prise (Foucault).
Or le propre de cette raison dialectique était de prétendre tenir ensemble l’analyse du présent et la tension vers le futur, le désir de façonner les possibles du futur. Pourtant, ce désir est devenu du côté des savoirs critiques, majoritairement non contemporain. Au moment où nous sommes bombardés de dystopies plus effrayantes les unes que les autres, ceux qui pourraient tenter de leur opposer des utopies trouvent l’exercice vain, le plus souvent.
Ce doute vient d’une mise à mal de la place des savoirs et de leur production en démocratie.
Reprenons.
Les sociétés démocratiques subissent non seulement l’épreuve du doute mais du doute hyperbolique qui s’exprime comme un doute antisystème ou anti-establishment. Plus rien ne tient, aucun savoir émis par les structures de savoir-pouvoir n’est plus considéré autrement que comme mensonger, ou intéressé. Quand il s’agit des experts économistes, un film comme le documentaire Inside jobs de Charles H. Ferguson montre que ce doute est fondé. Ceux qui ont causé la crise des sub-primes en 2008 savaient ce qu’ils faisaient et non seulement n’ont pas été sanctionnés, mais sont restés les conseillers du prince, l’objectif n’étant pas d’empêcher la crise mais de permettre des relances du capitalisme qui fonctionne par crises. Que les dégâts collatéraux soient énormes ne souffre pas de discussion, mais ce n’est pas le souci de ceux qui maximisent les profits. Ce rapport critique intuitif face aux usages de certains savoirs est donc juste.
Mais je pense que plus profondément, ce doute vient d’une mise à mal de la place des savoirs et de leur production en démocratie. Dans les sociétés démocratiques, ou qui avaient l’ambition de le devenir, l’accès gratuit aux savoirs comme biens spécifiques a toujours été préconisé non comme adjuvant mais comme fondement de l’esprit démocratique. Ainsi Condorcet comme politique et comme savant révolutionnaire (1792), plaidait pour la gratuité à tous les échelons de l’éducation, certes pour ne pas laisser dépérir des talents, mais aussi pour soustraire l’échange de savoirs à la sphère marchande et en faire un lieu de la dette sacrée de la société envers ses membres. Cet échange sacré se réalise alors sur le mode décrit par Marcel Mauss, dans son Essai sur le don, de l’échange kula, donc d’une manière cérémoniale et festive. Cet échange fait alors accéder chacun à une reconnaissance réciproque. Il fonde la possibilité même de concevoir l’égalité entre les êtres humains. Loin de l’utilité instrumentale, il relève d’une nécessité sociale : transmettre les manières d’être au monde social démocratique.
Il y a ainsi un nœud pour les démocraties entre fonction sacrée du savoir et consentement démocratique qui semble avoir été rompu de différentes manières dans les sociétés occidentales, soit en marchandisant explicitement les savoirs comme en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, soit en masquant cette marchandisation mais en excluant de fait ceux qui ne peuvent bénéficier d’un rattrapage en cas de défaillance scolaire, comme en France. Le doute hyperbolique pourrait bien ainsi, comme les bibliothèques qui brûlent analysées par Denis Merklen, faire signe d’une politicité des exclus de la promesse démocratique.
Le passé ne peut être interrogé que depuis le présent, mais cette interrogation est tendue vers un futur, celui de l’histoire qu’on agit en vue de façonner l’avenir.
La deuxième piste qui permettrait d’expliquer l’impuissance effective des sociétés contemporaines à faire usage de leurs savoirs, tiendrait, comme dit plus haut, à une méconnaissance de l’ordre des raisons entre savoir et action, entre philosophie et action. Si l’on prend deux philosophes aussi importants que Georges Canguilhem et Jean-Paul Sartre, nous constatons que, d’une manière totalement différente, ils affirment l’un et l’autre que la réflexivité ne peut venir comme acte de pensée que de l’analyse des actions de création, car toujours elles échouent en partie. Dans la langue de Canguilhem, le savoir scientifique n’existe que pour éclairer les achoppements de la technè, le désir infini de fabriquer et de créer, et non l’inverse. Dans celle de Sartre, la pensée fait retour sur la praxis et elles se nourrissent l’une l’autre d’un mouvement dialectique.
Or cette pensée des achoppements et cette dialectique ne sont pas arcboutées à un régime d’historicité présentiste, mais à un temps lui-même dialectique ; le passé ne peut être interrogé que depuis le présent, mais cette interrogation est tendue vers un futur, celui de l’histoire qu’on agit en vue de façonner l’avenir. Même si l’on sait que ce futur ne ressemblera pas à l’imaginaire que l’on en a, il est impossible de penser que ce n’est pas pour agir sur lui que l’on poursuit l’effort de la pensée. C’est dans un régime d’historicité qu’on appelle alors l’histoire chaude, celle qui cherche à résoudre des contradictions en vue d’une transformation-progrès, que cette pensée est articulée à l’action, pour la comprendre, pour l’infléchir, la corriger, penser des stratégies, des erreurs, etc. Mais pour autant cette pensée n’est pas béate dans l’idée d’un progrès inéluctable, loin de là. Elle est soucieuse de trouver des échappées d’émancipation et redoute les régressions à l’état de sérialité où les hommes redeviennent fondamentalement passifs.
A contrario, le régime d’historicité froid, où il s’agit de considérer que l’histoire est d’abord reproduction et qu’elle n’évolue que par sauts qui ne relèvent pas de l’action humaine, valorise une quête de savoir qui n’a plus d’ambition immédiatement articulée à l’action politique. Or ce régime de savoir domine aujourd’hui les sciences sociales. Il s’agit d’être modeste, c’est-à-dire sans ambition démesurée quant à l’action possible sur le monde. Notons que cette modestie ne se confond pas avec la prudence qui peut déboucher sur l’action prudente et efficiente. Cette modestie conduit à décrire le monde, à l’analyser mais sans vouloir nécessairement considérer que les savoirs peuvent jouer un rôle dans sa transformation.
De fait, le non-désir des savants eux mêmes à prendre part à l’action par leurs savoirs conduit ces derniers à ne pas critiquer leurs propres actions mais bien celles de leurs adversaires, ce qui peut paraître vain. En effet, cette critique étrange se fait au nom de normes qui ne sont pas celles des acteurs, qui de ce fait n’en ont cure, mais sans que ces normes soient activement défendues par l’action. Les objections et la délibération savante ne concerne donc plus les actions ou l’ajustement des pensées aux actions, à peine les objets mais plutôt les méthodes et les pertinences.
La pensée utopique n’est pas une promesse de salut, mais malgré tout, elle peut ne pas paraître complètement vaine en temps de crises.
Enfin, sans doute que comme tout autre segment du corps social, ce monde de la recherche est la proie d’un discours social que je qualifierais de fondamentalement dystopique. Dans ce discours social fait de films, de séries, de romans, de prédictions politiques catastrophistes, le futur n’est envisagé que pour décrire la catastrophe qui vient et l’ensemble des rapports sociaux détériorés qui vont s’en suivre. C’est plus que plausible, mais pas complètement déterminé à l’avance malgré tout car il s’agit d’une catastrophe qui touche l’équilibre de la nature mais n’est pas d’origine naturelle mais humaine donc politique.
On peut donc imaginer d’autres scenarii, d’autres sorties de crise, que Walking Dead et La Servante écarlate, on peut les imaginer en retournant les descriptions des chercheurs en sciences sociales comme des gants et offrir un envers de la situation historique. Car imaginer ne veut pas dire réaliser, mais fournir du carburant à une résistance qui s’ajusterait au fur et à mesure de son action résistante enfin encouragée. Les utopies permettent depuis qu’elles existent de traverser les temps de crises en imaginant des mondes tout autres. Il n’y avait pas chez Thomas More, en 1516, une prétention à voir son « Utopia » se réaliser, mais la réfléchir dans des discussions de cénacle permettait d’ouvrir avec ses amis des brèches dans la promesse négative de la tyrannie éternelle. Elle offrait un suspens aux routines de pensée, aussi sophistiquées soient ces routines. Le livre connut un succès immédiat et fut réédité à plusieurs reprises. Ce fut deux siècles plus tard l’un des livres les plus lus de la littérature européenne moderne pendant les Lumières.
Bref la pensée utopique n’est pas une promesse de salut, mais malgré tout, elle peut ne pas paraître complètement vaine en temps de crises. Si l’on se tourne vers un penseur de l’utopie comme Miguel Abensour : « Si l’on veut rechercher une spécificité de l’utopie et échapper à la platitude de la définition courante (…) il faut envisager l’utopie comme une expérience au sens fort du terme, qui instaure un nouveau rapport au monde, aux autres, à soi. Il s’agit de repenser les attitudes, les affects qui accompagnent ce choix, de percevoir dans l’utopie un processus dynamique, un mouvement qui consiste à se détacher de l’ordre établi pour se tourner, non vers un nouvel ordre, mais vers un nouvel être-au-monde, vers un nouvel être-ensemble, vers une nouvelle forme de communauté humaine. » Face au présent, l’expérience utopique est plus que jamais nécessaire.
Ce texte, commandé par AOC, est publié en prélude à La Nuit des idées, manifestation dédiée le 31/01/2019 au partage international des idées, initiée et coordonnée par l’INSTITUT FRANÇAIS. Toute la programmation en France et dans le monde sur lanuitdesidees.com.
