Pas de pouvoir sans consentement
QOT. Durant des siècles – en gros depuis le milieu du Moyen Âge –, ces trois lettres ont été une référence centrale de la pensée politique, des théories du pouvoir juste et des conceptions modernes de la représentation. Acronyme de la maxime latine Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet venue du droit civil et signifiant que ce qui concerne tout le monde doit être débattu et approuvé par tout le monde, elles ont progressivement signifié l’obligation pour tout pouvoir d’obtenir le consentement de ceux sur qui il prétend exercer une autorité légitime.
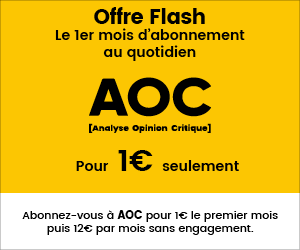
Ce principe s’est ainsi imposé dans l’Église médiévale – dans les grands conciles qui prétendirent brider le pouvoir pontifical ou dans certains ordres religieux, par exemple – mais aussi au sein de pouvoirs séculiers qui cherchèrent, notamment pour les questions fiscales, à obtenir le consentement des sujets. Cette nécessité du consentement fut ainsi le fondement des assemblées représentatives modernes – parlements, États provinciaux ou généraux, diètes diverses – qui surent l’invoquer contre les exigences excessives des souverains et en faire un outil efficace de négociation.
C’est ce principe majeur de l’histoire politique occidentale – et de l’histoire de l’invention de l’impôt direct permanent – que la révolte des « gilets jaunes » est venu rappeler de manière spectaculaire, rendant inopérantes ou sans objet les catégories étroites dans lesquelles on a cherché initialement à l’enfermer. Jacquerie, révolte antifiscale d’Ancien Régime, révolte de modernes canuts restés pauvres malgré leur travail et condamnés à observer de loin la prospérité insolente de ceux-là mêmes qui les condamnent au dénuement, dégagisme et rejet des aristocraties scolaires et électives que la République façonne sans remords, exaltation d’un peuple souverain mais incertain : leur révolte n’est rien de cela et pourtant un peu de tout cela à la fois.
L’effet de sidération qu’elle a exercé sur le pouvoir tient sans doute à ce mélange instable, dont nul ne peut prétendre connaître l’issue, et à ce que celui-ci révèle de l’érosion flagrante du consentement citoyen à ce que l’on présente traditionnellement comme les fondements de la République : les institutions représentatives – et leurs élus – mais aussi l’impôt.
Peut-on, comme le faisaient les rois de France, considérer que le consentement des citoyens ou des sujets est donné une fois pour toutes et qu’il n’est nul besoin de le solliciter effectivement et régulièrement sur des enjeux qui concernent tout un chacun ?
Il n’y a donc pas lieu de s’étonner du passage d’une protestation contre la pression fiscale –qui aurait marqué les premières semaines du mouvement – à une revendication politique plus large lors des dernières semaines, notamment autour du référendum d’initiative citoyenne (RIC). L’une et l’autre ont partie liée et posent in fine le même type de question. Peut-il y avoir pouvoir et exercice légitime du pouvoir dans la durée sans consentement de ceux sur qui ils s’exercent, notamment dès lors qu’il s’agit de fiscalité ? Peut-on, comme le faisaient les rois de France et leur thuriféraires, à partir des XVe et XVIe siècles, considérer que le consentement des citoyens ou des sujets est donné une fois pour toutes et qu’il n’est nul besoin de le solliciter effectivement et régulièrement sur des enjeux qui concernent tout un chacun ? Que le sacre à Reims ou l’élection présidentielle tous les cinq ans valent consentement total et définitif et qu’il ne peut être question d’y revenir, au risque de menacer la stabilité des institutions ?
Le quinquennat et l’inversion du calendrier parlementaire (loi constitutionnelle n°2000-964 du 2 octobre 2000), qui assurent depuis 2002 au président de la République une majorité confortable à l’Assemblée nationale (majorité absolue pour l’UMP en 2002 et 2007, pour le PS en 2012, pour LREM en 2017), ont joué ici le rôle d’un détonateur, dont on peut mesurer aujourd’hui les effets explosifs. Non seulement ils ont accéléré et accentué la présidentialisation du régime – sans édifier un système renforcé de contrepoids institutionnels, comme le montre le sort piteux du dispositif de référendum d’initiative populaire, jamais activé – mais ils ont également contribué au discrédit de la représentation nationale – quel que soit l’engagement des députés eux-mêmes – en faisant, au fond, des législatives la confirmation de l’élection présidentielle et de l’Assemblée un rouage du pouvoir majoritaire peu à peu dépossédé de véritable marge de manœuvre. Le Sénat y a gagné une place inattendue, mais marginale, de lieu d’expression de certaines oppositions. Les projets récents de réforme constitutionnelle visant à réduire les prérogatives déjà maigres de la représentation nationale s’inscrivent dans cette perspective, aux relents antiparlementaires à peine voilés chez certains : à quoi bon débattre, puisque le résultat semble connu d’avance ?
Pour nombre de citoyens, le nouveau calendrier électoral et la magie tout à fait singulière du scrutin majoritaire uninominal à deux tours, qui offre au parti présidentiel une majorité large et parfois sans rapport avec son poids réel dans l’opinion publique, ont donc donné naissance à une Chambre introuvable. Ils ne s’y reconnaissent pas et estiment ne pas y être représentés ou entendus, ou l’être bien mal, à la fois parce que sociologiquement les députés ne leur ressemblent pas plus aujourd’hui qu’hier (malgré la quasi-parité) et parce que les différentes sensibilités politiques y disposent d’un nombre de sièges éloigné de leur score électoral.
Pas certain que les citoyens se contentent de cette citoyenneté intermittente, de ce consentement presque forcé qu’on leur demande à échéance fixe.
Il n’est pas certain que s’interroger longuement sur le faible pourcentage de députés qu’il faudrait élire à la proportionnelle – et donc selon une règle électorale différente des autres et avec une représentativité tout aussi discutable – soit de nature à répondre aux exigences de démocratie, de transparence, de justice et de dialogue qui s’expriment aujourd’hui. Pas certain non plus que les citoyens qui disent en nombre croissant ne pas se sentir représentés, ne pas avoir confiance dans leurs élus et ne pas être intéressés par la politique telle qu’elle se fait aujourd’hui puissent trouver suffisant qu’on leur demande de consentir au pouvoir et à la reproduction sociale des élites une fois tous les cinq ans, sans autre possibilité de s’exprimer et de manifester leur désarroi ou leur mécontentement que lors des élections, élections que le pouvoir lui-même décrit comme sans rapport avec sa politique ou sans enjeu national. Ou qu’ils acceptent sans broncher de voir des pans entiers de la chose publique, de ce qui nous concerne tous, progressivement mis hors de portée du suffrage populaire, comme l’ont montré le référendum de 2005 et les leçons que les gouvernements ont choisi de ne pas en tirer. Ou qu’ils se contentent de cette citoyenneté intermittente, de ce consentement presque forcé qu’on leur demande à échéance fixe, comme en 2017, lorsque plus de la moitié des électeurs furent obligés au second tour de la présidentielle de voter pour des candidats dont ils ne voulaient pas.
À sa manière, clivante et ici clairement menaçante, Nicolas Sarkozy avait senti se précipiter et se mélanger désarroi social et désenchantement démocratique, en apportant à ce mouvement de fond la réponse la plus malavisée et périlleuse qu’il était possible d’imaginer. Dans un discours de 2016, en pleine course à la primaire de la droite pour l’élection présidentielle, il s’était présenté en porte-parole de ceux qui « souffrent de ne pas être entendus et pas représentés » et avait décidé, pour cela, d’annoncer la fin de la « tyrannie des minorités ».
La revendication reste la même : en finir avec la double confiscation de l’exercice du pouvoir dans les mains d’un parti et d’élites politiques.
C’est pourtant bien le principe majoritaire lui-même et le poids exceptionnel que lui confère le fonctionnement des institutions françaises que l’on retrouve au cœur des revendications des dernières semaines et des demandes de renouveau démocratique. Qu’il s’agisse d’introduire une dose cette fois significative de proportionnelle, d’instaurer un référendum révocatoire, de promouvoir le référendum d’initiative citoyenne, de prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale pour voter à nouveau et rétablir une sorte de midterm elections, de faire du Conseil économique, social et environnemental (CESE) une véritable assemblée citoyenne sociologiquement plus représentative grâce au tirage au sort, de multiplier les jurys citoyens et les budgets participatifs, la revendication reste la même : en finir avec la double confiscation de l’exercice du pouvoir dans les mains d’un parti – quand bien même il dirait être fait d’un autre bois que les anciennes formations politiques – et d’élites politiques que les nouvelles règles de cumul des mandats n’empêchent pas de se perpétuer, comme les stratégies de survie au long cours des maires de quelques grandes villes viennent de le rappeler.
Peut-être faut-il revenir alors à l’un des autres grands principes de la pensée politique moderne, forgé au cours du XVIe siècle et dont nous sommes en partie les héritiers : tout pouvoir repose sur un contrat puisque la société politique est d’origine humaine et non divine. Les parties contractantes, le prince et le peuple par exemple, s’obligent donc mutuellement. Les protestants français du temps des guerres de religion prirent appui sur ce principe pour refuser de courber l’échine sous des rois persécuteurs et faire le choix de résister aux pouvoirs qui ne tenaient pas leurs promesses de protection et de justice pour tous. Il est aujourd’hui illusoire de penser que l’on peut indéfiniment compter sur le consentement résigné de ceux à qui l’on promet, beaucoup ou un peu, avec l’intention de ne pas se sentir lié par ce contrat tacite. « Les promesses engagent ceux qui les reçoivent », dit-on. Le mouvement actuel porte au jour les conséquences de cette tradition du cynisme politique.
