Empathie, bons sentiments et mauvaise politique
Plus de trois semaines après le démarrage de la crise des Gilets Jaunes, tandis que cette dernière ne cessait de s’amplifier, nombreux furent ceux qui lancèrent des appels pressants au Président de la République, l’enjoignant de prendre la parole. Ecoutons-les et nous entendrons alors une curieuse musique dont l’un des refrains essentiels est construit autour de la notion d’« empathie ».
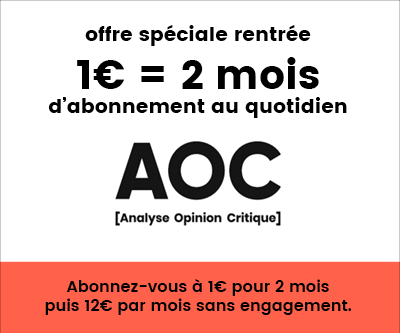
Les Français attendent du président Macron un « discours d’empathie » face à leurs difficultés, estimait ainsi le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger. Emmanuel Macron doit « tenir un discours d’autorité, mais aussi de compréhension, d’empathie », affirmait Alain Juppé. « Nous avons réclamé ce dialogue et cette empathie à l’égard des élus locaux, qui peut largement contribuer à l’unité nationale », expliquait un autre ténor de la droite. Bien des journalistes reprirent également en chœur ce refrain de l’empathie. Avant son discours, pour mieux le saluer après ! On interrogea des citoyens qui à leur tour reprirent la ritournelle : pour Sabine par exemple, « il a fait un très bon discours. Il y avait de l’empathie. ».
Simple coïncidence ? Voire phénomène de mode sémantique dont le paysage politique et médiatique est coutumier et qui ne mérite pas que l’on s’y arrête ? Pourtant qui peut croire que les mots seraient à ne pas prendre au sérieux ? Surtout lorsque l’on parle de politique. Essayons donc de saisir quelles pourraient être les raisons de ce soudain engouement pour l’empathie de la part d’un certain nombre d’acteurs et de commentateurs politiques – cette « faculté intuitive de se mettre à la place d’autrui, de percevoir ce qu’il ressent » (Dictionnaire Larousse). Nous verrons que l’on peut en identifier plusieurs, de natures assez différentes, mais surtout que l’empathie du président de la République, n’est ni une condition suffisante, ni une condition nécessaire de la résolution de la crise que traverse notre pays.
L’empathie comme antidote au mépris ou vocabulaire de la « start-up nation » ?
L’explication la plus simple – celle qu’avanceraient probablement, si on les interrogeait, la plupart de ceux qui utilisèrent ainsi ce terme – consiste à souligner qu’il n’y aurait là qu’un appel à une rectification nécessaire de l’image d’« arrogance » et de « mépris » que le Président de la République renvoie. Cette dimension de sa personnalité s’est en effet assez rapidement dessinée, à coup de petites phrases, comme celles sur « ceux qui ne sont rien » versus « les premiers de cordées » ou les « jaloux », les « fainéants », ceux « qui n’ont qu’à travailler pour s’acheter un costard », ceux « qui foutent le bordel au lieu de chercher du travail », les « illettrés »… Cette image négative est aussi probablement le prix qu’il paye pour avoir construit l’image d’une personnalité « exceptionnelle » et théorisé, revendiqué et mis en scène la « verticalité ». Comme nous l’écrivions dès mars dernier (voir cet article), les Français sont rapidement passés « De la sidération à la saturation » et « le moment de bascule, où les images s’inversent et où la face sombre de Janus se dessine, sembl[ait] atteint : celui de la déception, du désamour ou de la colère. »
Une autre explication se dessine toutefois lorsque l’on constate que cette notion est désormais adoptée par de nombreux spécialistes des RH et du coaching en entreprise, liée à celle des « compétences émotionnelles » (ou « soft skills »). Ainsi, une enquête récente, réalisée auprès de 450 responsables RH, nous apprenait-elle que pour plus de la moitié des recruteurs, les « compétences émotionnelles » constituent un critère déterminant dans l’embauche d’un candidat ; l’ « adaptabilité » et l’ « agilité » apparaissent comme les compétences les plus importantes, devant l’ « esprit d’équipe » et la « rigueur et l’organisation », « la motivation /passion », suivie par … l’empathie. Pôle Emploi considérait une telle information comme suffisamment importante pour la reprendre dans sa communication officielle, via un tweet « @pole_emploi : [#compétences] Esprit d’équipe et empathie parmi les #softskills préférées des recruteurs (@MonsterFrance) via @EchosStart #recrutement » (voir cet article). C’est vous dire si la chose est sérieuse… On pourrait alors penser que l’irruption de cette notion dans le paysage politique actuel ne serait que l’un des aspects de l’invasion des termes qui sont ceux de l’entreprise, de la gestion et des RH, dans le vocabulaire politique, invasion caractéristique du « nouveau monde », celui de la « start-up nation » d’Emmanuel Macron.
Toutefois, s’arrêter-là, reviendrait à négliger un phénomène beaucoup plus général et probablement bien plus important : celui de l’omniprésence actuelle des émotions dans le champ politique et dans son analyse.
Le retour des émotions
N’a-t-on pas vu en effet ces dernières années, les notions de pessimisme et d’optimisme, de défiance[1], sans même parler de la confiance, occuper le premier plan dans de multiples sondages et études d’opinion, mais également de travaux de recherche ? Au lendemain de l’élection présidentielle, de nombreuses analyses n’ont-elles pas fleuri, qui interprétaient le vote pour Emmanuel Macron comme celui de l’ « optimisme » et du « bien-être » des « gagnants de la mondialisation », quand celui du vote FN, serait celui du « mal-être » et du pessimisme », celui non plus « des classes populaires mais des classes malheureuses » (voir cette étude) ?
Et cet appel à l’empathie, n’est-elle pas d’ailleurs la réponse attendue à une « colère », « colère profonde » et « qui vient de loin » pour reprendre les termes même qu’utilisa Emmanuel Macron dans les deux discours qu’il prononça en réponse à la crise des Gilets Jaunes. A une émotion, seule une émotion peut répondre.
Reste dès lors à expliquer cette omniprésence des émotions. On peut probablement y voir la traduction, dans le champ politique, d’un phénomène bien plus général : leur retour dans le paysage intellectuel et scientifique. Bien sûr, les émotions n’y ont jamais été totalement absentes, mais depuis plusieurs décennies, on les a vu retrouver une place qu’elles paraissaient avoir cédée dans un certain nombre de disciplines, et notamment dans l’analyse du monde social, économique et politique, l’empathie prenant alors place en leur sein.[2]
Les racines d’un tel mouvement sont multiples. Ce n’est pas ici le lieu d’en faire l’analyse. Comment toutefois ne pas mentionner la montée en puissance des neurosciences ? Ces dernières ont en particulier accordé une place centrale à l’empathie. De multiples travaux scientifiques, utilisant notamment les techniques d’imagerie cérébrale fonctionnelle, ont en effet mis en évidence le fait que, lorsqu’un individu perçoit autrui dans une situation douloureuse, cela active chez lui certaines régions impliquées dans le traitement de la douleur physique. Un tel mécanisme, en déclenchant une inhibition des comportements agressifs, reposant sur le fait que la détresse des autres est ressentie comme un stimulus aversif et que nous apprenions donc à éviter les actions qui lui sont associées [3], jouerait pour certains auteurs un rôle majeur dans le développement du raisonnement moral [4].
Ou une histoire politique ?
Toutefois, si l’on se souvient que, jusqu’à la Révolution française, le terme d’« émotions » avait une toute autre signification et désignait également les soulèvements populaires, caractérisés par leur dimension soudaine et de courte durée, leur apparente inorganisation et leur violence,[5] on peut alors voir dans cet appel à l’empathie une origine bien différente.
Notre époque se caractérise en effet, par la violence des transformations qu’elle subit, par l’ampleur des défis qu’elle se doit d’affronter et par les craintes et les peurs que tout cela génère[6]. Et face à la violence et à la profondeur de ces transformations, le nombre de ceux qui ont le sentiment qu’il n’y a ni réponse, ni solution politique s’accroît, venant gonfler les bataillons du vote protestataire et de l’extrême droite, ainsi que les diverses formes de néo-populismes, ou de refus de participation à la vie politique via l’abstention. Tant qu’aucune offre politique convaincante ne semble se dessiner aux yeux de nos concitoyens, la crise démocratique ne peut que se sur-ajouter aux autres bouleversements de l’époque. Et les passions et les émotions mener la marche du monde. La rationalité et l’argumentation cèdent progressivement le terrain. Dynamique renforcée, on le sait par le rôle des réseaux sociaux et des évolutions médiatiques qui génère un flux continu et de plus en plus rapide d’informations non filtrées et contestant toute expertise.
Du même coup, face à des individus menés par les émotions et les passions, au premier chef d’entre elle la colère, pour pouvoir gouverner, la première condition ne serait-elle pas alors d’avoir cette « faculté intuitive de se mettre à la place d’autrui, de percevoir ce qu’il ressent » ? Dans des temps troublés, pas de politique, sans empathie !
Deux revendications majeures, face auxquelles l’empathie est impuissante !
En rester là serait toutefois une grave erreur politique. On le sait, on ne fait pas de la politique avec des sentiments !
Et en effet, il y a dans le mouvement des Gilets Jaunes, deux revendications majeures d’ordre politique que l’empathie ne saurait en aucun cas satisfaire. Et elle n’est ni une condition suffisante de résolution de la crise, ni une condition nécessaire d’ailleurs.
En effet, comme l’a curieusement admis le président de la République lui-même, lorsqu’il s’est finalement adressé aux Gilets Jaunes, la colère qui s’est ainsi exprimée est « juste ». Et, certes – c’est même probablement l’une des principales caractéristique de ce mouvement –, ses revendications sont diverses, voire contradictoires, et il est porteur du meilleur comme du pire ; toutefois deux éléments se dégagent nettement, ainsi que l’ont montré toutes les premières enquêtes de terrain qui lui ont déjà été consacrées.
En premier lieu, la défiance qu’expriment nombre de ceux qui se sont mobilisés, à l’égard non seulement du président de la République et de son gouvernement, mais, au-delà, vis-à-vis de toute représentation politique nationale, des partis et des syndicats, correspond aussi pour beaucoup à une demande de renouveau démocratique et à une volonté de se redonner des représentants dans lesquels ils se reconnaissent. La place majeure prise désormais par le débat sur le référendum d’initiative citoyenne et par les discussions sur les constitutions de liste pour les élections européennes en attestent. Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle avait d’ailleurs, comme beaucoup, bien identifié ces ressorts de la crise démocratique que traverse notre pays ; et dans sa promesse du soi-disant « nouveau monde », il avait fait du renouvellement des élus un élément essentiel de son action.
Mais, les travaux l’ont montré, la réalité a été bien différente et les nouveaux élus de LREM, n’ont pas reflété la société française dans toute sa diversité, et ont surtout pris les visages des catégories aisées et des cadres et dirigeants du privé (voir notamment l’enquête de Luc Rouban). Et, par cette promesse une nouvelle fois déçue, Emmanuel Macron a donc aggravée la crise démocratique. Sa responsabilité est d’autant plus lourde que ce point s’intègre dans une stratégie plus générale, consistant à jouer de manière très ambiguë sur une vague populiste – via des déclarations « anti-systèmes », des dénonciations des vieux appareils politiques, des syndicats et de tous les corps constitués comme autant de forces d’inertie et de conservatisme, des attaques répétées contre les médias ; et, loin de la résoudre, ne faisant finalement que l’amplifier.
En second lieu, si le mouvement a démarré sur la question des taxes sur les carburants, il est apparu très rapidement qu’au-delà, l’autre grande revendication du mouvement était celle du pouvoir d’achat et celle plus générale et plus politique encore (dans la mesure où elle engage non seulement la situation de chacun, mais celle de tous) de justice sociale. Cette très forte demande de justice sociale est même probablement la principale, dans la mesure où elle détermine en grande part la première, reposant sur un argument plus ou moins implicite selon lequel, « si les politiques menées sont incapables d’assurer la justice sociale, c’est parce que nos élus ne nous représentent pas, car ils ne viennent pas de nos rangs ». Ce retour de la « question sociale » plonge ses racines à la fois dans la violence des conséquences économiques et sociales de la crise de la fin des années 2000, mais également dans un chômage élevé depuis des décennies (et dont la baisse ne masque guère un « halo » qui lui n’a eu de cesse de s’accroître, générant autant de situation de difficultés économiques et de précarité sociale), ainsi que dans un renouveau des inégalités.
Le renouveau des inégalités
Ce dernier n’est certes pas propre au quinquennat d’Emmanuel Macron et on l’observe depuis maintenant plusieurs décennies ; il dépasse en outre largement le cadre national et le modèle social français a même au contraire plutôt permis d’en limiter certaines conséquences. Toutefois, la reprise économique que l’on constate depuis 2016 l’a rendu plus insupportable encore pour les plus défavorisées, dans la mesure où ils ne bénéficient pas de cette dernière. Mais surtout la situation a été fortement aggravée par l’injustice de la politique économique et fiscale d’Emmanuel Macron qui est rapidement apparue dans toute sa violence, avec notamment des mesures comme la suppression de l’ISF, de l’exit-tax et l’introduction de la flat-tax.
Et, s’il est vrai que les inégalités prennent aujourd’hui des formes multiples, étant à la fois économiques et sociales, mais aussi territoriales, créées par des discriminations liées au sexe, à l’origine ou à la religion, ce qui rend plus complexe les revendications qu’elles génèrent et les offres politiques susceptibles d’y répondre, comme le souligne à juste titre François Dubet (voir cet article publié dans AOC). Il n’en reste pas moins que la structuration sociale est loin de s’être dissoute dans cette multiplicité des inégalités et que les mécanismes de reproduction paraissent plus forts que jamais. L’ascenseur social est de plus en plus bloqué, avec un rôle central joué ici dans le mécanisme de la reproduction sociale par le système scolaire et surtout par celui de l’enseignement supérieur (voir cet article). Reproduction d’autant plus insupportable pour ceux qui en sont les victimes, que le discours sur « l’égalité des chances », renforcé par la sacro-sainte notion de « mérite », leur font porter toute la responsabilité de leur situation. Et si François Dubet a probablement raison de souligner les limites que la multiplicité des inégalités impose à la notion de classes sociales – y compris dans leur acception bourdieusienne –, il n’en reste pas moins que la crise politique majeure que nous traversons – et qui secoue, sous des formes différentes, l’ensemble des pays européens et occidentaux- est venue remettre au premier plan de l’agenda politique la dénonciation de ces mécanismes et de leur injustice.
Ni empathie, ni sympathie, mais une autre politique !
Et face à ces deux questions politiques majeures, l’empathie ne peut rien. Ce qui est fondamentalement reproché à Emmanuel Macron n’est pas d’être incapable « de se mettre à la place d’autrui, de percevoir ce qu’il ressent », mais de mener une politique qui ne traite pas plus la question de l’injustice sociale, qu’elle n’apporte de solution à la question démocratique, vue comme une condition de résolution de la première. La réelle demande qui lui est adressée, tant par les Gilets Jaunes que par nos concitoyens qui les soutiennent depuis le début, n’est donc pas celle de l’empathie.
Notons d’ailleurs qu’en toute rigueur, l’empathie peut ne pas être dirigée vers le bien-être d’autrui et que faire acte de cruauté requiert une capacité empathique pour connaître le ressenti, en l’occurrence la souffrance, d’autrui afin d’en tirer un plaisir ; s’agissant du président de la République, on pourrait même craindre son empathie, puisqu’il pourrait l’utiliser afin de faire passer plus efficacement une politique injuste et inefficace !
On ne lui demande donc pas d’être empathique. Pas plus qu’on ne lui demande d’ailleurs d’être « sympathique »[7] ! On lui demande une autre politique ! Mais cette autre politique qui réponde à la fois aux questions de renouveau démocratique et de justice sociale, c’est en réalité la gauche qui en est détentrice. Une gauche qui doit d’urgence sortir de ses divisions délétères et de ses querelles de chapelles et d’egos, afin d’apporter à nouveau la preuve à nos concitoyens qu’elle peut avoir une ambition plus grande que celle d’une simple logique d’accompagnement ou d’atténuation. Qu’elle peut être cette force de transformation qui, par des politiques publiques fondées sur la régulation, la redistribution, le dialogue social et la démocratie, peut dessiner un destin collectif désirable pour tous et pour chacun et faire face aux multiples défis et en premier lieu à la grande question politique de l’époque, l’environnement et le climat.
