Université, sombre bilan
Depuis des décennies, l’enseignement supérieur partage avec la recherche la joie et le privilège de faire l’objet de déclarations d’amour enflammées de la part de tous les gouvernements et du (ou de la) ministre en charge du secteur, à chaque fois que reviennent les discussions budgétaires. Pourtant, dans un article publié ici, et dédié aux financements de la recherche française (ou à son sous-financement, devrions-nous dire), nous avons montré qu’entre les déclarations d’amour et les preuves d’amour, la distance est immense, concluant ainsi tristement notre texte : « bien sûr, le président de la République, ses Ministres et ses soutiens peuvent toujours trouver des chiffres qui permettent de masquer la triste réalité des laboratoires de recherche et du quotidien des chercheurs (…). Certains peuvent les croire comme d’autres peuvent toujours rêver d’amour, quand ils n’en ont que les promesses… »[1]
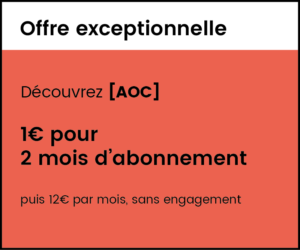
Qu’en est-il pour l’université et l’enseignement supérieur ? Sont-ils soumis aux mêmes effrois des promesses sans lendemain ou bénéficient-ils d’un véritable engagement ?
La question est loin d’être anecdotique car, comme pour la recherche, les arguments qui plaident en faveur d’un tel engagement sont multiples et solides, souvent consensuels, tant dans le milieu politique que parmi les économistes. Allons vite, vous les connaissez et vous les avez mille fois entendus. Puisque ce secteur concerne au premier plan la jeunesse, il ne s’agit donc pas moins que de l’avenir de notre pays. Et si certains soulignent qu’assurer la transition écologique et la transformation de notre modèle de consommation et de production nécessite des compétences et des qualifications nouvelles, d’autres notent son rôle majeur dans le dynamisme économique, la compétitivité et l’emploi ou mettent en lumière les conséquences sur le travail de la révolution technologique et la polarisation du marché du travail.
Pour les uns, le rayonnement international de notre pays est en jeu, quand d’autres rappe
