Bauhaus revival – 100 ans et après
À la preuve par la monstration et l’épaisseur, nous avons préféré nous intéresser au mélange, au fragment. Aussi, avons-nous contribué par un livre – staatliche bauhaus cent pour cent 1919-2019 – réunissant les courts textes de 36 chercheurs s’attachant à « prélever » ce qui n’aura pas été suffisamment regardé, étudié, discuté. Faire mouche. Artistes, designers et théoriciens rapprochent des images d’archives, des faits « souterrains » avec la précision que permet l’incise d’un texte bref. La volonté n’est pas la complétude, or la rigueur de l’aperçu fragmentaire contrebalance la célébration. La description et les interrogations posées par « touches » et « bribes » dessinent aussi un paysage contemporain.
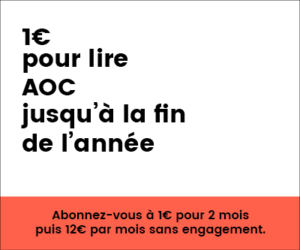
Ce faisant on y comprend ce dont le design n’est pas exempt : l’ambiguïté sur la place des femmes au bauhaus, par exemple, est un sujet. Elle occupe une position centrale dans la mini-série diffusée sur arte en septembre dernier et d’une autre manière dans l’ouvrage sus-cité. C’est un « révélateur » de poids : les étudiantes des écoles de design forment souvent 70 à 80% des effectifs. Que deviennent-elles ? Où brillent-elles ? Elles travaillent donc. Mais où ? La série allemande en fait le « nœud » d’une intrigue sans relief – n’est pas Céline Sciamma qui veut – et rate le coche que nous souhaitions interroger sur ce qui rapporte le bauhaus à notre moment. Mais ce qui auparavant nous fait buter et explique le recours au bauhaus, c’est la France.
Le design en France n’a pas d’histoire
La France est satisfaite de compter dans ses rangs d’illustres figures : des designers médiatiques (de Starck aux Bouroullec…), une triade de créateurs iconiques (Paulin-Tallon-Mourgue), des pionniers modernes, dont l’une (Charlotte Perriand) est actuellement célébrée à la fondation Louis Vuitton encore en ascension au firmament des côtes mobilières (Saint Baudrillard de l’économie politique du signe, priez pour nous). Assurément des talents, des œuvres brillant comme des joyaux… Bref, un design qui tendrait à « se patrimonialiser ».
Le bauhaus n’aura cessé de le faire cette année avec force grands titres et « baselines » alléchantes – en particulier autour de « ses » femmes oubliées – visant les retombées économiques d’usage du tourisme culturel. Si l’on file cette métaphore, avec la même médiocrité de ton, nous pourrions avancer que le design, les arts décoratifs sont potentiellement en France, la « danseuse » qui orne l’histoire de l’art comme celle de l’architecture ; les deux diamants-poires disparus du Maharadja d’Indore dont le palais moderne fut dessiné par un certain Erckhart Muthesius, fils d’Hermann, cheville ouvrière essentielle vers le bauhaus.
Il y a un mystère, à nos yeux plus précieux encore que les bijoux de la couronne, sur le fait qu’il n’y aurait pas, en France, une histoire du design concrètement constituée comme en Angleterre, aux États-Unis ou même en Italie. « Y aurait-il des designers mais pas de design en France ? » est une hypothèse théorique qui permet de soulever quelques pierres d’achoppement.
À la question d’un design sans histoire, postulons que l’ « allant » moderne qui aura porté au cours des XIXe et XXe siècles le développement du design en France n’aura pas totalement dérogé à l’ « élan » baudelairien, retenu comme originel et « légitime ». En somme, chaque courant moderniste naissant semble implicitement arrimé à une nouvelle pensée (ouvertement ou non) comme délibérément fugitive, transitoire – Baudelaire même. Rien émanant du nouveau ne serait réellement appelé à durer, à perdurer.
Henry Cole, père putatif du design industriel et de la première exposition universelle de 1851, s’inspira pourtant des français qui, dès la fin de la Révolution, inaugurent un modèle d’exposition festif et couru des étrangers, destiné à écouler les produits détaxés des anciennes manufactures royales. Il justifia ainsi l’emprunt du modèle : « En France, une exposition internationale était une théorie philosophique, et ne pouvait que rester un sujet de conversation, jusqu’à ce qu’elle modifiât ses tarifs commerciaux » (citation tirée de l’ouvrage dirigé par L. Prubrick).
Baudelaire aurait-il été l’instigateur d’une modernité sans progrès, et symétriquement sans projet –fondamentalement hostile au mariage des arts, des techniques ainsi qu’au libre-échange – se refusant à ce à quoi, cependant, elle tend ? Nous pensons symptomatique, la manière dont le « moderne », et corrélativement, le design comme champ et discipline, auront agi et été considérés : y aurait-il eu, spécifiquement en France, du « moderne sans modernité » ? (« rejouant » différemment la formule du philosophe Pierre-Damien Huyghe). Ce mal repéré d’un design sans histoire, relèverait-il en partie d’un « syndrome baudelairien » à l’endroit précisément de l’accueil de la modernité prioritairement esthétique (surgissement du nouveau), qui ferait prévaloir le saut, le « sursaut » (de vie) créatif, dirait Georges Bataille, sur l’assaut de toute forme et expression de renouveau ?
On le voit, la place prépondérante des arts décoratifs, du nouveau, de la mode ne peut être la seule raison – la seule excuse – de ce transitoire. La révolution industrielle a eu besoin de formes et de produits, les expositions universelles françaises de la période moderne ont montré l’efficacité « agressive et réussie » de la démarche nationale faisant sur ce point mentir Sir Henry Cole.
Aujourd’hui, les processus de la révolution numérique industrielle en cours qui transforment nos sociétés requièrent du design et des designers. À l’heure d’un centenaire, 36 auteurs en France, spécialistes du design (autre façon de faire paysage) ont donc rapproché, à la manière d’un précis, des notules soigneusement « ramassées » et des archives pour pointer quelques enjeux majeurs toujours d’actualité.
Au bauhaus rationaliste, par exemple, l’influence et la collaboration du cercle de Vienne sont analysées par l’historien des sciences Peter Galison. Un cas d’étude – la projection volumique d’une partition de Bach proposée par des étudiants en 1929 (voir pp. 28-31 du livre) – montre comment l’école contribue à ce qui deviendra la projection graphique et artistique des données soit la visualisation de données. En somme, le Bauhaus importe.
Programmes
Si, court-circuitant Bruno Latour, nous pensons que nous n’avons jamais été modernes, force est de constater qu’une quelconque histoire du design basée sur « ses classiques et ses antiennes » non reconsidérés prend, dès lors, un coup dans l’aile, tant les designers et quelques autres sont formés et construits du lait ou du béton de la modernité.
C’est pourquoi, au point de vue idéologique du philosophe dans son ouvrage, sans s’engluer dans la nostalgie d’une utopie vivante et déjà perdue, revient-il de constater que l’existence de l’école du bauhaus (et d’autres au même moment) vient donner forme à des questions qui, aujourd’hui, se reformulent dans une période tout aussi cahotique, inquiétante, connectée et excitante – que ceux que nous appelons les allemands inquiets de Weber, Benjamin et Simmel à Kracauer n’avaient pas moins vue.
L’ouvrage fait donc du « fragment » un outil critique des modernités et offre d’aboutir à un compendium maillé. Il rend compte des jonctions et des disjonctions et, agissant par percolation, ou « grappage » d’hypothèses, révèle la puissance d’un récit choral, informe les savoirs et les pratiques. Aussi, avons-nous singulièrement besoin de regarder le bauhaus où se jouent une antériorité et une autorité de pratiques, une généalogie fondamentale pour théoriser la discipline.
Cette remarque offre de lever quelques points concernant l’essentielle « disruption » qui fait souvent figure de vertu et dont il n’est étrangement pas sûr qu’elle appartienne au monde du design à qui l’on assigne pourtant d’innover (voir l’article de C. Geel). Posons déjà qu’elle est inhérente à ces périodes qui réadaptant leurs sociétés en réinterrogent les procédures, les spiritualités, les économies – ce que fait typiquement Piketty dans son dernier ouvrage – et doivent leur donner une perspective. Ou un point de fuite ?
La « disruption » ne doit pas seulement faire surgir ou imposer « ce qui semble devoir être seul et seulement la nouvelle norme ». Ici réside une grande et fondamentale question pour toutes les pratiques en design. La disruption serait donc nécessaire pour certains de ses aspects, et preuve qu’il faut aussi envisager de discuter avant d’imposer pour le reste.
Dès le bauhaus, de telles « procédures » existaient sur le rôle de cette discipline finalement toujours instrumentalisée. Le design comme instrument ? Sa « fonction » n’a-t-elle pas toujours été de l’être ? D’où l’histoire, d’où le dialogue interdisciplinaire, d’où la volonté plus ou moins farouche d’une discipline à être considérée (pour elle seule), c’est-à-dire à intégrer aujourd’hui les cadres contraignants, parfois obsolètes, d’autres fois plus avantageux, de l’académisme universitaire. « Don’t act ».
Comme chacun sait, ce n’est pas en France qu’est fondé le staatliches bauhaus. C’est également en Allemagne qu’est inaugurée la Hochschule für Gestaltung Ulm, dite école d’Ulm (1953-1968) avec le concours du bauhausien Max Bill. – Sa « greffe » en France au lendemain de 68, via l’Institut de l’Environnement (1969-1976), n’aura pas véritablement pris. – De tout ce qui s’essaya, s’expérimenta, se créa et se débattit des legs précieux restent à transmettre.
En d’autres mots, le « fait moderne » y aura trouvé un « agir », et ainsi un « à-venir », un « devenir ». Il aura été de ce par quoi un pays tout entier se refait, une société se dépasse et se réforme. Nous pourrions, selon des trajectoires différentes, en dire autant du Royaume-Uni, de l’Italie ou de l’Amérique du Nord.
Au fait, toujours répété comme évidence, que l’entreprise économique du bauhaus fut un échec, l’historiographie est aujourd’hui en mesure de montrer qu’entre la première archéologie gropusienne et la seconde période de son histoire, le bauhaus construit un parcours économique cohérent, plus ou moins serein, mais « réel ».
Pas de grands « échappements » mais les avancées profitables de la professionnalisation, l’influence des avant-gardes sur la formation, la « synthèse » industrielle (jointage de l’expérimentation et des prototypes à la nécessaire mise à plat productive), l’entrée dans la vie réelle au point de l’ambiguïté nazie ou fasciste. Ces facteurs sont puissants à examiner dans NOTRE époque. Du porte-à-faux comme référence architecturale antique (voir les textes de D. Bihanic, B. Grenre, A. Mare et al. dans l’ouvrage), le bauhaus et sa période, construisent un archétype mobilier qui vient peupler jusqu’aux salles d’attente médicales.
Ce n’est que l’exemple surfacique de modalités plus souterraines : la norme DIN (de nos feuilles A4 aux mesures de nos appartements et aux procédures constructives raillées habilement par Tom Woolf), la planification urbaine, l’agriculture industrielle, l’éveil éducatif (voir les textes de G. Bertrand et M. Farvard, ainsi que d’A. Midal), les inventions typographiques, la communication d’entreprise et l’école comme « entreprise » – mais pas n’importe laquelle –, la reformulation des outils pédagogiques, la méditation avant le travail s’ancrent ici dans le réel.
La fête n’y était pas permanente, elle revendiquait plutôt des espaces-temps, des failles temporelles nécéssaires. L’innovation ne pouvait y être une injonction, car excuse économique entrepreunariale, elle est toujours une façon d’assigner le design à résidence. Ce qui se jouait et devrait se rejouer fut la réinvention d’une société épuisée socialement et politiquement par la seconde révolution industrielle et une guerre mondiale. De cet aspect, nous sommes redevables. Si la normativité des protocoles et les « dressages » numériques s’examinent, la radicalité comme standard-modèle est a minima un programme d’intelligentes procédures de formation pour élaborer (voir l’ouvrage d’A. Masure).
Si l’on propose à cette discipline d’embrasser à l’anglo-saxonne la réflexion organisationnelle des instances, la possibilité à établir des lieux d’échanges et de construction, si l’on s’arrête sur la nécessité anthropologique de la consommation (au-delà de Mauss et du côté de Mary Douglas), si l’on investit dans la formation à l’ « appliquer », si l’on y joint l’éducation et les impératifs écologiques, l’acte de consommer comme un acte collectif et non comme paradigme de la reconnaissance de chacun, alors chaque objet matériel et toute fréquentation immatérielle sera la concrétisation d’une implication dans l’action collective – évitons le standard, mais gardons l’universel. On retombe immanquablement sur des principes fondateurs et excitants à mettre en perspective des conséquences du moment bauhaus.
Conclusions sur des designs
« Ce que l’on sait devoir bientôt disparaître de notre vue devient image », écrivait Benjamin dans un texte consacré à Baudelaire. Le seul et unique aboutissement, la seule conséquence du « moderne » de la modernité baudelairienne serait celui d’avoir « été » ? Alors qu’il était là, devant nous, se produisant, il s’essouffla. Ainsi, sembleraient s’illustrer les « designs ayant percé en France du temps de la modernité (et au-delà), nous parlons ici de ses mouvements (Art Nouveau, Arts Décoratifs, Union des Artistes Modernes, Formes Utiles etc.).
Comprenez-nous bien, tout ce qui fut créé, inventé et mis au point au cours des périodes artistiques ici sus-citées demeure, d’abord pour nous, des joyaux. Mais on ne construit pas un monde avec les seuls diamants de ladite couronne même républicaine.
À contrario, nous pensons que la modernité relève d’abord et avant tout d’une certaine façon d’être, de se tenir « dans » comme en « vis-à-vis » du monde. Il se pourrait que le design soit bien cela : une permanence à reposer les questions, à re-proposer d’autres orientations possibles. Le design n’est et n’a jamais été un problem-solver, mais bien une « façon » de reconsidérer des terrains et des procédures : le laboratoire, l’école, la bibliothèque, l’usine, l’atelier, le magasin de luxe, le « discount », l’hypermarché, etc. Tous les lieux et toutes les procédures.
Ce n’est pas un hasard si chaque phase de son histoire le fait resurgir, avec un peu plus de force à chaque fois, aux lieux et aux moments des crises. En attendre tout serait illusoire – les « appels » à sauver le monde par le design ne sont que pures inepties. Regarder ses développements et ses moments d’articulation à d’autres disciplines, nous le font comprendre. Par contre, faire une histoire critique semble ici et aujourd’hui, une nécessité. « La » bauhaus appelle à être rebâtie, encore ; d’autres maisons de la construction, que s’en manifeste le désir, l’énergie : « une » bauhaus européenne (proposition avancée, à la fin de l’ouvrage, par le designer J.-L. Fréchin).
Des expositions rétrospectives furent programmées pour le centenaire du staatliches bauhaus fondé à Weimar par l’architecte Walter Gropius [ex : bauhaus imaginista et original bauhaus—die jubiläumsausstellung à Berlin] et l’inauguration de musées dédiés [à Weimar, également à Dessau (BMD)]
NDLR : David Bihanic à dirigé l’ouvrage collectif publié le 30 octobre 2019 : staatliche bauhaus cent pour cent 1919-2019 aux éditions T&P Publishing
