Le transhumanisme et le désir d’immortalité : l’illusion de l’ego
Il est une dimension fondamentale de l’existence qui consiste à définir ainsi la vie : vivre, c’est survivre. C’est repousser toujours davantage l’échéance ultime, inéluctable, celle de la mort. Telle était, au demeurant, la définition de la vie que livrait au XIXème siècle le grand médecin Pierre Jean Georges Cabanis : la vie, c’est tout ce qui lutte contre la mort, et rien de plus. Une mort ajournée selon Schopenhauer. Vivre est une défense, une négation de la mort. Hobbes faisait de l’instinct de conservation et de la peur de la mort les éléments essentiels de son anthropologie pour expliquer le besoin de sécurité que le contrat social est réputé couvrir. Schopenhauer attribuait à ce qu’il appelait le « vouloir-vivre » ou la « volonté », la même fonction que celle que prêtait Bergson à l’élan vital : le principe moteur du monde.
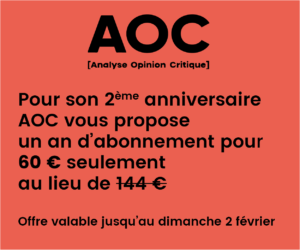
Voilà autant de notions qui ont été forgées dans l’histoire de la pensée pour représenter la vie comme entièrement redevable de la peur de la mort, cette inclination aveugle que la raison devrait pourtant réprimer : comment craindre en effet quelque chose d’inévitable et nécessaire dès lors qu’avoir peur, c’est avoir peur de l’aléa, c’est redouter qu’un événement – qui peut ne pas se produire – se produise ? Justement, en sa qualité de processus naturel, cet élan irrationnel n’est pas exclusivement lié à l’humanisme au nom duquel au contraire, dans certaines législations nationales, le droit de mourir dans la dignité est reconnu. Il est en revanche lié au transhumanisme.
Voilà un courant idéologique qui fait son chemin, depuis quelques années, en annonçant la promesse d’étendre l’espérance de vie au-delà de ce que permet la nature dans les conditions actuelles de la médecine voire, de vaincre la mort et de rendre l’immortalité à portée de la science comme le souhaite l’un de ses plus emblématiques représentants, Raymond Kurzweil. Il est évident qu’un tel projet, promu et nourri financièrement par les industries de pointe de la Silicon Valley et les géants de l’Internet, parmi lesquels figure l’entreprise Calico créée par Google, est riche d’aspects positifs mais susceptible, en même temps, d’engendrer de lourdes menaces tant sur le plan éthique qu’économique. C’est pourquoi le droit et les pouvoirs publics ne peuvent pas rester indifférents à cette perspective biotechnologique qui se dessine.
Depuis qu’il est désormais raisonnablement acquis que les technologies du vivant permettront de modifier le patrimoine génétique des individus, d’introduire dans le corps humain des nanoparticules réparatrices ou préventives, de greffer dans le cerveau de l’intelligence artificielle reliée à des ordinateurs, l’humanité verra naître ce qu’on appelle déjà « l’homme augmenté ». Perspective dont la crédibilité soulève plusieurs problèmes auquel est exposé notre héritage humaniste : un problème éthique sur la définition de l’humain et sa relation avec l’animal et les robots ; un problème d’égalité et d’équilibre dans une société démocratique au sein de laquelle l’accès aux biotechnologies, compte tenu de son coût, ne sera pas universel et pourra engendrer des fractures entre humains et post-humains ; un problème de santé publique et de solidarité entre générations induit par le coût exorbitant, imputable à l’allongement de l’espérance de vie.
Ce courant de pensée contemporain, qui est désormais l’objet d’une abondante littérature, prône l’utilisation sans limite des nouvelles technologies de la vie et de l’information pour améliorer l’espèce humaine. Désignées par le fameux sigle NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, informatique et neurosciences), elles sont destinées à rendre l’homme plus fort, plus intelligent, plus heureux et en meilleure santé, à prolonger son espérance de vie et à surmonter la mort. Le terme « transhumanisme » pour définir cette forme d’eugénisme libéral a été choisi en 1957 par le biologiste Julian Huxley, frère de l’auteur du Meilleur des mondes (qui est une critique romancée du transhumanisme), afin de prémunir le mouvement de toute analogie avec le nazisme qui venait de pratiquer un eugénisme totalitaire.
La perspective de « déplacer » l’intellect sur un support inorganique, recycle, de façon naïve, la dualité métaphysique de Descartes entre l’âme et le corps.
Considéré pendant un temps comme une idéologie fantasque digne des romans de science-fiction, il est maintenant pris au sérieux en raison des progrès exponentiels de l’Intelligence artificielle et de la biotechnologie. Comme l’a écrit l’urologue transhumaniste Laurent Alexandre, « l’individu qui aura mille ans est peut-être déjà né ». Ce bio-progressisme constitue à la fois une source d’espoir et une menace. Source d’espoir car le transhumanisme est un humanisme « au carré » qui poursuit, de manière accélérée, le processus d’arrachement de l’homme aux pesanteurs de la nature. Menace car en indexant notre bonheur sur les progrès de la technologie, il repose sur une conception matérialiste de l’homme qui, à terme, peut brouiller voire supprimer la frontière entre l’animal, l’humain et la machine. Menace pour les droits de l’homme, le transhumanisme constitue également un défi pour la démocratie.
En effet, parmi les sources d’inspiration des transhumanistes, figurent certes le rationalisme de Condorcet mais surtout, dans son sillage, le positivisme d’Auguste Comte qui estimait que la Révolution devait son succès ni aux Sans-culottes, ni aux églises ni aux politiques mais à la science. La philosophie politique du transhumanisme agite ainsi le spectre d’une société post-métaphysique et post-politique dominée par les technosciences et dans laquelle l’intelligence artificielle, par exemple, se substituera au libre-arbitre comme en attestent les perspectives d’avènement d’une justice prédictive rendue exclusivement par des algorithmes.
L’eugénisme nazi était totalitaire et holiste parce qu’il consistait à mettre la biologie à la disposition d’une entité collective et essentialisée, la prétendue race aryenne. Le projet transhumaniste est libéral et individualiste car il ne vise qu’à satisfaire l’individu, à qui est reconnu le droit d’utiliser ou de ne pas utiliser la technologie au service de son amélioration génétique. Il est une biologie appliquée dont le projet philosophique prolonge, de manière exacerbée et radicale, la métaphysique subjectiviste des Lumières. L’ego constitue la fin ultime de l’eschatologie transhumaniste. L’ego : telle est justement l’illusion sur laquelle se fonde cette idéologie dont le projet, empreint d’un inquiétant matérialisme, suscite à la fois beaucoup de défiance et en même temps, une certaine forme de dérision que je voudrais exprimer en m’appuyant sur la métaphysique d’un philosophe allemand du XIXème siècle, Arthur Schopenhauer.
Je ne m’attarderai pas sur la contradiction dans laquelle s’enferme le transhumanisme entre son matérialisme et l’espoir qu’il mise dans l’usage de l’informatique pour télécharger le cerveau et assurer à l’individu la permanence de son esprit par-delà la finitude du corps. D’un côté, l’intellect est l’objet d’un traitement technologique analogue à n’importe quel tissu du corps humain et se voit dénier, chemin faisant, toute transcendance quand, de l’autre, la perspective de le « déplacer » sur un support inorganique (qui pourrait être une simple clé USB !) ne fait que recycler, de façon naïve, la dualité métaphysique de Descartes entre l’âme et le corps.
Mais à l’extravagance d’un tel projet – qui n’est pas loin de faire écho à la contradiction inverse dans laquelle le philosophe du XVIIème siècle se fourvoyait lorsqu’il fondait l’exception de l’être humain, prétendument doté d’une âme, sur l’existence d’une mystérieuse glande pinéale logée dans son cerveau – s’ajoute surtout cette peur de la mort caractéristique du transhumanisme. Elle révèle toute la distance, comme je voudrais maintenant le souligner tout particulièrement, qui sépare cette idéologie, de l’univers de la philosophie dont l’une des fonctions majeures, comme l’écrivait Montaigne dans ses Essais, est d’apprendre à mourir.
Cette volonté farouche d’offrir à l’individu l’immortalité témoigne de façon paradoxale, que par-delà son matérialisme évident, le transhumanisme n’est rien d’autre qu’une exaltation caricaturale de la philosophie du sujet qui ne résiste pas à la thèse schopenhauérienne de l’illusion de l’ego. Quelle est cette thèse ? La philosophie du pessimiste de Francfort est une théorie dualiste de la connaissance qui, dans le sillage de Platon et de Kant, considère que le monde tel qu’il est perçu par le sujet, à travers le prisme de son entendement, n’est qu’une représentation d’un monde indivis, soustrait au temps, à l’espace et à toute forme de causalité.
Ce monde perçu, qu’il appelle « le monde comme représentation », tient le même statut philosophique que les ombres de la caverne dans l’œuvre de Platon ou le phénomène dans la pensée de Kant. Il s’agit de la superficie du monde, la face illusoire derrière laquelle se cache l’Idée ou le « noumène » qui, selon les deux grands maîtres idéalistes de Schopenhauer, renvoient au monde en soi, intemporel mais vrai.
Reprenant à son compte la distinction entre « noumène » et « phénomène », Schopenhauer se démarque de Kant en définissant différemment la chose en soi. Chez le philosophe de Königsberg, la chose en soi, inaccessible à l’entendement, ne renvoyait à rien d’autre qu’à des horizons transcendants, à l’instar de Dieu, la liberté ou l’âme, qui dénotaient un certain refoulé religieux issu de son éducation piétiste.
Pour Schopenhauer, ouvertement athée et délesté de l’héritage judéo-chrétien dont la définition kantienne de la chose en soi est le reflet, celle-ci désigne la volonté aveugle qui anime le monde et dont chacun ressent l’essence dans sa corporéité et sa sexualité. Elle est la libido du monde. Là où se démarque Schopenhauer de ses deux illustres devanciers, c’est que la volonté, concept étranger à la notion de libre arbitre qu’il appelle le « vouloir-vivre », ne se loge pas dans le ciel des idées mais dans l’immanence du monde. Soustrait au temps et à l’espace qui sont, en termes kantiens, des catégories « a priori » de l’entendement et relèvent, ce faisant, du phénomène ou de la représentation, le vouloir-vivre ne connaît ni la naissance ni la mort (il est intemporel) et constitue une unité étrangère à la pluralité et à l’individuation (il n’est pas dans l’espace) que les scolastiques dénomment, depuis Duns Scot, le principium individuationis.
C’est que le temps et l’espace, encore une fois, qui sont de pures idéalités, sont des catégories du sujet qui ne perçoit qu’un monde phénoménal entièrement conditionné par les formes à priori et immanentes de son propre entendement. Un monde conditionné par un voile qui couvre d’illusions le sujet connaissant. La mort de l’individu, lequel n’est qu’une objectivation de la volonté, est donc en soi un non-événement car, à l’instar de la naissance, elle est une temporalité à laquelle seul l’intellect, c’est-à-dire la conscience, est soumis en tant que phénomène. La mort n’est qu’une extinction de l’individu et de sa conscience mais n’atteint pas la volonté qui, comme chose en soi, est commune à tous les individus. Où l’on voit que la philosophie de Schopenhauer est une négation des philosophies du sujet et des religions qui affirment, à l’instar du christianisme, l’immortalité de l’âme et du sujet.
Enserré dans les bornes que lui assigne son entendement, le sujet est donc spectateur d’un monde qu’il voit multiple et dans lequel l’individuation, en tant qu’elle est constitutive de la pluralité, est elle-même une illusion. Celle-ci entre en contradiction avec la vérité d’un monde dont l’essence, dans sa qualité de chose en soi, est d’être indivisible tout comme le temps, pure idéalité dans laquelle est enfermé le monde comme représentation, n’est autre que l’une de ces catégories de l’entendement dans lequel chacun est lui-même circonscrit.
Platon lui-même l’avait compris selon qui le temps, écrit Schopenhauer, « n’est lui-même que le point de vue partiel et incomplet auquel l’être individuel contemple les Idées, lesquelles sont en dehors du temps et, par le fait, éternelles » ; c’est ce qui fait dire au fondateur de l’Académie, ajoute-t-il, « que le temps est l’image mouvante de l’éternité » (Timée, 37 d). Pluralité et individualité forment ainsi le miroir brisé du monde aux termes d’une métaphysique qui s’avère, par-delà la méthode idéaliste dont elle procède en faisant le départ entre le monde en soi et le monde perçu, éminemment immanentiste voire panthéiste.
La souffrance qu’inspire à l’homme la perspective de trépasser provient de cette illusion de la pluralité et de sa séparation d’avec le monde.
Schopenhauer démystifie ainsi la mort en la réduisant à un simple accident dont seul l’intellect paie le prix sans que la volonté, comme chose en soi, n’en souffre. Particulièrement inspiré par la pensée indienne dont il a agrémenté son héritage platonico-kantien, il use de la métaphore du voile de Maya pour rendre compte de cette illusion dans laquelle est plongé le sujet, empêché qu’il est de percevoir dans sa nudité, l’essence même de la chose en soi. Dans la religion hindoue, Maya est la divinité qui crée l’illusion cosmique de la dualité de l’univers phénoménal, de la fausse dichotomie entre soi et l’univers.
Nous serions tous dupés par ce voile qui enveloppe l’intelligence et nous incline à prendre le monde physique pour l’essence du monde, le phénomène pour le noumène[1]. Ce faisant, la religion hindoue nous invite à arracher ce voile de Maya et à considérer que chacun de nous n’est qu’une infime goutte d’eau au sein d’un océan sans limites.
Voici en quels termes Schopenhauer fait sienne la thèse indienne de l’illusion de l’individuation : « Maintenant, il est bien vrai que, pour les yeux de l’intelligence, telle qu’elle est dans l’individu, soumise au service de la volonté, le monde ne se montre pas avec la même figure que lorsqu’il finit par se révéler au chercheur, qui reconnaît en lui la forme objective de la volonté unique et indivisible, à laquelle il se sent identique lui-même. Non, le monde étend devant le regard de l’individu brut le voile de Maya, dont parlent les Hindous ; ce qui se montre à lui, à la place de la chose en soi, c’est le phénomène seul, sous les conditions du temps et de l’espace, du principe d’individuation, et sous celles des autres formes du principe de raison suffisante. Et avec cette intelligence ainsi bornée, il ne voit pas l’essence des choses ; qui est une ; il en voit les apparences, il les voit distinctes, divisées, innombrables, prodigieusement variées, opposées même ». D’où la crainte de la mort dont la psychologie de l’individu est affectée.
La souffrance qu’inspire à l’homme la perspective de trépasser provient de cette illusion de la pluralité et de sa séparation d’avec le monde, analogue à celle dont est victime la feuille qui chute à l’automne en ignorant que sa propre déchéance n’est rien de plus qu’un évènement du monde comme représentation. Cette métaphore schopenhauérienne relate l’aveuglement de l’individu qui ne voit pas que d’autres feuilles, au printemps, jailliront de la même source de vie, à savoir l’arbre incarnant dans cet exemple la volonté comme chose en soi qui ne cessera jamais, quant à elle, de s’affirmer[2].
Le temps, condition « à priori » de l’entendement, qui crée chez l’homme l’effrayante illusion de sa séparation d’avec le monde comme volonté en lui procurant la désagréable appréhension de s’en extraire par la mort, est un des éléments constitutifs majeurs du principe d’individuation dont l’idéologie transhumaniste, comme toute philosophie du sujet, demeure prisonnière. C’est pourquoi Schopenhauer, très influencé par-delà son héritage kantien par la pensée indienne, nous aide à comprendre combien le fantasme transhumaniste de la victoire sur la mort, est une dérive pathologique de notre patrimoine philosophique occidental et individualiste issu de la tradition judéo-chrétienne. Le projet transhumaniste de la mort de la mort ne résiste pas à la déconstruction philosophique.
Ce texte est publié en prélude à La Nuit des idées, manifestation dédiée le 30 janvier 2020 au partage international des idées, initiée et coordonnée par l’INSTITUT FRANÇAIS. Toute la programmation en France et dans le monde sur lanuitdesidees.com.
