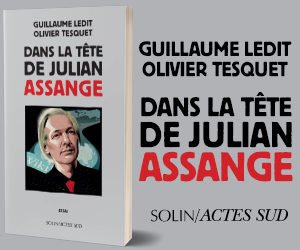L’effondrement au présent ou les gestes barrières des générations collapsonautes
Tout ce que l’on voit aujourd’hui a déjà eu lieu en fiction : les villes désertes aux habitants disparus ou confinés ont été filmées dans de nombreux films hollywoodiens (de The World, the Flesh and the Devil réalisé par Ranald MacDougall en 1959 à I am Legend de Francis Lawrence en 2007, ou Kaïro de Kiyoshi Kurosawa en 2001). Les épidémies, la contagion, la panique, la fuite et/ou le confinement ont été racontés dans de nombreux romans de Daniel Defoe (Le Journal de l’année de la peste, 1722) à Margaret Atwood (Le Dernier Homme, 2003) en passant par Albert Camus ou Jean Giono (La Peste, 1947 et Le Hussard sur le toit, 1951). C’est pourquoi le détour par la fiction peut être utile pour comprendre ce qui se passe aujourd’hui.
Car non seulement romans et films nous ont déjà tout montré, mais l’épidémie du Covid-19 nous saisit à un moment où les thèses effondristes se sont tellement répandues que nous sommes prêts à y reconnaître les prémisses de l’effondrement de notre civilisation. De sorte qu’aucune mesure ne paraîtra trop sévère pour faire barrage au virus.
Depuis l’irruption de l’épidémie en France, avec un coup d’accélérateur jeudi 12 mars, avec le premier discours du président de la République, un second samedi 14 puis un troisième lundi 16, nous sommes pris dans un plan-séquence anxiogène : point de vue unique, pas de retour en arrière, accélération vers la catastrophe, sidération devant l’inéluctable. On a le sentiment de vivre l’effondrement tel que les collapsologues le prédisent depuis 2015 (et le succès public du livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer).
Pour se réveiller de cette sidération, lire le tout récent Générations collapsonautes d’Yves Citton et Jacopo Rasmi (Seuil, mars 2020) est un exercice salutaire. Ce livre est publié opportunément pour nous faire sortir de l’hypnose d’aujourd’hui. Il se présente comme une analyse du discours collapsologique qui reconnaît la puissance de déplacement intellectuel des thèses effondristes et les prend au sérieux : d’ultra-minoritaires il y a quelques années, elles parviennent aujourd’hui à renverser la charge de la preuve et paraître plus « vraies » que le discours du business as usual.
Mais le geste le plus original et stimulant de Citton et Rasmi est d’identifier les présupposés de la collapsologie pour nous décoller d’une croyance naïve dans un effondrement inéluctable et imminent. On peut voir dans cette double attitude de reconnaissance de l’importance de l’effondrisme et de méfiance à l’égard de ses raccourcis et de ses impensés un guide pour penser l’état du monde au moment du coronavirus.
Les deux auteurs aboutissent à huit gestes barrières pour ne pas se laisser emporter dans la sidération (rester captif de son écran, scotché aux décomptes macabres quotidiens : combien de morts aujourd’hui ?) ou céder à la panique (aller piller les supermarchés). Passons-les en revue. Chacun de ces gestes théoriques concerne l’effondrement : la transposition à la situation actuelle est si évidente qu’on n’a guère besoin de la souligner.
Geste barrière n° 1 : analyser le vocabulaire de l’effondrement
L’effondrement, avant tout, est un mot, comme le collapse anglais qu’il traduit. Or, ce mot relève d’un imaginaire particulier : excluant tout point de vue extérieur (personne n’échappera à l’effondrement, global par définition, contrairement à une catastrophe qui demeure locale), il participe d’une pensée apocalyptique, c’est-à-dire de la révélation.
Il y a bien dans la collapsologie l’idée d’une vérité enfin révélée par l’effondrement qui promet un salut profane en annonçant une vie meilleure une fois que nous serons délivrés des puissances mortifères de l’industrialisme, du consumérisme et du capitalisme qui nous aliènent. Mais si on peut raisonnablement penser que notre monde touche à sa fin, écrivent Citton et Rasmi, il se peut qu’il le fasse sans s’effondrer : il peut chuter sans que ce soit d’un bloc, ni brutalement.
Il est tout aussi possible qu’il « s’effrite », tombant « au ralenti », ses fondations tenant toujours : les combats perdus de ces dernières décennies pour défendre les acquis sociaux peuvent être lus comme les « témoins douloureux de cet effritement » (p. 48). Il peut aussi s’affaisser, se pencher parce que ses soubassements se sont affaiblis : ne serait-ce pas ce que suggère la crise bancaire de 2008, qui a durablement grevé les budgets des États ?
Il peut encore glisser, s’écouler ou se déliter « comme une pierre se fend selon les veines horizontales de ses couches […] de stratification » (p. 52). Moins effrayant que l’effondrement, car moins immédiat, le délitement nous dit que notre société se fissure et se fragmente, ce qui nous ouvre une perspective : il nous conduit moins à imaginer un édifice qui s’écroule pour nous écraser qu’à identifier les « failles de fragilité et les lignes de conflit » de notre société (p. 54), et donc à faciliter nos initiatives émancipatrices.
Critiquer le vocabulaire de l’effondrement semble une étape nécessaire pour conjurer ses impensés : par exemple, résister à la tentation de mythifier un âge d’or perdu ou se méfier de la tentation millénariste d’un effondrement qui nous délivrerait du capitalisme pour nous ouvrir un monde nouveau d’entraide et de solidarité sans résistance et sans conflit.
Geste barrière n° 2 : cartographier des lignes de propagation
Le discours effondriste n’est pas si nouveau qu’on le croit : il constitue en fait une nouvelle version de discours écologistes radicaux qui se succèdent pendant tout le XXe siècle et dont les précurseurs sont apparus au début du XIXe. La nouveauté est plutôt dans le succès public de ses thèses qui touchent aujourd’hui tout le monde occidental.
Ce succès soudain souligne que l’effondrement, comme un virus, ne se répand pas uniformément à travers la planète. Or, mettre en avant la distribution géopolitique de l’effondrement permet de se rendre compte que la fin du monde a déjà eu lieu pour de nombreux peuples : ainsi pour les Indiens d’Amérique depuis Cortez et pour les Africains victimes de la traite esclavagiste (p. 63).
Le comprendre nous oblige à décentrer notre imaginaire et à en tirer plusieurs enseignements : l’angoisse occidentale d’un effondrement soudain est un retour de manivelle décolonial. Il va falloir renoncer à un certain nombre d’attachements, comme l’ont fait d’autres peuples avant nous, la perte de monde imposant de se défaire d’investissements matériels, psychiques et symboliques ; renoncer à notre obsession de la quantification pour retrouver le sens d’une réalité qui ne se résume pas à des courbes ni à des graphiques ; ouvrir des possibilités de vie dans un monde abîmé par le capitalisme pour envisager l’après (p. 72).
A-t-on besoin de souligner les parallèles avec l’épidémie ? De la déconvenue d’une Europe qui se découvre épicentre de l’épidémie alors que l’Afrique est (pour l’instant) relativement épargnée, à notre besoin de réinventer notre vie sociale après le confinement, ces enseignements sont directement transposables à notre situation.
Geste barrière n° 3 : s’accommoder aux résurgences
Parmi tous les mots proposés par les chercheurs en sciences humaines pour remplacer le malheureux « anthropocène » (qui fait de l’être humain en général le responsable des désordres écologiques), Citton et Rasmi choisissent le « plantationocène ».
Pour deux raisons : d’une part la plantation renvoie historiquement au colonialisme et désigne la responsabilité occidentale depuis l’ère des empires ; d’autre part, conceptuellement, elle évoque un régime de production consistant à éradiquer la diversité de ce qui pousse et vit « naturellement » sur un territoire pour favoriser la croissance d’un seul produit, dont la production en masse aura donc nécessité la destruction d’un vivier de biodiversité.
En ce sens, la plantation désigne « des écologies simplifiées, conçues dans l’unique but économique de créer des actifs pour de futurs investissements ». Contre le modèle de la plantation, il faut apprendre à nous accommoder des résurgences : si dans un champ, on n’obtient de monoculture qu’en soumettant la terre à une violence biologique, le monde qui s’écroule est celui de programmations financières qui « gouvernent le futur vers des monocultures plantationnaires régies par des modèles de valorisation axés sur l’individualisation et le court terme » (p. 85).
Or, ce n’est possible qu’en éradiquant en permanence les vivants indésirables qui s’obstinent à repousser. Il faut opposer à ce monde homogénéisé du futur la considération d’une nature faisant toujours ressurgir une diversité revenant du passé. Aux entités appelées à être selon nos programmes de profits (futura : « ce qui sera »), il convient de préférer les entités qui sont appelées à naître et renaître encore (natura : « ce qui naîtra »).
C’est ce que Citton et Rasmi appellent, en suivant Anna Tsing, les « résurgences » : constitue une résurgence toute renaissance dans le présent plantationnaire de vivants que les gestionnaires avaient cru éliminer. Les esclaves marrons, les « rétrogrades » qu’ont été chacun en leur temps « les sorcières, les pirates, les niveleurs, les luddites et autres zadistes » (p. 87) ont montré la puissance que la vie oppose à son administration, en même temps que sa fragilité, son insistance à persévérer en même temps que sa vulnérabilité.
Le mode d’être de la résurgence n’est pas « l’éternel retour », mais l’impureté anarchique de ce qui revient toujours différemment, selon les circonstances, avec des modes d’alliance et de composition nouveaux, à travers tous les enchevêtrements dont se constitue le vivant.
Geste barrière n° 4 : laisser émerger les fonds
Dans tous les récits d’effondrement, le monde s’écroule autour de héros humains dont la survie reste le vrai sujet. La « figure » humaine importe, le reste n’est qu’un « fond » qu’on ne considère que dans la mesure où il existe pour l’humain qui demeure au premier plan (p. 111). Il importe plutôt, pour résister à la fascination de la fin, de repenser l’articulation de la figure et du fond, de reconsidérer la manière dont nous sommes attachés au monde supposé finir.
Un certain cinéma expérimental sert ici d’appui à Citton et Rasmi, qui vont chercher chez Michelangelo Frammartino ou Sharunas Bartas l’expérience d’une remontée des fonds : un cinéma qui cherche à saisir non l’action humaine sur fond de paysage, mais le fond lui-même, dans sa complexité, dans les enchevêtrements et les circulations qui le composent, les figures qui en émergent et y replongent, la vie qui y fourmille. Dans ce cinéma de l’observation documentaire, c’est le fond qui domine, l’action humaine est minorée.
L’expérience esthétique sert ici de modèle susceptible de nous apprendre à considérer l’environnement comme un fond qui nous entoure et nous excède. Alors on peut comprendre que l’effondrement ne le menace pas : le fond au contraire nous tient. L’épidémie actuelle nous le rappelle : nous sommes à la merci d’un virus qui nous a été transmis par des animaux avec lesquels nous avons entretenu une trop grande proximité.
On ne peut pas être indifférent à la terre sur laquelle nous vivons dans l’entremêlement de toutes les espèces vivantes, des mammifères aux micro-organismes. Une leçon possible de l’épidémie serait celle-là. Laisser les fonds émerger, c’est comprendre que nous ne vivons qu’au milieu d’une multitude avec laquelle nous entretenons des relations d’interdépendance que, pour la plupart, nous ignorons et dont les œuvres d’art peuvent nous faire pressentir l’existence furtive avant qu’elle nous menace.
Geste barrière n° 5 : lire des fictions pour anticiper l’avenir
Toutes les catastrophes ont été écrites avant de se produire. La littérature imagine les événements avant qu’ils ne surviennent, ainsi que Pierre Bayard a pu le montrer (dans Le Titanic fera naufrage, 2016 ou Demain est écrit, 2005). Ainsi l’effondrement a-t-il été raconté dans de nombreux livres qui nous donnent les moyens d’imaginer les dilemmes que nous aurons à affronter quand il se produira.
La littérature constitue une véritable « prospective, écrivent Citton et Rasmi en citant Bayard, qui produit des étincelles dont la reconnaissance peut à la fois enrichir notre vision de l’avenir et nous préparer […] à accueillir le pire et à prendre, sans se fier à l’illusoire protection de ceux qui nous gouvernent, les mesures nous permettant d’y échapper » (p. 131).
Geste barrière n° 6 : en rire
Pour désamorcer la panique ou éviter la sidération, rien de tel que de rire de nos peurs. Contre la crainte paralysante de l’effondrement, le slapstick, suggèrent Citton et Rasmi, pourrait être la meilleure des thérapies : il a su mettre en scène le potentiel comique des chutes qui nous rappellent brutalement notre « distraction humaine-trop-humaine » (p. 159). On tombe ? Soit ! Notre fragilité est inéluctable et il est normal que le monde se rappelle à nous.
« Comment atterrir ? » devient une question qui complète le « Où atterrir ? » théorisé par Bruno Latour. L’antidote burlesque peut nous conduire à percevoir l’inanité de nos projets survivalistes de « sécurisation et de fortification de notre petit royaume humain » comme à nous moquer plaisamment du « sourire pacifié des gourous » de l’effondrisme (p. 166). Le rire favorise la prise de distance, et nous permet d’accepter nos incompétences et nos contradictions.
Geste barrière n° 7 : croire en plutôt que croire à
L’effondrement – comme l’épidémie – nous invite à croire en une nature conçue comme un « instable, multiple et vivant […] champ d’incessantes créations et modifications » (p.193). La nature n’est pas une externalité que notre volonté peut soumettre mais une « totalité cause de soi », selon la leçon de Spinoza.
Lui conférer une valeur intrinsèque, lui consacrer notre attention, la respecter et la protéger avec soin, comme le suggère l’écologie profonde, pourrait nous délivrer d’un dilemme qui se présente à nous avec insistance : croire à la persistance du monde néolibéral issu de la mondialisation ou croire, comme les collapsologues, à son effondrement imminent. Croire à l’une ou à l’autre de ces deux options ne fait que porter au dogmatisme.
Au contraire, croire en un milieu vivant qu’il nous est nécessaire de respecter, quel que soit le nom qu’on lui donne (la Terre, Gaïa, Pacha Mama…) permet de dialoguer avec politiques et scientifiques pour élaborer une « écosophie » dont on voit de plus en plus l’intérêt. En effet, si l’écologie désigne un savoir (assez assuré aujourd’hui), l’écosophie renvoie à des pratiques encore à inventer : le passage de la première à la seconde peut désigner la démarche de conversion de nos pratiques (de production, de consommation, de déplacements…) pour les aligner sur ce que nous savons.
Geste barrière n° 8 : ralentir
La pression urgentiste qui exige une solution immédiate à tous les dangers empêche souvent d’identifier les vrais problèmes et d’imaginer les meilleures solutions. Les catastrophes qui se présentent comme subites ont souvent des causes profondes, ancrées dans l’histoire, et auraient donc pu être évitées si, comme la tortue de la fable, on était parti à point.
Après l’effondrement, quand il faudra reconstruire, il importera de savoir que sauver de nos existences antérieures et de quoi s’assurer que ça ne reviendra pas. Pour cela, les auteurs préconisent de se placer d’ores et déjà dans cet après : anticiper pour ne pas être confronté à un urgentisme anxiogène, savoir d’ores et déjà ce qui ne devra pas revenir.
Le hasard a voulu que le livre de Citton et Rasmi paraisse au début de l’épidémie de Covid-19 en France, épidémie qui nous fait vivre, peut-être durablement, en pleine dystopie. Dans ces jours au parfum d’effondrement, imaginaire collapsologique (l’entraide pour un happy collapse) et fantasmes réactionnaires (fermeture des frontières, appels à la discipline et au maintien de l’ordre…) rivalisent pour donner forme à l’après-confinement.
Entre les deux, c’est dès maintenant que se joue notre avenir, car les virages pris pendant cette crise ne seront pas effaçables. Il n’y aura pas de retour en arrière, c’est pourquoi le détour de la théorie nous est utile dès à présent.