Fin du « capitalisme néolibéral » ? – mi-temps de la crise 3/3
Plus encore que précédemment, il faudra ici simplifier, occulter des problèmes et des points de vue qui feraient débat. Impossible, pourtant, de ne pas expliciter maintenant la question qui sous-tendait les considérations précédentes : en quel sens la crise où nous sommes plongés est-elle une « crise » ? Non seulement nous ne pouvons pas éluder la question, mais je comprends très bien qu’on trouve le terme équivoque ou mystificateur[1]. Si, néanmoins, on ne veut pas l’éviter, on devra se demander à nouveaux frais ce qui est en crise, et quels sont les termes qui paraissent pertinents pour définir son antithèse : « résolution », « révolution », « régulation »…
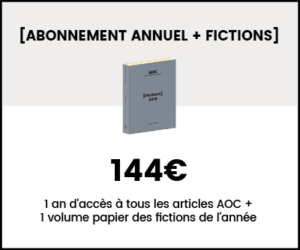
En commençant, j’ai suggéré que, dans notre perception de ce qui se produit aujourd’hui, les deux registres que la notion classique installait dans un rapport d’analogie, le médical et le politique, en viennent remarquablement à fusionner. C’est bien ce qui a conféré une crédibilité nouvelle à la terminologie élaborée par Michel Foucault dans les années 1970 : la « biopolitique », le « biopouvoir », auxquels on pourrait ajouter la « bioéconomie »[2]. Mais il ne faut pas s’en contenter, du moins sans la repenser à la lumière de l’actualité. On nous redit que, la pandémie ayant déclenché une crise sanitaire (ainsi qu’une crise de gestion de la santé publique) qui, elle-même, a entraîné un double effondrement de la production et de la consommation de certains biens fondamentaux (se présentant à la fois comme « crise de l’offre » et « crise de la demande », ce qui n’aurait pas de précédent récent)[3], une crise économique aux proportions gigantesques avec d’immenses répercussions sociales et géopolitiques est en cours de maturation.
Elle ne pourrait être résolue qu’à la condition de mettre en œuvre des « solutions » elles-mêmes inédites. Une quasi-unanimité semble se faire autour de l’idée que les modèles de mondialisation qui se sont imposés au cours des trente dernières années ont eu des conséquences désastreuses sur les capacités des États-nations de combattre la pandémie (souvent présentée comme l’objectif d’une « guerre »), parce qu’ils avaient abouti à concentrer la production de produits pharmaceutiques essentiels dans quelques pays d’Extrême Orient et d’Asie du Sud-Est (notamment la Chine et l’Inde). Du moins c’est ce qui est le plus audible en ce moment. Il semble aussi y avoir un large accord pour penser que les stratégies typiquement capitalistes pour protéger l’économie d’une catastrophe de celle des années 30 du siècle dernier (voire pire encore), en particulier l’injection de liquidités par les banques centrales (« quantitative easing »), constituent déjà une rupture avec l’orthodoxie financière du néolibéralisme[4].
Il devrait en aller ainsi de plus en plus, avec comme conséquence la « réhabilitation » des interventions de l’État et de l’idée keynésienne du rôle économique de la dette publique. On ajoute souvent que l’impossibilité d’ignorer plus longtemps les effets de la catastrophe écologique pousse dans le même sens (bien que personne ne soit vraiment d’accord sur les contenus et les modalités de la « révolution verte » indispensable). Au prix d’une très grande simplification, et même d’un parti pris que je ne fais pas de difficulté d’avouer, je me concentrerai ici sur les points de vue qui relèvent d’une critique de l’idéologie dominante. Or même de ce point de vue, force est de l’observer, l’unanimité ne règne pas. Certains pensent que la crise sanitaire avec ses suites constitue un danger mortel pour ce nouveau « stade suprême du capitalisme » que représenterait le néolibéralisme, d’autres soutiennent exactement le contraire.
Plus précisément les uns expliquent que la crise rend économiquement dévastatrices et politiquement intenables les politiques d’austérité budgétaire et de contraction des régimes de sécurité sociale, ce qui en fait condamne le néolibéralisme, tandis que pour d’autres, à moins d’une révolution socialiste ou communiste qui peut très bien ne pas avoir lieu, la domination du néolibéralisme demeurera inchangée, et même la crise mènera à son renforcement. « Never waste a good crisis » (« Ne jamais gâcher une bonne crise »), dit un bon mot répandu à gauche dans les pays anglo-saxons… En somme le débat porte sur deux points à la fois : l’articulation des aspects économiques et non-économiques de la crise, les effets qu’elle aura quant à la stabilité du régime néolibéral (donc, éventuellement, du capitalisme lui-même)[5]. À ces questions, je n’ai aucune réponse toute prête. Mais pour poursuivre le débat, je voudrais proposer trois ordres de considérations.
La première question qui appelle la discussion, c’est celle des conséquences de l’envolée des dettes publiques (ou des dettes privées garanties par l’État ou mises en commun par des États, comme commence à l’envisager l’Union Européenne, et qui sont transformées en dette publique à long terme) souscrites pour éviter ou retarder la crise[6]. Le capitalisme néolibéral, on le sait bien, repose déjà sur l’expansion du crédit (ce que Marx appelait le « capital fictif ») : il institue par conséquent une dépendance permanente des entreprises et des consommateurs – maintenant des États – par rapport aux opérateurs financiers, et il supprime progressivement toutes les entraves à la diffusion auprès du public de « produits financiers » à risque (ou de produits risqués pour assurer les risques, et ainsi de suite dans ce que Keynes comparait à un casino boursier et que Pierre-Noël Giraud appelle un « commerce des promesses »).
Ce que nous ne savons pas, c’est la façon dont une société capitaliste et son État réagit à la normalisation de l’exception.
On admet aussi dans la pensée économique hétérodoxe (telle que l’incarnent chez nous, par exemple, les « économistes atterrés ») que le néolibéralisme (comme ensemble de politiques faisant système) ne peut se soutenir qu’en appliquant des recettes féroces d’austérité qui transfèrent le poids des dettes sur la grande masse des plus pauvres (et, collectivement, des pays « débiteurs », notamment ceux du « Sud Global », mais aussi ceux du Sud de l’Europe : c’est tout le drame de la Grèce, qui menace aussi l’Italie). Rien n’est moins douteux et tout le monde a fini par s’y habituer. Mais ce qui n’est plus totalement prévisible, ce sont les conséquences d’une impossibilité durable et généralisée d’appliquer et d’aggraver encore le même type d’austérité, à la fois parce qu’elle serait politiquement explosive (même un gouvernement néolibéral ne peut se payer le luxe d’une insurrection) et parce qu’elle n’est viable que si les pauvres demeurent, malgré tout, suffisamment solvables pour payer des intérêts (directement ou indirectement, par l’intermédiaire de leurs États). Ce qui implique le maintien d’un certain niveau d’emploi ou la disponibilité d’autres ressources « informelles ».
On nous dit aujourd’hui du côté des économistes de plusieurs bords qu’il existe une solution alternative, à savoir la « monétisation de la dette » – essentiellement via le rachat des titres souverains des États par leur Banque centrale (dont pour tous les pays de la zone euro la fonction est assumée par la BCE). Cette solution (contraire aux statuts de certains instituts d’émission) est en fait déjà à l’œuvre dans les prêts à taux nuls ou quasiment nuls octroyés par les grandes banques centrales depuis la crise de 2008 déclenchée par la faillite des institutions américaines de crédit à la consommation[7]. Et cette technique devrait non seulement se généraliser, mais devenir le pivot d’un nouveau modèle de régulation économique qui évite la récession et sauvegarde la croissance sur des bases nouvelles (ce qui suppose évidemment de vouloir soumettre les aides d’État ou les crédits aux entreprises à des conditions d’utilisation…).
Mais la monétisation continue de la dette n’est pas une opération « neutre » : en fait elle implique une transformation dans l’institution monétaire, on pourrait même dire un changement dans la définition de la monnaie (ce que Suzanne de Brunhoff appelait les rapports d’argent[8]) qui constitue la clé de voûte de la stabilité (ou de l’unité relative) des « formations sociales » (nations ou groupes de nations). Car elle inverse définitivement le rapport de dépendance entre la création monétaire et activité sociale « créatrice de valeur », soit qu’on se représente celle-ci (suivant la tradition marxiste) comme une dépense globale de travail socialement nécessaire dont la monnaie fournit « l’équivalent général », soit qu’on se la représente comme une croissance équilibrée du marché engendrant et régulant son propre instrument de circulation et de crédit (position libérale), soit qu’on la situe dans un effet de « confiance » institutionnelle ou dans une « souveraineté » conférée à la Banque centrale par la société dont elle exprime l’interdépendance des membres (comme dans l’école française d’anthropologie économique).
Le capitalisme, en d’autres termes, s’avance maintenant en territoire inconnu et les propositions de « sécuriser » l’inflation monétaire par son utilisation préférentielle, voire même obligée, à des fins de « croissance verte » font partie du problème économique et politique autant que de la solution. Sans compter que toutes les analyses des effets de monétisation de la dette semblent étrangement présupposer que les monnaies internationales « convergent » ou se soutiennent indéfiniment contre la dévaluation, mettant entre parenthèses les effets de guerre des monnaies qui pourraient suivre d’un bouleversement des hégémonies actuelles (déclin américain accéléré, affirmation de puissance de la Chine si sa « victoire » précoce sur la pandémie se confirme)…[9]
La deuxième question – envers de la précédente, préfigurant une déstabilisation par en bas alors que l’inversion des rapports d’argent ouvre la possibilité d’une déstabilisation par en haut – c’est celle des conséquences d’une paupérisation massive, ou de la chute d’un très grand nombre d’individus et de groupes sociaux (familles, voisinages, professions, générations…) en dessous du seuil de subsistance autonome, donc dans la catégorie de l’exclusion et de l’assistance (y compris l’assistance familiale, dont dépendent déjà aujourd’hui beaucoup de jeunes diplômés ou non, ce qui ne fait que repousser et aggraver le problème). Il s’agit, en d’autres termes, de savoir si le régime de précarité va qualitativement changer, franchissant dans la crise un seuil, non seulement là où elle est déjà endémique, mais dans les zones de « prospérité » elles-mêmes.
À nouveau, nous savons que le néolibéralisme a multiplié les situations de précarité, développant l’emploi intermittent au détriment de l’emploi stable, les statuts d’auto-entrepreneurs au détriment du salariat (la fameuse « ubérisation » des activités), exploitant cyniquement la fragilité des migrants et des réfugiés, rétablissant les « valeurs familiales » conservatrices de façon à affaiblir ou anéantir les capacités de résistance du salariat organisé contre l’augmentation du taux d’exploitation[10]. Mais ce que nous ne savons pas (et que nous allons découvrir, en le payant peut-être très cher), c’est la façon dont une société capitaliste et son État, avec ses antagonismes internes, réagit à la normalisation de l’exception, ou au développement simultané de la précarité individuelle et de l’arrêt du cycle économique. Les conséquences ont peu de chances d’être modérées, voire pacifiques…
Car abstraitement parlant, il n’y a que deux solutions, chacune à haut risque : ou le capitalisme devient un capitalisme hyperlibéral, ce qui veut dire qu’il recrée partout dans le monde des conditions d’extrême dénuement et de sous-emploi généralisé, et devra employer la violence permanente pour en contrôler les réactions de désespoir et de révolte, en intensifiant et banalisant les opérations de police, et sans doute aussi en favorisant (au-delà même de ce qui, déjà, s’esquisse dans de nombreux pays) les mouvements xénophobes et le racisme institutionnel – autrement dit en remettant le fascisme à l’ordre du jour, sous des formes plus ou moins « méconnaissables » ; ou bien il renverse son orientation récente et se prépare à un nouveau développement historique du principe de « sécurité sociale », qui aille au-delà des systèmes d’assurance et des « filets de sécurité » inventés par le XXe siècle même dans ses formes les plus avancées, par exemple en instituant sous une forme ou une autre le « revenu universel de base », qui se fonde non sur la disqualification mais sur la citoyenneté (notion elle-même à redéfinir, dans sa différence avec la nationalité) et non sur les aléas du marché de l’emploi. Mais ce serait une révolution. Plus exactement, les deux branches de l’alternative sont « révolutionnaires », mais en des sens opposés.
Force est de constater que la pandémie est un genre d’externalité très étrange, puisque c’est de l’intérieur qu’elle se développe et nous met en danger.
Relevons ici d’un mot, pour y revenir à une autre occasion, que ces deux formes de déstabilisation, qu’il s’agisse du rapport entre la monnaie et le crédit, ou de l’articulation précaire entre le travail (ou plus généralement l’activité) et la sécurité sociale, impliquent de repenser ce qu’on entend par valeur et ce qu’on mesure ou évalue sous ce nom, soit qu’on invoque (comme les classiques et, à leur suite, les marxistes) une mesure objective, soit que (comme les néoclassiques et le mainstream actuel) on en fasse le reflet de « préférences » utilitaristes. Je le signale sans m’y attarder parce qu’il en ira de même, et plus encore, avec mon dernier point.
Il faut débattre de la façon dont s’articulent la crise « sanitaire », la crise « économique » et la crise « morale » (ou éthique). Les rythmes ne sont pas les mêmes, et tout le monde n’est pas affecté au même degré par chacune, selon la place où il se trouve. Pourtant l’imbrication est telle que nous en venons, en les considérant dans leur unité, à repenser complètement ce qui pour nous est une « crise ». En général, on cherche à comprendre ce genre d’unité en partant de la cause, qui serait biologique, et en descendant vers les effets sociaux et économiques, voire psychologiques, et même traumatiques. Cela semble découler tout naturellement de l’observation des faits, mais renferme aussi quelques paradoxes, car, comme l’ont fait observer de bons esprits compétents (Didier Fassin), dans l’absolu les effets de la pandémie en termes de taux de mortalité sont plus limités que pour d’autres épidémies du passé même récent, mais les conséquences historiques sont peut-être plus grandes – ce qui veut dire qu’il faut dès le début prendre en considération un complexe bio-sociologique ou bio-économique, moral et culturel.
Notre univers intellectuel étant désormais dominé par un discours « économiste », je pense qu’il est utile de partir d’une représentation classique de la crise considérée comme une interruption « endogène » dans le cours de la normalité, par exemple entre des régimes de régulation, conçus par les économistes mainstream comme des équilibres de marché et par les marxistes comme des phases de reproduction élargie du capital, et de faire voir ce qui s’en écarte[11]. On en vient alors à penser, de façon à peine métaphorique, que ce qui s’est produit n’est pas une perturbation ou une rupture d’équilibre, ou même une « contradiction » systémique arrivant à maturité, mais plutôt une invasion ou une contamination de la vie sociale par une pathologie d’origine elle-même virale. Venue « de l’extérieur » (suivant la définition conventionnelle du social, qui exclut le biologique, mais pour mieux se représenter métaphoriquement comme un « organisme »), elle n’en produit pas moins des effets en chaîne de désagrégation interne.
Or le nom dont se servent les économistes pour désigner des chocs imprévus ou imprévisibles, qui ne relèvent pas des causalités quantifiables dans leurs modèles, est externalité. Et depuis que la crise écologique a pris de l’ampleur et ne peut plus être négligée, ni du côté des accidents affectant la croissance ni du côté de ses effets sur l’environnement, donc depuis qu’on a compris que la destruction de l’environnement affecte des conditions essentielles de l’activité économique et du rapport social lui-même qui pourtant ne figurent pas dans leur représentation dominante, l’idée de l’internalisation des externalités est devenue une sorte de fil conducteur pour tous ceux qui veulent repenser le paradigme au sein duquel on cherche à analyser les crises du capitalisme, à définir des stratégies de révolution ou de réforme, et à définir les « valeurs » dont elles devraient s’inspirer (en particulier des valeurs de réciprocité ou, comme dit Latour, de « diplomatie » dans l’interaction de la nature et de la culture). C’est comme si les effets catastrophiques de la civilisation industrielle qui se sont développés « dans le dos » de la conscience sociale (comme disait Hegel) revenaient à l’improviste la frapper et lui faire obstacle.
Mais force est de constater que la pandémie est un genre d’externalité très étrange, puisque – même si ses origines doivent être cherchées dans un rapport à l’environnement que les industries extractives et l’agriculture industrialisée ont progressivement ravagé – c’est de l’intérieur qu’elle se développe et nous met en danger : l’intérieur de nos organismes, et l’intérieur des rapports que, en tant que vivants, nous entretenons les uns avec les autres, y compris sous la forme « pathologique » de la contamination mutuelle. En quelque sorte, il s’agit d’une « externalité interne ». C’est pourquoi, bien que je reconnaisse en général la pertinence de la métaphore du « choc » dont Naomi Klein s’est servie pour décrire les effets pervers des situations de crise sur la mise en œuvre des stratégies capitalistes d’exploitation, je pense qu’elle ne convient pas tout à fait : mieux vaudrait emprunter à Jacques Derrida celle de l’auto-immunité, qui d’ailleurs n’est plus ici vraiment métaphorique, puisqu’elle décrit la façon dont nos systèmes sociaux et politiques sont détruits tendanciellement par l’ignorance plus ou moins délibérée de leurs propres conditions de vie[12].
Et l’on voit que, de nouveau, c’est la catégorie de valeur telle que l’emploie le discours économique dominant (où il faut cette fois inclure également cette variante « hérétique » que constitue le marxisme) qui doit être remise en question, puisqu’elle n’inclut jamais dans sa comptabilité des résultats de l’activité humaine (sauf sous la forme de « pertes ») des valeurs négatives aussi bien que positives. Certaines « valeurs » se créent, s’accumulent, mais non sans que d’autres se trouvent à chaque instant détruites, soustraites : celle algèbre est la clé d’une politique économique « totale » – et cela vaut en temps « normal » aussi bien qu’en temps de « crise »[13].
Mais qu’est-ce qu’un temps normal ? Il est temps d’en revenir à ceci que, dans toutes ses définitions traditionnelles (je résume une très longue histoire), la crise se définit toujours par sa négativité en opposition au type de positivité qu’elle est censée interrompre ou ruiner, bref nier comme disent les dialecticiens, autrement dit elle renvoie toujours à des termes mutuellement exclusifs, formant un couple d’opposés. C’est une idée binaire. C’est pourquoi d’ailleurs, sans même invoquer la philologie de ses origines, l’idée de crise est aussi spontanément rapportée au paradigme de la vie dans toute sa généralité (et toute son équivoque) : la vie biologique, la vie sociale, la vie économique, la vie morale et affective… Car la vie en philosophie connote le plus souvent une valeur d’affirmation (et d’affirmation de soi : conatus, désir, conservation, reproduction, satisfaction), elle implique une prévalence des valeurs positives sur les valeurs négatives[14].
Il était réservé à des penseurs critiques d’une très grande radicalité, comme Walter Benjamin, de nous expliquer que la vie que nous vivons n’est en fait qu’un « état d’exception normalisé », au risque cependant – et sommes-nous prêts à le courir ? – d’identifier la résolution de la crise finale avec un saut dans la transcendance d’un tout autre monde. C’est ce qui me fait croire qu’il vaut la peine de passer encore un peu de temps à jouer et expérimenter avec la totalité du paradigme « critique » que nous avons hérité de la tradition, de façon à faire place dans nos analyses à tous les traits paradoxaux d’une « crise » qui semble combiner étroitement des facteurs d’incertitude objective et subjective, en même temps qu’elle brouille les frontières entre différentes formes d’extrême violence. Sans doute ouvre-t-elle un espace d’anticipation et d’imagination où peuvent s’inscrire des bifurcations très radicales, ouvrant à des formes de vie nouvelles et à des modèles de société incompatibles entre eux, mais dont il nous serait bien impossible de déterminer par avance toutes les implications. Il nous faudra donc parier, et parier collectivement, c’est-à-dire les uns pour les autres, mais évidemment pas à leur place.
*
Pour aujourd’hui, je devrais sans doute m’en tenir là. Beaucoup de questions cependant attendent encore d’être examinées. Celle qui viendrait immédiatement à la suite, et je me contenterai de la nommer, c’est celle des implications cosmopolitiques de tout ce qui vient d’être avancé. Par définition une pandémie est un phénomène mondial (officiellement déclaré tel par une « organisation mondiale de la santé ») : ainsi que je le disais pour commencer, elle affecte l’humanité comme une seule espèce, et de ce fait même elle fait de notre « appartenance » à cette espèce en tant qu’individus un fait empirique, presque perceptible, en tout cas repérable dans les développements de la contagion et dans les mesures prises pour y faire face. C’est encore plus clairement le cas si nous admettons, comme on nous l’a démontré, que la contamination des humains résulte du « franchissement d’une barrière d’espèce » entre l’animal humain et certains animaux non-humains. Une telle situation d’interdépendance semble appeler quelque chose comme un gouvernement mondial de la crise, ce qui suppose des institutions et des autorités, des procédures de consultation et de décision allant bien au-delà de l’échange d’informations ou même – si cette proposition lancée dans un moment critique est suivie d’effets – de la mise à disposition de remèdes ou de vaccins en tant que « biens communs de l’humanité ».
Une biopolitique, donc, qui soit aussi immédiatement une cosmopolitique. Or tout ce que j’ai dit met en évidence que la crise a pour effet d’exacerber les divisions entre les humains fondées sur des différences anthropologiques ou sur des rapports de domination et d’exploitation, qui nous isolent, nous dressent les uns contre les autres, opposent entre eux nos intérêts vitaux, et font de la reconnaissance du « commun » un rocher de Sisyphe, retombant hors de portée chaque fois que nous avons cru le faire avancer… À quoi il aurait fallu encore ajouter ce que je n’ai fait qu’évoquer cursivement, de peur d’ajouter à la complexité de l’exposé, mais qui est en réalité tout à fait fondamental : le néolibéralisme comme régime capitaliste dont les processus d’accumulation comptabilisent la « valeur » (et la survaleur) qu’ils produisent sur un seul et unique marché financier mondial, possède par définition des traits universels. J’y rangerai l’universalisation de la catégorie du « capital humain », dont la valorisation a toujours pour contrepartie une intense destructivité, un « gaspillage » concurrentiel que la pandémie vient encore accentuer.
Mais l’universalité n’est pas l’uniformité : ainsi que Wallerstein et d’autres y ont toujours insisté, nous avons affaire à un « système-monde », au sein duquel coexistent (et le cas échéant s’affrontent) des structures sociales, des formes politiques et des traditions spirituelles hétérogènes, bien qu’on puisse essayer de les ordonner selon des polarités géopolitiques : le Nord contre le Sud, plus que jamais inégaux devant le bien vivre, mais aussi de plus en plus manifestement l’Est contre l’Ouest. Il est peu probable que l’intérêt commun qu’il y a à lutter contre la pandémie et à essayer de faire en sorte que d’autres contaminations du même genre ne nous prennent plus par surprise, sans oublier la menace toujours accrue de désastres écologiques mondiaux, conduise à atténuer ces polarités. Il est vraisemblable au contraire qu’elles se cristalliseront en « stratégies » opposées pour y faire face. C’est en fait ce qu’on observe déjà.
L’humanité ou le « genre humain » (en anglais on dirait aussi naturellement the Human Race) apparaît ainsi à tour de rôle comme objectivement unifiée (par la contagion du virus, par la circulation des marchandises ou par leur interruption, par le réchauffement climatique…) et subjectivement divisée (par les cultures, les idéologies, les historicités), ou inversement comme subjectivement unifiée (par des sentiments de peur et d’espoir) et objectivement écartelée entre des intérêts matériels économiques, territoriaux, nationaux, impériaux, que ne lèvera pas la seule évidence rationnelle du « nous » qui les transcende. L’idée de l’humanité demeure antinomique. Elle ne se laisse appréhender comme « sujet-objet » de l’histoire et de la politique que sous la forme d’une insistante aporie, que la crise actuelle redessine et accentue dramatiquement, et à laquelle nous devons faire face.
Ce texte est l’adaptation française développée de ma conférence pour la London Critical Theory Summer School 2020 Virtual Programme, Institute for the Humanities, Birkbeck College, London, 3 juillet 2020. Il paraît en trois livraisons successives dans AOC que je remercie de sa généreuse hospitalité.
