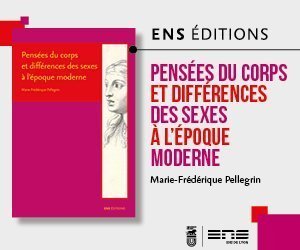Lettre d’un survivant de la première vague
J’entends de beaux esprits affirmer qu’il vaut mieux attraper le Covid en démocratie ; qu’il vaut mieux se contaminer à l’envi au nom de la vie. Après plus de 30 000 morts en France et près d’un million de morts dans le monde, la déroute des sachants de la médecine face à cet être minuscule n’a décidément pas suffi à calmer des arrogances installées.
Je crois que sous les étoiles lumineuses de la belle Europe qui m’offre l’hospitalité depuis plusieurs années déjà, la philosophie, en d’autres temps, a su se faire plus modeste, l’art plus intelligent et généreux, la désinvolture plus discrète. D’où parle-t-on donc ? Cette tournure de questionnement a peut-être encore tout son sens aujourd’hui face à cette pandémie. Et à partir de quelle réalité parle-t-on ? Celle de gens socialement déjà installés dans des bulles résidentielles et territoriales protégées ? Celle de gens qui n’ont pas leurs habitudes de table dans les bars populaires mais dans des restaurants et brasseries distinguées où les prix affichés permettent largement d’amortir les coûts de la distance sociale imposée ? Ou celle de ceux qui se bousculent dans les métro et RER, voyagent coude à coude en classe économique, se serrent dans le bus 38 ou la ligne 4 du métro ? Est-ce à partir de la réalité de celles-ci et ceux-là qui subiront le déficit encore plus abyssal du budget de la sécu ?
Je vais laisser à d’autres aujourd’hui la tâche de faire la sociologie de ces prises de parole très médiatiques et trop entendues, si sûres de leur gai savoir et de leur bonne aura et au mépris des violences qu’elles peuvent produire sur des personnes passées par cette terreur. Les Pinçon-Charlot et leurs héritiers auraient sans doute beaucoup de choses à dire. Et Bernard Stiegler n’est certes hélas plus de ce monde, mais ses livres survivent pour rappeler combien la bêtise peut se faire savante.
J’ai subi dans mon corps et dans mon être le plus profond, la violence de ces désinvoltures qui hélas ne cessent de pérorer sans constater que l’incertitude est désormais reine.
Moi, c’est bouleversé par tant de suffisances pontifiantes au nom de la liberté et au nom de la vie, deux mots purs parfois galvaudés par des marketings de l’égo, que je veux témoigner à ma manière. Témoigner en tant que survivant pour toutes ces libertés privées et pour toutes ces vies étouffées à force d’hésitation et de désinvolture. En février dernier, les tenants de cette ligne parlaient de ce virus comme d’une grippette et moquaient les Italiens. La même musique revient aujourd’hui sous forme d’autres refrains que des personnalités médiatiques entonnent. Aux côtés de milliers d’autres qui, peut-être, gardent encore le silence, j’ai subi dans mon corps et dans mon être le plus profond, la violence de ces désinvoltures qui hélas ne cessent de pérorer sans constater que l’incertitude est désormais reine. Or, comme le suggère François Hartog, notre époque nous invite à réfléchir à partir de ce principe d’incertitude qui s’installe non plus à la marge mais au centre de nos vies.
J’ai passé plus de cinquante jours en réanimation sans l’avoir un seul instant prévu. Le corps livré à un indéfinissable mode, ni vie, ni mort, qu’on résume par quatre lettres : coma. Intubé. Branché à des machines. Absent du monde. Confiné dans un mystérieux ailleurs. Il n’y a qu’elles, ces soignantes, ces infirmières et infirmiers, ces médecins dont je n’ai jamais vu les visages, qui veillaient, ajustaient l’oxygène, surveillaient les bips, me retournaient, me nettoyaient trois, quatre fois, cinq fois par jour et nuit avec une telle humanité. Je conservais seulement quelques prénoms arrachés tenacement à l’oubli. Alexandra, Moucheline, Virginie, Jonathan, Cléa, Laetitia… Quand aurais-je le courage d’y retourner pour à jamais graver leurs noms et leurs visages dans le marbre de mon cœur ? Ces femmes blanches, nettoyaient et habillaient le corps d’un homme noir.
Mais c’est moi qui reprend ces catégories identitaires de nos bagarres médiatiques et politiques pour souligner à quel point derrière les murs de l’hôpital elles étaient frappées de vacuité, et sans aucune pertinence. Vous parlez de République, son air m’a parfois manqué à Paris ; mais je l’ai rencontrée entre les mains de pompiers blancs, noirs, beurs et de toutes les couleurs que vous voulez qui me conduisaient à la Salpétrière… Je l’ai rencontrée derrière les murs de Saint-Antoine et de Bligny, ces autres hôpitaux de France où j’ai atterri sans qu’on ne me demande aucun papier. J’ai entendu cette République parler, quand un Indien d’une chambre de mon voisinage râlait nuit et jour, mais recevait l’écoute et la consolation infiniment patiente des soignantes.
Vous me parlez de liberté, je l’ai rencontrée entre les mains de ces femmes et de ces hommes libérés de la race, et libérés d’eux-mêmes. Complètement dévoués à nous retourner, à nous changer, à nous laver, à nous aspirer de cette bave empoisonnée et expectorante dans laquelle baignait le virus qui nous étouffait. J’ai rencontré la République de la liberté quand, recourbées sur mon corps, ce corps amaigri et d’un livide cadavérique, elles devaient le tâter interminablement pour retrouver plusieurs fois par jour une de ces veines atrophiées d’où il fallait tirer, dans de petites fioles, le sang à tester en laboratoire. Elles couraient pourtant le risque de recevoir une de mes toux empoisonnées en plein visage. Ce sont elles qui sont libérées ! Libérées du dégoût de l’autre, libérées de la peur.
Malgré leurs salaires de fantassin, elles se dévouaient dans ce champ de bataille sans compter. Libérées de l’esprit du gain et comme anticipant l’utopie d’une société du soin. J’ai rencontré la République de la fraternité juste à travers ces regards, ces paroles et ces touchés de soignantes et soignants qui venaient me consoler. Me consoler de cette solitude d’outre-tombe, en attrapant pour me les rapporter, alors que je n’étais même pas pleinement là, les moindres et vibrants messages d’ami.e.s fidèles et de ma famille au loin qui leur parvenaient. Tous ces miens mobilisés et inquiets qu’ils étaient, mais incapables de me rejoindre physiquement en ces lieux…
Malades et soignants sont livrés dans cette solitude absolue pour protéger le monde, nos quartiers, nos rues, de cette horreur et de cette muette barbarie.
Étrange monde que ces sas sécurisés, où nous étions retranchés et dont je ne découvrirais l’étendue des couloirs qu’au bout de deux mois de cette douloureuse épreuve aux côtés de la bienveillante Cléa, la kiné, auprès de laquelle je réapprenais à marcher. Je n’apprendrais, le cœur étreint, la mort de mon compatriote Manu Dibango qu’une fois sorti de là… Et le confinement qui était passé, et Raoult et la controverse sur la chloroquine qui soigne ou ne soigne pas. Et tout ce monde prétendant changer, mais toujours là, accroché à ses interminables bruits et fureurs que n’apaisera plus le vibrato du saxophone de cet esthète africain dont le corps a été anonymement livré à jamais à la terre de France. Il est parti dans le grand âge, mais entouré du silence sordide du deuil honteux qu’on réserve à ces morts infectés. Lui qui aurait mérité fanfares et mille fleurs.
Moi je ne suis juché que sur un peu plus de quatre décennies de vie… On oublie si souvent ces malades encore plus jeunes que moi, en parfaite santé avant la rencontre du monstre qui les conduira derrière ces murs protégés d’hôpitaux. Malades et soignants sont livrés dans cette solitude absolue pour protéger le monde, nos quartiers, nos rues, de cette horreur et de cette muette barbarie. Il faudrait peut-être que les hôpitaux y invitent quelques-unes de ces grandes têtes qui font des leçons de liberté… Un peu d’ethnographie, pour une fois, avant de discourir ne les tuera point. Et peut-être, de ces visites en Covidonie, ils écriront des pages mieux informées sur la liberté et la vie.
Car, où se trouve la liberté aujourd’hui ? Et qui, en ces temps inquiets, peut parler au nom de la liberté et de la vie ? La barbarie aujourd’hui c’est en Covidonie qu’on la combat. C’est là que les médiatiques défenseurs de la veuve et de l’orphelin et de la liberté de commerce et de jouir, doivent planter leur drapeau. Et il faut pour défendre la liberté et nos sociétés, se battre ensemble pour réduire le territoire de cette asile virale. Moi, c’est en survivant que je parle. Mais n’entendez pas seulement en vivant diminué. Malgré mon corps encore meurtri. Entendez surtout en SUR-vivant qui peut donc en dire plus sur la vie que ceux qui n’en ont jamais été privés de cette sorte ; et tant mieux, c’est leur chance.
Mais qu’ont-ils (ne nous encombrons pas d’écriture inclusive, ce sont surtout des hommes) manqué de cette réalité justement ? Ce virus et son enfer sont entrés discrètement dans ma vie. Il ne faut surtout pas donner l’impression de prendre de haut ce monstre minuscule. Comme toutes les autres surprises que la nature agressée par nos frénésies consuméristes pourrait nous réserver. Qu’on me pardonne d’avoir la dent dure, mais il nous faut à tous et toutes un peu d’humilité en ces temps incertains et inquiets du monde. Et mon propos n’est pas de dire, malades ou survivants unissez-vous. Il n’y a pas d’autres fronts à constituer qu’un front commun pour affronter sereinement un virus qui se moque bien de nos sempiternelles et stupides divisions.