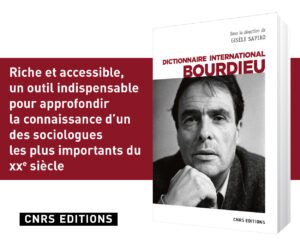Sauver le Conseil national des universités pour préserver l’autonomie des universitaires
Dans quelques jours devrait être adoptée par le Parlement la nouvelle Loi de programmation de la recherche (LPR) dont l’orientation générale, et plusieurs articles en particulier, soulèvent l’indignation de la communauté universitaire. L’une de ses dispositions vide de son contenu la principale fonction exercée par le Conseil national des universités (CNU), instance représentative, collégiale et paritaire, établie à la Libération pour reconstruire un système public d’enseignement supérieur à la fois autonome et exigeant.
Quel est l’enjeu ? La LPR prévoit de restreindre la procédure nationale dite de « qualification » des candidats aux métiers d’enseignant-chercheur. Depuis 1945, cette procédure conduite par le CNU constitue la première étape dans le parcours de recrutement des enseignants-chercheurs. Elle prend la forme d’une « évaluation par les pairs », menée sur des critères scientifiques et pluralistes. Une fois « qualifiés » au niveau national, les candidats peuvent ensuite se présenter sur des postes ouverts dans les universités où, au cours de cette seconde étape, ils sont recrutés par des comités de sélection.
La première étape de qualification peut être comparée à une étape d’admissibilité nationale dans un concours de recrutement se déroulant en deux temps, en donnant bien évidemment aux universités le choix final du recrutement. L’étape nationale de la qualification inscrivant les candidats sur une liste d’aptitude – comme dans la plupart des concours de la fonction publique – est parfaitement légitime, puisque les enseignants-chercheurs sont gérés selon un statut public national et, à ce titre, sont recrutés comme fonctionnaires de l’État et non comme salariés de leur université.
Dans sa longue tribune publiée dans Le Monde du 13 novembre, Frédérique Vidal se garde bien de le rappeler. Lorsqu’elle évoque notamment l’absence d’une qualification pour postuler aux grands organismes de recherche (CNRS, INSERM…), elle passe sous silence le fait que